
Stories We Tell
de Sarah Polley
Sarah Polley est un trésor mondial. Depuis ses débuts en tant que comédienne enfant-star, en passant par ses rôles inoubliables chez Atom Egoyan, jusqu'à sa passionnante carrière de réalisatrice, la canadienne n'a jamais cessé d'intriguer. Stories We Tell nous permet d'en apprendre beaucoup sur sa vie et sur la complexité de ses relations familiales. Loin de moi l'idée de déflorer les multiples rebondissements de ce documentaire extrêmement intime et pourtant palpitant. Loin d'être une œuvre nombriliste, le film ne cesse de revenir à des situations et à des questionnements plus universels, sans jamais perdre de vue le « mystère » principal. Afin de ressusciter sa mère, décédée alors qu'elle était très jeune, Sarah Polley reconstitue de fausses images d'archives très convaincantes et entraîne Stories We Tell aux limites de la fiction. En y ajoutant la multiplicité des points de vue, qui se complètent et parfois se contredisent, on obtient une œuvre d'une grande intelligence sur la subjectivité de la vérité. |

The Land of Hope
de Sono Sion
Au milieu de la folie générale de ses œuvres, il est parfois difficile de se souvenir que Sono Sion est aussi un grand sensible. Pourtant, au fil des quatre heures de Love Exposure, entre les photos de petites culottes et les hurlements, on sent un cœur gros comme ça qui bat, qui bat, qui bat... C'était encore plus évident avec le magnifique Himizu et c'est désormais indéniable avec The Land of Hope. En offrant son film le plus classique, le metteur en scène japonais fait le dos rond. Peu de cris, quelques larmes, pas trop de folie, mais surtout une virulente critique de la gestion de la crise de Fukushima. C'est donc une œuvre polémique, satirique, et surtout déchirante. Après la catastrophe, et face aux radiations qui ne connaissent aucune frontière, certains restent, d'autres partent. La douceur de la forme, inattendue, ne fait que dissimuler une vision très sombre de l'avenir. On ressort de The Land of Hope la gorge serrée, l'espoir promis est bien mince. S'il s'agit de l’œuvre la moins représentative de Sono Sion, on ne peut néanmoins que la conseiller. Même si sa force est plus subtile qu'à l'accoutumée, moins évidente, le propos demeure incontournable. |

Le Congrès
de Ari Folman
Plusieurs films cohabitent difficilement au sein du Congrès d'Ari Folman. D'abord un superbe portrait d'actrice, celui de Robin Wright, qui occupe la première partie du métrage. C'est un hommage touchant au talent d'une comédienne un peu mise à l'écart par Hollywood, qui culmine sur une séquence franchement sublime, l'une des plus belles de cette année. Ensuite, le réalisateur entre dans le vif du sujet, adaptant les écrits de Stanislas Lem (Solaris) sous la forme d'un dessin animé psychédélique tout droit sorti des années 70. L'émotion se fait plus diffuse, noyée dans un perpétuel délire visuel qui ne fait pas toujours mouche. Pourtant, dans ce futur fusionnel, qui rappelle aussi bien Avalon que la fin d'Evangelion, se projette des thèmes très actuels. Folman ne passe pas à côté de quelques caricatures grossières et le propos n'est pas toujours aussi subtil qu'on aurait pu l'espérer. Le Congrès n'est pas moins vraiment intéressant, surtout lorsque sa conclusion laisse la place à l'ambiguïté, vaut-il mieux affronter une réalité douloureuse ou s'évanouir dans le rêve ? |

Upstream Color
de Shane Carruth
Si on essayait de résumer Upstream Color en quelques mots, on pourrait parler de la rencontre de Terrence Malick et de David Cronenberg lors d'une projection de Babe. Si cela vous semble faire peu de sens, ne vous inquiétez pas, ce n'est rien à côté du film de Shane Carruth qui ne cherche jamais à faciliter le travail de compréhension. Beaucoup de pistes sont proposées, aucune n'est certaine. Cela commence comme une allégorie de l'addiction, un asticot aux propriétés plus ou moins hallucinogènes prend le contrôle des êtres qui y sont exposés. On y devine aussi vaguement un propos sur le viol, aussi bien physique que psychologique. Puis on dérive doucement vers une romance entre deux êtres brisés par leur épreuve passée. Mais toute l’œuvre est parcourue par un flot panthéiste, qui semble pousser les hommes vers un retour à la nature. Comme si en tournant le dos à la terre, aux animaux, aux plantes, les humains avaient abandonné une part d'eux-mêmes, ce qui les rendrait malheureux et incomplets.
Il y a une certaine naïveté dans ce propos et on pourra reprocher à Upstream Color d'être bien trop abscons et compliqué pour si peu. D'un autre côté, c'est une proposition qui sort de l'ordinaire, un essai pas totalement réussi mais dont les mérites sont nombreux. Pour exemple quelques scènes viscérales assez intenses et un refrain émotionnel qui grandit peu à peu pour mener vers un final audacieux et non dénué de grâce. Une grâce un peu rugueuse, très étrange, qui en laissera beaucoup perplexes. Il serait cependant dommage de passer à côté d'un film qui ose à ce point déjouer les structures classiques tout en récompensant autant ses spectateurs. |

Le Hobbit : la Désolation de Smaug
de Peter Jackson
L'histoire poursuit son chemin. Après tout, la saga du Seigneur des Anneaux, ainsi que le bref prologue (du moins littéraire) du Hobbit, ne sont que cela : des récits de voyages. Ce sont aussi des romans d'apprentissage qui évoquent parfois avec gourmandise les contes féodaux emplis de guerriers et de prodiges. L'essentiel réside dans les kilomètres parcourus, symboliquement certes, mais surtout réellement. On marche donc beaucoup, on court, on saute, on tombe, on glisse, on navigue, parfois même, on vole. Mais on ne cesse de progresser d'un bout à l'autre de la carte soigneusement dessinée par Tolkien. Pour qui s'intéresse à cet univers, c'est un vrai foisonnement géo-stratégique où la moindre forêt, la moindre cabane, est un enjeu. C'est à ce prix que la Terre du Milieu existe plus que tout autre création d'Heroic Fantasy. Peter Jackson le sait bien et lui donne toute son ampleur, ne laissant rien au hasard.
Cela ne veut pas dire que Le Hobbit est inaccessible aux néophytes. Au contraire, les créateurs des films font en sorte d'accueillir les nouveaux venus et les dilettantes avec tout ce qu'il faut de divertissement simple et direct. Exemples les plus évidents, les scènes d'action sont nombreuses et s'imposent comme les meilleures vues sur un écran cette année. La descente de la rivière en tonneaux et les 45 dernières minutes renvoient toute la concurrence pleurer dans son coin. Si la surenchère est un signe des temps, le sens du rythme, du découpage, du ludique, propre à Peter Jackson, fait toute la différence. Sans parler de son talent unique pour savoir construire une dramaturgie. Smaug est probablement le plus beau dragon du 7e art, mais ce n'est pas seulement grâce aux effets spéciaux parfaits. Cela tient à une mise en place, à une gestion de la durée, de ce que l'on dévoile et de ce que l'on cache, d'un crescendo subtil. Bien sûr, pour ceux qui sont réfractaires à ce monde et à ses protagonistes, c'est un calvaire, mais on espère pour eux qu'ils ont jeté l'éponge depuis longtemps.

Pour les autres, il s'agit là, comme l'année dernière, de l'exemple le plus accompli de ce que peuvent offrir les blockbusters actuels. A la fois en terme de mise en scène que d'écriture et même d'interprétation. On sait qu'il y a peu de place pour les comédiens dans cet univers millimétré et engoncé entre deux fonds verts. Chez Peter Jackson, ils ont quand même de la latitude, un espace pour respirer. La preuve, même avec un temps de présence réduit, Martin Freeman a la possibilité d'user de toute sa palette, aussi bien dans la comédie que dans le drame. Il fait beaucoup avec peu. C'est tout aussi vrai pour Benedict Cumberbatch qui donne à Smaug une existence tout aussi remarquable que ce qu'Andy Serkis avait fait avec Gollum.
Oui, il y a des concessions pour à peu près tous les publics. Dont une histoire d'amour, absente du livre, calquée sur celle d'Aragorn et d'Arwen. Jackson a même trouvé le clone parfait de Liv Tyler en la personne d'Evangeline Lilly. Les puristes trouveront peut-être cela déplacé, de même que les clins d’œil plus ou moins gênants à la première trilogie ; c'est une manière de rendre l’œuvre accessible au plus grand nombre. Ceci dit, le ton plus léger perçu dans la première partie laisse place à une noirceur et une violence tout à fait voisines du Seigneur des Anneaux. La Désolation de Smaug, comme son nom l'indique, ne s'adresse pas aux enfants, en témoignent des scènes franchement effrayantes et des combats d'une brutalité assez choquante malgré leur côté burlesque.

On en revient toujours au même point : dès les premières notes de musique du générique d'ouverture, on est ailleurs. Et même les chansons de fin, pas du tout à la hauteur de celles du Seigneur des Anneaux, ne parviennent pas à gâcher les presque trois heures de spectacle. D'ailleurs ne soyons pas aveugles, enfin, ne soyons pas sourds, et reconnaissons que la musique d'Howard Shore est moins mémorable. Ce n'est pas non plus une catastrophe et on passe outre fort vite. Si l'oeuvre s'étire inévitablement en longueur, au moment où on pourrait commencer à regarder notre montre, nous pénétrons dans l'antre de Smaug. Et là, tout est pardonné, tous les défauts sont oubliés. On quitte la salle dans l'impatience, il nous faut la suite, maintenant, sans attendre. Mais il faudra tenir jusqu'à l'année prochaine, car c'est redevenu une tradition, comme le plus beau des cadeaux cinématographiques. On s'en doutait un peu, mais Peter Jackson est bien le Père-Noël. |

The Lone Ranger
de Gore Verbinski
The Lone Ranger est un blockbuster malade et une vraie réussite au sein d'une année plutôt sinistrée du côté des divertissements hollywoodiens. On comprend assez vite à la vision du film pourquoi l'échec public était quasi inévitable. On peut, par contre, s'étonner davantage d'un accueil critique plutôt tiède. Car il y a de quoi s'intéresser à une œuvre qui, sur le papier, ne promettait pas autant. Ce qui devait être le « feel good movie » de Disney pour l'été est en fait une tentative de western réflexif emballé comme un cartoon pour adultes. On redoutait une redite des médiocres Pirates des Caraïbes, et on est ici à mi-chemin entre les bons films de Gore Verbinski que sont The Weather Man et surtout Rango.
Alors, oui, The Lone Ranger est loin d'être parfait. Le mélange des tonalités vire parfois à la schizophrénie totale et n'obtient pas toujours des résultats très engageants. On passe d'un moment d'une noirceur inattendue à un gag plus ou moins scatologique sensé désamorcer le frisson d'effroi. Dans tous les cas, on ne sait jamais à quel public s'adresse cette histoire, ce qui est plutôt une bonne chose en ces temps de ciblage et de formatage intensifs. Au contraire, Verbinski se sert de l'humour et du spectacle comme d'un cheval de Troie permettant de faire passer des messages assez acides sur le comportement des colons américains et surtout des capitalistes sans scrupule.

Le progrès, oui, mais à quel prix, si ce n'est celui du génocide et de l'effacement de valeurs ancestrales. Là où les scènes post-générique de fin sont généralement des clins d’œil annonçant une suite ou proposant une blague supplémentaire, celle de The Lone Ranger est assez glaçante. Tout le film est ainsi parcouru par des instants de malaise. Qu'ils soient créés par une violence plus proche des westerns italiens que d'une production Disney ou par cette nostalgie palpable, à la fois accusatrice et résignée. Cet aspect du métrage est en particulier véhiculé par le personnage de Tonto, plus complexe qu'il n'y paraît et campé par un Johnny Depp qu'on n'avait pas connu aussi inspiré et impliqué depuis longtemps. Clairement, le projet tenait au cœur de ses créateurs.
Alors, comme mentionné plus haut, il y a des défauts. Le rythme est plutôt agréable, mais il y a toujours des baisses de régime sur près de 2h30. Il y a des clichés dont on se serait bien passé et des gags vraiment embarrassants. Ce n'est pas une révolution, ni un chef-d’œuvre maudit. Il n'en demeure pas moins que The Lone Ranger sort du lot, grâce à ses audaces et aussi, ne l'oublions pas, parce qu'il s'agit d'un amusement cinématographique qui atteint son objectif. Les scènes spectaculaires sont grandioses et surréalistes et on ressent une certaine empathie pour les héros. C'est une goutte d'eau dans l'océan des blockbusters écrits à la truelle, mais ici, pour une fois, on a un peu de tête pour guider les jambes. |

Byzantium
de Neil Jordan
Neil Jordan veut sa revanche. Après tout, avec son adaptation d'Entretien Avec un Vampire, il avait largement précédé la mode cinématographique actuelle. Pour lui, c'est même un « revival », un retour aux sources et surtout une tentative de renouer avec le succès commercial. Byzantium chasse donc sur les terres juteuses des blafards à longues dents (ici à longues griffes), mais avec une petite touche auteurisante. Avouons-le, bien que trop prévisible et assez mal rythmée, l’œuvre se regarde sans déplaisir. D'une part, parce que les qualités d'artisan de Jordan sont toujours présentes et qu'il sait ciseler quelques belles images. Ensuite, parce que c'est correctement écrit, dans une veine (si vous me passez l'expression) romantico-existentielle très classique mais séduisante. Enfin, parce c'est bien interprété, tant il est aisé de se reposer sur la généralement impeccable Saoirse Ronan. On commence à connaître son rôle de gamine éthérée, tourmentée et mystérieuse, mais on se laisse prendre au jeu.
Ceci dit la vraie star du film c'est Gemma Arterton, qui passe presque tout le métrage dépoitraillée. A tel point que ça devient rapidement perturbant, en équivalent féminin de Taylor Lautner dans Twilight ou de Hugh Jackman dans Wolverine. Le décolleté au-delà du plongeant, c'est très agréable à l’œil, mais ça déconcentre aussi et cela finit par apparaître comme une facilité supplémentaire sensée draguer un public adolescent (ou adulescent). On peut prendre cela comme un hommage aux heures de gloire de la Hammer, où la moindre figurante se promenait négligemment en nuisette transparente. Cela renvoie au caractère schizophrène de Byzantium, à la fois pur produit opportuniste et œuvre relativement ambitieuse, qui aimerait plaire tout autant aux puristes qu'au public de Twilight. Pari impossible, certes, mais qui donne naissance à un film fantastique non dénué de charmes. |

Leviathan
de Lucien Castaing-Taylor et Verena Paravel
C'est le choc sensoriel de l'année. Grâce à l'utilisation de caméras Go Pro, Lucien Castaing-Taylor et Verena Paravel proposent une expérience unique qui bouscule nos habitudes de spectateurs. Le quotidien d'un chalutier de pêche industrielle en Mer du Nord devient une succession de tableaux plus ou moins abstraits qui sollicitent les sens comme jamais. Dès la première scène, une remontée de filet au crépuscule, les ambitions de l’œuvre sautent aux yeux et aux oreilles. La référence biblique trouve son expression dans une ambiance de fin du monde d'où surgissent des éclats de lumière, des sons indistincts, des menaces ineffables et tout un décorum primitif. Des flots de sang des poissons éviscérés qui s'écoulent lors d'une séquence insoutenable, en passant par des plongées sous-marines qui coupent le souffle et font retrouver les terreurs originelles, tout est mis en œuvre pour secouer, frapper, et faire perdre tout repère au public.
C'est aussi un test d'endurance physique éprouvant, où les pauses sont rares. On est au-delà de la fête foraine et Leviathan fait passer Gravity pour une promenade à l'académisme plan-plan. Car, si non seulement la forme nous fait chavirer, il y a aussi matière à se questionner. Au niveau écologique, bien sûr, tant les pratiques semblent barbares, mais aussi d'un point de vue existentiel, voire mystique, dans notre rapport au travail, à la nature, à la vie. Certes, il s'agit avant tout d'un documentaire, pur et dur, sans commentaire, se déployant sur la durée pour mieux capter le réel. On a l'impression, oui, de n'avoir jamais été aussi proche de ladite réalité, qui nous saute au visage, nous enlace, nous étouffe, nous montre ses beautés et ses horreurs presque sans le filtre de protection rassurant de l'écran de cinéma.

On passe ainsi par une symphonie d'émotions extrêmes, du dégoût à l'extase, de la terreur à la curiosité. On pourra rejeter en bloc ce qui est proposé ici, trouver cela bien vain ou manipulateur, toutes les réactions sont possibles. Il faudra néanmoins être très fermé aux innovations du 7e art, mais aussi aux aventures qui bouleversent, pour rester à quai. Car il s'agit d'une Odyssée minimale, voire minuscule, et quasi apocalyptique. Le vol des mouettes qui suivent le chalutier, plaqué sur le ciel orageux, possède un pouvoir évocateur archaïque. Tout Leviathan fait ainsi appel à nos peur les plus intimes, celles hérités du plus loin de notre histoire. Images de la naissance, bien sûr, mais peut-être aussi de nos ancêtres luttant pour leur survie. Il faut avoir le cœur bien accroché pour monter à bord, et pour parfois passer par-dessus bord, mais ignorer ce film c'est ignorer l'idée de cinéma la plus novatrice de 2013. |

The Lords of Salem
de Rob Zombie
Rob Zombie fait du cinéma comme Quentin Tarantino : en recyclant avec amour. L'espace d'un film, d'un chef-d’œuvre, The Devil's Rejects, on aurait pu croire que le réalisateur possédait un talent supérieur. Mais non, c'est avant tout un artisan passionné, fanatique d'un genre et d'une époque. L'épouvante des 70's, avec un côté rock et un côté baroque, voilà ce qu'il adore Rob. Il sanctifie tout autant son épouse, Sheri Moon, qu'il met en scène avec délectation dans toutes les situations. C'est à nouveau le cas dans The Lords of Salem, formidable petite entreprise de relecture des classiques démoniaques. Rien de nouveau sous la lune noire, il y a des sorcières qui s'ébattent et de sombres présages. Mais au fil des visions Jodorowskiennes et des plans ciselés, Rob Zombie finit par réussir son hommage. C'est beau, très beau, et doucement étrange.
Mieux encore, c'est de l'horreur adulte, pour adultes, avec des adultes, pas du prêt à divertir pour les ados. Ce n'est pas l'histoire de l'éternelle famille américaine avec sa maison où des bruits étranges proviennent du grenier. Ce ne sont pas une poignée de gamins insupportables poursuivis par le psychopathe de service. Au-delà du prétexte esthétique, cela fait du bien de voir des protagonistes usés, un peu marginaux, un peu, on y revient, rock'n'roll. Le moindre second rôle a le visage de Richard Lynch, Patricia Quinn ou Barbara Crampton. Certes, on est loin de la réussite absolue de The Devil's Rejects, il faut d'ailleurs faire son deuil d'une nouvelle œuvre de ce niveau, qui était la somme de tout un pan du cinéma américain. On le comprend, on l'admet, et on apprécie le néo-classicisme satanique de The Lords of Salem. Rythmé par le Velvet Underground et parcouru par la grâce fanée de Sheri Moon, c'est un film de plaisirs simples, peut-être coupables, mais indéniables. |

The Grandmaster
de Wong Kar Waï
C'est un film old school et désenchanté. On y visite autant les ruines du kung fu que celle du cinéma HK des années 90. Dans les deux cas il n'en reste pas grand-chose et l'âge d'or est fini depuis longtemps. Quelques vieux maîtres tentent difficilement de faire perdurer la flamme mais le cœur n'y est pas toujours. Wong Kar Waï semblait depuis longtemps perdu pour la cause, noyé dans une posture d'auteur de plus en plus déconnecté. Devenu une parodie de lui-même après le triomphe de In The Mood For Love, on n'imaginait pas le vieux briscard revenir vers le cinéma de genre avec autant de sincérité. Car, si on reconnaît immédiatement le style WKW, son maniérisme inimitable, The Grandmaster est un beau film de kung fu, qui évoque avec révérence le parcours de Ip Man, en y ajoutant une certaine poésie du mouvement et en insistant sur une histoire d'amour impossible, véritable marque de fabrique thématique du réalisateur.
Plus accessible que bon nombre de ses classiques (Les Cendres du Temps en tête), The Grandmaster est peut-être le plus traditionnel des films de Wong Kar Waï. Au lieu de sombrer dans une radicalisation de plus en plus autarcique, le metteur en scène joue la carte de la nostalgie et de l'hommage. Alors, oui, on est loin de l'énergie vitale et créatrice de Chungking Express. On est plus proche de l'éloge funèbre et retrouver Tony Leung et Zhang Ziyi après toutes ces années serre un peu la gorge. Mais c'est probablement le but recherché et il est parfaitement atteint. Au-delà de son visuel soigné jusqu'à l'absurde, The Grandmaster est un chant du cygne. |

A Field in England
de Ben Wheatley
C'est une belle époque cinématographique que nous vivons, mine de rien. De jeunes réalisateurs déclarent leur amour pour les auteurs les plus flamboyants des années 1970 et nous offrent des films esthétiquement toujours réussis et parfois très intéressants. Werner Herzog, Ken Russell, Alejandro Jodorowsky sont tous conviés dans le nouveau festin de Ben Wheatley. Avant même d'être une œuvre intrigante, A Field in England est déjà remarquable par son modèle commercial. Cela peut sembler trivial, mais c'est essentiel, tant le 7e Art, en particulier les petites productions exigeantes, cherchent de nouveaux modèles de distribution. A Field in England est sorti en Angleterre simultanément en salles, à la télévision, en VOD, en DVD et en Blu-ray, remportant ainsi un vrai petit succès qu'il n'aurait certainement pas approché avec une simple diffusion dans les cinéma traditionnels. D'autres projets suivront sans doute ces traces dans les années à venir.
A Field in England n'est pas une œuvre facile d'accès, c'est un film expérimental, souvent abscons, parfois volontairement déplaisant. Wheatley n'en est pas à son coup d'essai comme le démontre l'excellent Kill List (et dans une moindre mesure le très noir mais plus accessible Touristes). Là il signe un huis-clos à ciel ouvert, pétri de symbolisme et de mysticisme. Un peu magique, clairement païen, passant d'une scène choquante à de longs plans fixes très picturaux, A Field in England ne s'explique pas. Le côté trip est revendiqué, les personnages principaux étant généralement sous l'emprise de drogues ou d'envoûtement. Jusqu'au point où les images versent dans le stroboscopique pour une longue séquence qui mettra les nerfs optiques et les synapses du spectateur à rude épreuve (avec carton d'avertissement pour les elliptiques avant même le générique d'ouverture).
Le film se perd un peu en route, mais il demeure fascinant, quasi hypnotique. Il parvient même à être étrangement attachant, malgré sa galerie de protagonistes moralement très douteux. C'est à la fois grâce à sa puissance formelle (noir et blanc magnifique, musique voisine de celles de Popol Vuh pour Werner Herzog) et à son ambiance surnaturelle jamais bien définie. C'est une œuvre mystérieuse, peut-être trop, tant elle semble parfois se reposer sur ses zones d'ombre et ses ellipses pour pouvoir tout se permettre. Mais son empreinte est indéniable, on y repense, et sa vision est un vrai choc pour les sens. Derrière ses atours assez humbles, A Field in England a tout du film culte, nouvelle preuve que Ben Wheatley est un talent à suivre de près. |

Spring Breakers
de Harmony Korine
Marre des films qui vous content par le menu les tourments de petits ou grands bourgeois entre deux appartements parisiens ou new-yorkais dont vous ne pourriez même pas vous payer la porte d'entrée ? Harmony Korine a une solution. Suivre des bécasses un peu ploucs, filles d'aujourd'hui, enfants de la mode, lors de leur périple vers le fameux Spring Break, Eldorado de la jeunesse paumée des Etats-Unis. L'impression d'exister en buvant, fumant, baisant, dansant, pendant quelques jours où plus rien d'autre n'existe qu'un hédonisme virant à la communion païenne. Plongeant tête baissée dans la vulgarité et l'idiotie, Spring Breakers possède les atours d'un « Terrence Malick chez les bas du front ». Car le film est d'une beauté formelle totale, où chaque image est un tableau, quand bien même elles tiennent de la pornographie ou du moins du vidéo-clip. Cette volonté d'esthétiser à outrance des sujets de mauvais goût est une manière sincère, un peu maladroite, d'y rechercher poésie et dignité. Le film ne prend jamais de haut ses anti-héros, après tout, Korine est l'un d'entre eux.
Le récit avance, complètement ivre, clairement en plein trip, entre flashforwards, fragments et digressions. C'est une scansion un peu hypnotique, qui désamorce en grande partie l'émotion, mais qui renforce le sentiment de déshumanisation. Les choses arrivent sans véritable implication. Même la montée de la violence se lit comme un dommage collatéral d'un mode de vie qui ne sait absolument pas où il va. Être libre, être soi-même, faire un avec les autres, être avec ses amis, pour toujours. « Spring Break forever », les voix off répètent ce mantra, en boucle, une litanie qui ressemble aux prières chez Malick. Quelque chose de simple, de naïf, de niais, que les images ne parviennent jamais à totalement annihiler. Pourtant l'horizon n'est qu'un amalgame de bikinis, de corps parfaits luisants, d'agitations vaines et de prostrations interminables. Des montées, des descentes, rarement film aura si bien illustré les effets de la drogue.
On part de nulle part, on arrive nulle part, les choses se passent, mais rien ne se passe. Une génération anesthésiée dont la quête du frisson, la quête de soi, passe par sa propre disparition, son uniformisation dictée par la télévision, les médias sociaux, les divertissements de masse. Entre chaînes de la TNT et jeux vidéo, entre foi primitive et zapping compulsif. Le tout rythmé par les sons épuisants de Skrillex, qui, soudain, se fait cotonneux, doux, rêveur. A l'image du maléfique rejeton du Dubstep, le film ne cesse de refluer, comme une vague, en attente de la prochaine montée de basses. En haut, en bas, sans véritable morale, juste une mélancolie poisseuse qui finit par pirater le beau dispositif un peu vain. C'est le portrait frappant d'une génération perdue. Une de plus. |

The Innkeepers
de Ti West
Les films comme The Innkeepers font du bien au 7e art. Tellement de bien, d'ailleurs, qu'ils ne sortent même pas dans les salles françaises, une preuve massive, s'il en est, de leur qualité. C'est du cinéma « de genre », pour ce que cela peut bien vouloir signifier, à vous de voir. C'est de l'horreur, de l'épouvante, soyons clairs. Le réalisateur, Ti West, n'en est pas à son coup d'essai. Les chanceux qui l'ont découvert, se souviennent en particulier du très bon The House of the Devil. On retrouve dans The Innkeepers les mêmes points forts : respect du public, respect des classiques, appropriation virtuose des codes. Du cinéma humble qui s'inscrit dans une vaste lignée. Pas de place pour s'éparpiller, peu de comédiens et un huis-clos, cela permet de prendre tout son temps pour créer l'essentiel.
L'essentiel, c'est exactement la proposition de The Innkeepers : des protagonistes qui ont de la substance, de l'ambiance habile et une histoire formidablement maligne. Le spectateur se fait retourner comme une vieille chaussette, avec trois fois rien. Ça semble simple, le film revendique même un certain minimalisme. Pourtant c'est très compliqué et de plus en plus rare. Déjà, cela demande de la réflexion ; de la part des auteurs, bien sûr, mais aussi de la part du spectateur. On est au-delà des attractions de fête foraine qui forment le tout-venant du genre. Ti West cherche (et trouve) le petit truc, le petit rebondissement, le petit détail, qui déstabilise même l'habitué le plus endurci. On entre dans The Innkeepers comme on entre dans une maison qu'on a visité cent fois. On croit tout connaître par cœur, et on se fait balader.

Le premier mouvement, le plus important, occupe la majeure partie du récit. Pour souligner les évidences : c'est celui de la caractérisation. Une héroïne, qui existe, avec force. Une héroïne, banale, drôle, crédible, parfaite pour l'identification. Là, il fallait une actrice à la hauteur et la performance de Sara Paxton mérite toutes les louanges. Ainsi, le metteur en scène nous tient, hop, on est pris au piège. On s'est fait embarquer. Parce qu'on a cru à l'histoire, on a cru à ses aspects comiques, on a cru à ses digressions en marge du fantastique, on a cru à son réalisme. Quand les mailles du filet se resserrent, on n'a plus le recul nécessaire. On y est, les deux pieds dedans. On en a peur, on est touché. Mission accomplie.
En plus, on y repense, parce que le film évite les explications superflues, il fait confiance au spectateur et à ses capacités d'analyse. The Innkeepers se revoit donc avec autant de plaisir. Car au-delà du suspens, des sursauts, il y a tout ce que je viens de mentionner : une mise en scène, des interprètes, des nœuds à défaire, des pistes à explorer. Du cinéma d'horreur subtil, attachant, sans jamais oublier d'être efficace, vraiment précieux. |

Gravity
de Alfonso Cuaron
C'est un film d'horreur viscéral, un « survival » éprouvant. Dans la droite lignée de The Descent et de REC, Gravity est un cauchemar éveillé qui joue la carte de la surenchère pour provoquer l'effroi. C'est aussi un petit catalogue des craintes à grande échelle, de l'agoraphobie à la claustrophobie, en passant par la suffocation, la noyade et bien d'autres joyeusetés. Heureusement, George Clooney fait quelques blagues, ce serait quasi insoutenable autrement. Au-delà du Grand 8, il n'y a pas grand-chose, à part deux ou trois lieux communs sur la mort, la vie, les religions du monde qui veulent bien se donner la main, c'est beau la Terre, et tout ça. Je vous épargne les symboles taille panzer, où on ne compte plus les cordons ombilicaux et les matrices. Sandra Bullock y apprend qu'il ne faut jamais baisser les bras, la belle affaire. Son personnage est d'ailleurs tellement creux (une femme dépressive qui a perdu son enfant, point final) et développé de manière tellement simpliste (passant de la chochotte paralysée à la guerrière indestructible en une heure de métrage) qu'il est très difficile de s'y attacher. On n'est pas dans 2001 ici, ni chez Tarkovski, ni dans Alien, on est dans le manège pour faire vibrer les générations élevés à la Space Mountain et pour les nostalgiques de La Tour Infernale et de Tremblement de Terre (et son système Sensurround, gadget du moment). Ou plutôt il s'agit du descendant direct des Ailes du Courage de Jean-Jacques Annaud.
Ce qui sauve Gravity et en fait un film remarquable, c'est Alfonso Cuaron, un réalisateur de génie qui sait mieux que quiconque emballer des plans séquences sublimes et offrir beaucoup avec trois fois rien. Techniquement, l’œuvre est un monument d'effets spéciaux et de mouvements d'appareil qui donnent le tournis, voire la nausée pour qui est un peu sensible au mal de mer. Malheureusement, Gravity a pour principal défaut esthétique un point qui contredit totalement sa note d'intention. Dans l'espace, on nous annonce dès le début, il n'y a pas de son. Alors pourquoi le film est-t-il à ce point assourdissant ? C'est en particulier la faute à une musique omniprésente et tonitruante qui surligne tout : la menace avec les nappes qui font peur, les destructions avec l'orchestre qui se déchaîne, et l'émotion avec des mélodies sirupeuses qui culminent sur un vague mélange entre Le Roi Lion et Gladiator. On en est là.
Si on ne recherche que les sensations fortes, on ne sera pas déçu, c'est du divertissement bourrin de très haute volée. Avec la plus-value d'un metteur en scène au sommet de son art, mais qu'on a connu plus inspiré, au moins sur le fond, avec Les Fils de l'Homme. Gravity est un peu saoulant dans son enchaînement mécanique de péripéties, mais c'est un film court, et grâce lui en soit rendu. Surtout que les dernières 20 minutes sont les plus réussies. On pousse un soupir de soulagement quand le générique de fin arrive, ce qui est toujours le cas lors de la conclusion des films d'horreur les plus intenses. Il reste pas moins qu'on est encore loin de l'effroi, à la fois sensoriel et métaphysique, des scènes dans l'espace de 2001, plus glaciales, plus radicales, tellement plus puissantes que tout ce que propose Gravity. Néanmoins, ce premier film catastrophe de l'âge du cinéma virtuel s'avère le meilleur conte d'épouvante de 2013. Pile pour Halloween, ça tombe rudement bien. |

Before Midnight
de Richard Linklater
Avec la série des Before, dont il s'agit à présent du troisième volet, Richard Linklater signe la plus ambitieuse des fresques du cinéma romantique du quotidien. Suivre l'histoire d'un couple, qui se trouve, se cherche, se perd, se retrouve, se dispute et s'aime, au fil de la vie, décennie après décennie, en « temps réel », c'est déjà proposer une perspective audacieuse. Y ajouter une mise en scène sophistiquée, riche en plans séquences complexes mais quasi invisibles pour l’œil inattentif, c'est digne d'éloges. Mais si on complète par l'investissement de deux acteurs qui donnent tout le relief nécessaire à un déluge de dialogues brillants, on obtient une trilogie unique en son genre.
Un genre qui n'est pas habitué à autant de soin apporté à ses clichés, comme si parler du couple ne pouvait se faire que sur le ton de la tragédie ou sur celui de la comédie, avec, dans les deux cas, un excès de dramaturgie qui nuit à l'implication du spectateur. Ce qui frappe en premier depuis Before Sunrise, c'est l'impression de connaître les situations décrites, les mots échangés. Au-delà du naturel des comédiens, les films de Linklater reproduise nos expériences avec juste ce qu'il d'exagération pour passionner. C'est la vie avec une subtile couche de cinéma par-dessus.
Après la rencontre et les retrouvailles, Before Midnight s'intéresse au développement du couple et aux tourments des quadragénaires qui font face aux conséquences de leurs choix. En résulte un film moins exaltant que les deux précédents, légèrement plus sombre, forcément plus adulte. On reconnaît sans mal les protagonistes, mais les caractères s'enrichissent encore, pour le meilleur et pour le pire. Toujours crédités comme coscénaristes, Ethan Hawke et Julie Delpy y reprennent leurs meilleurs rôles, on les imagine sans mal continuer pendant encore bien des épisodes.
Il reste tellement à raconter et les possibilités sont infinies. C'est ainsi que les Before s'éloignent au mieux des clichés, en ne cherchant pas à les éviter à tout prix, mais, au contraire, en se laissant porter par le flot des relations humaines. Par moments, ces films sont des rivières, des fleuves tranquilles ou des torrents qui s'affolent. Du cours paisible d'un travelling qui ne semble jamais vouloir s'achever au déferlement des paroles qui s'entrechoquent, c'est un maelstrom d'émotions. Du très grand cinéma de l'intime. |

Passion
de Brian De Palma
Sacré Brian De Palma, jamais à court d'une bonne blague. Les lecteurs plus ou moins assidus de ce site le savent bien, autant Phantom of the Paradise est l'un de mes films favoris, autant le reste de la carrière du metteur en scène me fait gentiment sourire. La virtuosité creuse de son cinéma, sa vulgarité un peu toc, ce grotesque poussé à l'extrême, tout cela me laisse de marbre. Enfin, parfois, quand ça va suffisamment loin, ça me fait rire. Parfait exemple avec Passion, gentil nanar taillé pour les secondes parties de soirée, avec ce qu'il faut de rebondissements mollassons, déjà usés jusqu'à la corde dans les films précédents du réalisateur. Cela se voudrait vaguement vénéneux et malin, c'est une succession de clichés ridicules, impardonnables chez un soit-disant auteur dont les obsessions tournent en boucle depuis 40 ans. A force de rincer Hitchcock, tout est délavé, paresseux, du cinéma qui bégaie.
On me répondra que si c'est drôle, c'est volontaire, le même argument utilisé par les défenseurs de Dario Argento. Ces cinéastes font exprès de faire des films nuls, c'est tellement post-moderne. Mais au final, on se retrouve quand même devant des œuvres ennuyeuses, laborieuses, mal interprétées (ici par un duo d'actrices pouvant être excellentes si bien dirigées) et sans grand intérêt visuel, car on a déjà vu et revu tout cela depuis longtemps. Que ce soit fait exprès ou non, ça reste d'une médiocrité absolue. Les fans camperont sur leurs positions, les autres pourront faire l'impasse. |

Dredd
de Pete Travis
La nostalgie coupable, forcément coupable, pour les films d'action des années 80 et 90 fait des ravages. A cause d'elle on se retrouve avec des machins aussi lamentables que la série des Expendables ou de nombreux navets mettant indifféremment en avant les gloires grabataires (Stallone, Schwarzenegger, Bruce Willis, Van Damme, etc.). Rappelons-le, ces films là n'étaient généralement pas très bons déjà à l'époque (à quelques notables exceptions près), et ce n'est pas mieux aujourd'hui, au contraire. Sans la présence de réalisateurs un peu inspirés (McTiernan, Cameron, Verhoeven et c'est à peu près tout), ce cinéma bas de plafond n'a pas grand-chose à offrir. Pour le faire tenir à peu près debout, il lui faut au minimum un univers, quelques personnages et un peu de sérieux au milieu de tout ce second degré satisfait.
Ce Dredd, sorti directement en vidéo chez nous, est en ce sens une excellente surprise, totalement inespérée. La version des années 90, justement avec Stallone, était restée dans les annales pour sa nullité. Non seulement elle souffrait de toutes les tares habituellement associés à ces produits-là (mise en scène atroce, histoire débile, comparse comique insupportable), mais elle trahissait de surcroît la bande dessinée d'origine, pourtant parfaitement taillée pour l'action sans concession. Cette atrocité pouvait facilement être balayée par une relecture qu'on n'imaginait pas d'aussi haute volée.
Beaucoup plus fidèle aux Comics (le Juge Dredd n'enlève jamais son casque, exemple le plus évident), le film fait dans la simplicité et l'efficacité. Sur un schéma proche du récent The Raid, c'est un huis-clos sec qui ne s'embarrasse que de quelques fioritures formelles assez réussies. Le reste c'est du carré, du costaud, du violent. Les deux héros remontent les étages d'une tour infernale en zigouillant un escadron de méchants très méchants. Au sommet, c'est l'affreuse Lena Headey qui les attend, actrice toujours idéale lorsqu'il s'agit d'en faire des tonnes dans le sadisme. Entre-temps, on ne s'ennuie pas, les répliques fusent autant que les projectiles, mais l'ambiance reste poisseuse, digne des Comics et donc avec ce qu'il faut de satire sociale acerbe.
Derrière la caméra Pete Travis assure le boulot, avec une certaine inspiration. C'est juste de la série B, rien que de la série B, ça titille un peu la nostalgie sans jamais virer au gâtisme ou à l'hommage envahissant. Dredd est un vrai film d'aujourd'hui, juste plus soigné, plus intelligent, plus satisfaisant que la moyenne. Il faut avoir envie d'un divertissement bourrin, cela va sans dire. Si tel est le cas, c'est celui-là que je vous recommande, il vous en offrira largement pour votre précieux temps. |

Stoker
de Park Chan-wook
Park Chan-wook fait partie de cette école de cinéastes plasticiens dont le talent formel est mis au service de sujets patauds et d'une volonté de choquer le bourgeois qui finissent par se retourner contre leur virtuosité. Un poil plus subtil que ses œuvres coréennes (avec en tête le brutal Old Boy), Stoker repose sur les qualités habituelles du réalisateur. C'est beau, très beau, tout en plans sophistiqués, en symbolisme ostentatoire et en enchaînements brillants. Pour un temps, le film se révèle même assez malin, en jouant sur les codes de genres voisins et en nous entraînant sur de fausses pistes. Au final, on réalise que tout cela est très classique, mais bien exécuté.
Malheureusement, Park Chan-wook ne peut s'empêcher de surligner l'évidence, d'enfoncer les clous jusqu'à faire éclater le bois des cercueils et de s'éterniser sur ce qui pourrait n'être que suggéré. Stoker se veut atmosphérique, psychologique et raffiné, les gros sabots de l'auteur surgissent à la moindre occasion. Dommage, car au-delà de la forme, le point fort c'est bien sûr la géniale Mia Wasikowska, née pour jouer les psychopathes éthérés. Même si Matthew Goode et Nicole Kidman sont impeccables, elle porte l'essentiel du film à elle-seule et se révèle la principale raison de le recommander. On le redit, mais Wasikowska est déjà une grande actrice, capable de transcender par sa seule présence des œuvres mineures. Elle parvient à faire oublier les égarements de Park Chan-wook et à préserver notre intérêt jusqu'à la fin. |

Snowpiercer
de Bong Joon-Ho
Curieuse bête que ce Snowpiercer, sorte de monstre de Frankenstein claudiquant, recousu de partout, tentant de faire tenir debout des influences contraires. Au centre, le réalisateur Bong Joon-Ho, brillant auteur d'une poignée de films exceptionnels (et adorés en ces lieux). Memories of Murder, The Hostet Mother forment le haut du panier du cinéma coréen contemporain. A ma gauche, une bande dessinée française de science-fiction des années 80, avec ce qu'il faut de sociologie simpliste, de vision marxiste, de personnages taillés à la serpe et de dialogues grossiers. A ma droite, Hollywood, ses comédiens, ses codes, sa loi du marché. Autant l'avouer tout de suite, la fusion échoue et accouche d'une œuvre malade, entre fulgurances et ratages.
On peut attribuer à Bong-Joon-Ho le meilleur de Snowpiercer. Il apporte l'humour noir et grotesque cher au cinéma de son pays ainsi que la brutalité délirante des scènes de combats au corps à corps. On commence à en avoir l'habitude, mais ces excès sont assez inattendus dans un tel projet. Il faut voir Tilda Swinton, grimée jusqu'au méconnaissable, cabotiner comme le Jim Carrey des grands jours. Il faut voir aussi les monstrueuses séquences d'action, bourrines jusqu'à l'absurde, où les seconds rôles se font massacrer avec un sadisme glaçant. Dans ces instants là, le film parvient à surprendre et à marquer. Malheureusement il faut composer avec le reste de la recette, et l'indigestion guette.
De la BD, Le Transperceneige, le metteur en scène ne retient rien, ou presque. A peine l'idée de départ, le train qui contient les derniers survivants de l'humanité et qui parcourt sans trêve une Terre désertée et glacée. A l'arrière, les prolétaires, à l'avant les riches, et une métaphore peu subtile de nos sociétés. C'est aussi basique que possible et on enfonce bien les idées à coups de marteau. D'où un rythme catastrophique. Le film met un temps fou à démarrer, s'emballe, freine, s'active à nouveau, avant de finir au point mort pour une interminable fournée d'explications avant l'explosion finale et une conclusion involontairement un peu comique. Trahir la BD semblait nécessaire, mais on regrette paradoxalement sa sécheresse et son absence de sentimentalisme.
Car voilà Hollywood et la parole des studios qui viennent frapper à la porte. Protagonistes stéréotypés, dialogues creux, niaiseries ici et là, trous béants, les travers habituels sont présents. On est loin de l'alternative souhaitée aux rouages usés des blockbusters. On ne cesse de retomber sur les sentiers battus. Alors oui, les bonnes choses sont là et font plaisirs à voir (les comédiens Song Khang-Ho et Ko Ah-Sung, parfaits, mais qui semblent évoluer dans leur film à part). Snowpiercer, trop long, trop inégal, s'effondre sous le souffle des vents opposés. Cela reste recommandable, comme curiosité, en particulier pour qui aime le cinéma coréen et sa folie galopante. |

Man of Steel
de Zack Snyder
Ah, Superman... Le premier des super-héros de l'âge moderne, celui par qui tout a commencé. Forcément, ce n'est pas le plus complexe, c'est même le plus simple. Cette évidence d'un personnage trop parfait, uniformément bon, indestructible, archétypal au point de ne pas laisser de place à la moindre incartade, a donné du fil à retordre à plus d'un auteur de Comics. Superman, à notre époque, n'est jamais meilleur que lorsqu'il est utilisé en contrepoint d'autres héros. Quelques unes de ses plus grandes pages surgissent de ses confrontations/réconciliations avec Batman. D'ailleurs Hollywood ne s'y est pas trompé, et Bruce Wayne sera de la partie dès la suite de Man of Steel. En attendant, il faut ingurgiter les origines de Kal-El pour ce qui semble être la millième fois.
Avouons-le, David S.Goyer et les frères Nolan ne s'en sortent pas trop mal en misant sur un aspect SF et technologique qui est leur terrain de jeu favori et qui entraîne le film vers les terres de Star Trek. Une manière de nettoyer le kitsch solidement accroché au héros. L'histoire va assez vite et la construction en flashback rend nettement plus digeste les passages obligés. Néanmoins, comme avec la trilogie Dark Knight de Christopher Nolan, cette structure élimine presque tout lyrisme et toute émotion. Man of Steel manque terriblement de souffle et il suffit de comparer avec l'ouverture de la version de 1978 (bien aidée par la partition de John Wiliams) pour mettre tout de suite le doigt sur les carences de cette relecture. Pire encore, certaines scènes s'avèrent ratées dans les grandes largeurs, avec comme principal exemple la mort de Jonathan Kent, le père adoptif, totalement ridicule. En voulant s'éloigner de l'histoire canonique, sobre et touchante, le film s'offre une sortie de route qui fait beaucoup de tort à la vision d'ensemble.
Dommage, parce que derrière la caméra Zack Snyder assure le travail avec une certaine sobriété. A part des écarts grotesques pour quelques plans « cinéma indé / Terrence Malick pour les bourrins », Man of Steel possède une tenue visuelle des plus convaincantes. L’œuvre souffre encore d'un caviardage de destructions massives de plus en plus saoulantes et qui se déroulent toujours dans les mêmes lieux (la grande rue de ville de province et la mégalopole avec les immeubles qui tombent façon 11 septembre). Du vu et du revu et seule la surenchère surprend encore un peu (des dommages collatéraux qui se comptent en milliers de morts innocents et en milliards de dollars de dégâts). Ce côté excessif est assez fidèle aux Comics et donne à Superman un petit côté déplaisant et irresponsable plutôt agréable. Il y a un peu de transgression dans tout cela, mais le spectateur lambda n'y sera sans doute pas réceptif. Seuls les fans pourront tergiverser à l'envi sur les implications de telle ou telle scène.
Moins insipide qu'une production Marvel, mais quand même formaté de la première à la dernière image, Man of Steel se situe dans la bonne moyenne de l'hégémonie actuelle des super-héros. Cela se regarde d'un œil distrait et ça s'oublie assez vite, suivant l'humeur on pourra trouver cela interminable ou gentiment divertissant. Reste la qualité d'exécution, qui, des effets spéciaux à l'interprétation (une ribambelle d'excellents comédiens venus payer leurs impôts) en passant par la mise en scène, s'avère tout à fait estimable. Du bon boulot, sans génie, inégal mais plaisant. |

Pacific Rim
de Guillermo Del Toro
C'est un peu le film que tu tournes quand tu as 8 ans. Au fond du jardin, entre deux buissons, une flaque et le sapin des voisins, avec tes jouets tu fais des boum-boum et des crashes ! Les héros se sacrifient et les méchants extra-terrestres usent de pouvoirs psychédéliques. Pas besoin que ce soit cohérent ou développé, du moment qu'il y a de grandes émotions et beaucoup de combats. Pacific Rim c'est juste ça, en moins bien écrit que ce que tu faisais quand tu avais 8 ans avant l'heure du goûter. Ah oui, désolé, mais là il n'y a même pas l'imaginaire et la fantaisie d'un môme. C'est le degré zéro de l'écriture, avec des dialogues à peine dignes d'une série Z mal doublée et des personnages qui font honte aux pires clichés. En résulte un film beaucoup trop bavard pour son propre bien, ruiné par l'omniprésence de répliques ridicules, même et surtout lors des scènes d'action. Entre humour lamentable et ajouts complètement inutiles (pourquoi un chien ? Pourquoi un combat de kung-fu?), Pacific Rim propose aussi les seconds rôles les plus nuls vus depuis très longtemps (les chinois et les russes ont de quoi se plaindre de manière officielle vu le traitement qui leur est réservé ici).
Alors quoi ? Il y a des robots géants qui se battent contre des aliens encore plus géants, non ? Moui... Là encore tout est relatif. La seule vraie scène d'action du film s'éternise jusqu'à devenir ennuyeuse. Faut pas rester là, monsieur Del Toro, hein, faut rentrer chez vous. Vous êtes visiblement ivre de vos effets spéciaux, vous n'arrivez plus à tenir votre caméra, vous faites trop de bruit et vous réveillez tous les spectateurs endormis par la première moitié du métrage. Je ne le cache pas, le Del Toro que j'aime, c'est l'intimiste, celui qui mélange imaginaire et réalité avec le juste dosage, c'est celui du Labyrinthe de Pan, bien sûr, mais aussi de l’Échine du Diable et même de Hellboy II. Dans Pacific Rim, peu de choses distinguent le réalisateur du premier Michael Bay venu. Il y a moins de militaires et de bimbos, c'est déjà pas mal et ça rend son film supérieur à tous les Transformers réunis, mais ça n'en fait pas un blockbuster hors du commun.
Les intentions sont louables, mais l'exécution est ratée. De surcroît, prétextant l'originalité de son sujet, Del Toro ne cesse de se reposer sur des archétypes embarrassants (le personnage féminin est une potiche sans âme) et sur des œuvres nettement plus inspirées (Evangelion, par exemple). Sans protagonistes attachants, sans émotion, sans surprise, Pacific Rim provoque un désintérêt croissant qui ruine les moments spectaculaires. On ne tremble pas, on ne s'émerveille pas, on s'en fiche poliment. Il faut vraiment être très nostalgique des combats de jouets dans la cours de récrée pour trouver ici de quoi se sustenter. Une débauche de destruction massive et des effets spéciaux dantesques ne suffisent pas à faire un bon film, on le sait depuis longtemps. |

The Conjuring
de James Wan
Qu'on le veuille ou non, James Wan a bouleversé le cinéma d'horreur, pour le meilleur et surtout pour le pire. Grâce à lui, nous sommes revenus aux grandes heures des Freddy et autres Vendredi 13, où les franchises jouaient à fond sur le second degré et où le grand guignol prédominait. Ce cinéma tient avant tout de la fête foraine et ravit son principal cœur de cible : le public adolescent. Les films sont formatés, gentiment effrayants, mais ne transgressent rien, ne mettent jamais trop mal à l'aise, ne reposent que sur des images classiques et des sursauts faciles. Spécialiste de la chose, Wan peaufine sa technique depuis le premier opus de Saw et avait jusqu'à présent délivré une succession de nanars désolants peuplés d'histoires ressassées et cruellement dénués de tension. The Conjuring relève un peu le niveau par son application besogneuse finalement payante.
Ne cherchez pas, c'est un maxi best of ultra calorique de tous les clichés des films de maisons hantées et de possessions démoniaques, vous aurez droit à la totale, le grand numéro, raz jusqu'au goulot. Grâce à une construction en deux temps assez efficace et similaire au clownesque Insidious, le film propose le beurre et l'argent du beurre. A la fois le thriller discret, avec apparitions subtiles du fantastique dans le quotidien ; puis les montagnes russes horrifiques, avec tout ce qu'il faut de grotesque et de culs-bénîts malmené dans les chaumières. Il faut dire qu'il y a matière à raconter n'importe quoi en se basant sur les rocambolesques aventures des époux Warren, authentique couple de chasseurs de fantômes dont les frasques font encore le bonheur des amateurs de paranormal délirant.
James Wan n'a jamais aussi bien tenu sa caméra et sa mise en scène mérite quelques louanges. Il reste des tics et des scories, mais il a gagné en maturité, c'est agréable tant les effets hideux de ses précédents ouvrages ne cessaient de ruiner toute tentative d'atmosphère. Les comédiens, habitués aux bêtises d'épouvante, donnent le meilleur d'eux-mêmes sans craindre la caricature. On ne s'ennuie pas, c'est basique au possible, mais efficace en tant que produit de divertissement inoffensif. De la bonne série B d'aujourd'hui, qui cartonne logiquement dans les salles. |

The World's End
de Edgar Wright
Edgar Wright (après le sommet Scott Pilgrim) conclut une "trilogie" débutée par les formidables Shaun of the Dead et Hot Fuzz, avec son film le plus sombre mais aussi le plus fou. Cela débute comme une comédie de potes nostalgiques et cela finit comme un épisode de Doctor Who tourné par une équipe ivre (avec l'une des meilleurs bande-originale « compilation » de l'histoire du cinéma pour lier le tout). A la fois similaire aux deux épisodes précédents dans son appropriation des codes d'un genre pour mieux les dynamiter, The World's End repose davantage sur ses antihéros.
Dans cet opus les auteurs versent dans le contre emploi, avec Nick Frost interprétant de manière tout à fait crédible le quadra responsable et Simon Pegg survolté en junky maniaco-dépressif. C'est moins un retour vers la jeunesse idéalisée qu'une acceptation du temps qui passe sans mettre de côté le plus important : être heureux, quelle que soit la forme que puisse prendre ce bonheur. Tout en dressant un nouveau portrait inimitable de la « génération X », celle des ados des années 90.

The World's End va encore plus loin, en appuyant bien fort là où ça fait mal, en particulier lorsque le film s'en prend à l'uniformisation du monde, où toute personnalité (des êtres, des lieux, des désirs) se trouve nivelée, voire gommée. Il faut donc clamer (et réclamer) haut et fort la liberté de l'homme, quand bien même cela passe par la destruction de la planète. The World's End est un pamphlet d'humanisme militant. Personne ne peut nous obliger à nous plier à sa volonté, ni la société, ni le progrès, ni les bonnes âmes, ni Dieu, ni maître. La vraie liberté de l'individu est d'avoir la totale emprise sur lui-même et ses décisions, bonnes ou mauvaises.
Au final chacun trouve sa parcelle de bonheur dans un monde bouleversé et surtout libéré de la dictature de la technologie et du conformisme. On pourrait croire l’œuvre anarchiste, elle est d'ailleurs joyeusement punk, mais le message est bien plus subtil que cela. La majorité des protagonistes trouveront leur apaisement dans l'accomplissement de rêves simples. Évidemment, seul contre tous, roi des parias, roi des humains, Gary King continuera à vivre comme un personnage de fiction, héros d'un univers enfin à sa mesure. The World's End est drôle et triste, joliment stupide, imparfait et fragile. A notre image. |

Monstres Academy
de Dan Scanlon
Offrir une suite (en forme de vraie-fausse « préquelle ») à l'un des meilleurs films du studio n'est pas une chose inédite pour Pixar. Après tout, une grande partie du public s'est inclinée devant le talent de Toy Story 2. Pas de quoi s'inquiéter donc et le défi est relevé avec le brio habituel. Sans être au niveau de Monstres & cie (qui demeure l'un des plus grands films d'animation du 7e art), ce Monstres Academy ne cesse de s'en approcher. Certes, l'effet de surprise n'est plus là, c'est nettement moins hilarant et la construction dramatique demeure classique. Cependant les principaux éléments sont bien présents et traités avec toujours la même justesse. Car si le personnage de Boo était évidemment une des clefs de la réussite du premier opus, c'est bien l'amitié entre les deux monstres qui a toujours été l'épine dorsale de l'histoire.
Ici il est question de la naissance de cette camaraderie, mais c'est davantage une ode à Mike Wazowski. Le petit cyclope vert qui incarne tous les archétypes de « l'underdog », ce perdant attachant qui finit, par son obstination, par triompher des obstacles. Tous les clichés sont au rendez-vous mais transcendés par la subtilité propre à Pixar, qui sait si bien rendre ses œuvres intemporelles. Tout aussi habile, le style visuel cartoon, qui débute dans la droite lignée du premier film, avant d'étaler les avancées technologiques sans jamais rien perdre de son charme. Les concepteurs en profitent aussi pour faire une démonstration de force lorsqu'il s'agit de décrire le monde « réel » avec un réalisme atmosphérique.

C'est également, de toute évidence, un film de campus, ancré dans la culture américaine et il fait ainsi partie des Pixar les moins immédiatement universels. Pourtant il ne faut pas bien longtemps pour y retrouver le soucis du détail, le rythme comique imparable, la bienveillance omniprésente qui rendent les œuvres du studio toujours aussi uniques en leur genre. L'amitié, la réalisation des rêves, le temps qui passe, trois thèmes pour résumer la quasi intégralité du travail de Pixar. Monstres Academy ne dévie pas de ces obsessions et les transforme en une sorte d'idéal de récit « scolaire ». C'est drôle, fin et intelligent. Après le novateur et encore plus remarquable Rebelle, Pixar prouve une nouvelle fois que le studio à la lampe domine l'industrie du divertissement de la tête et des épaules. |

Star Trek Into Darkness
de J.J. Abrams
Genre lyrique par excellence de la science-fiction cinématographique, le Space Opera n'est malheureusement pas si fréquent. Car cela coûte cher de faire virevolter des vaisseaux ou des corps dans l'espace et le public n'a plus la même avidité de chorégraphies stellaires que du temps de Star Wars. C'est d'ailleurs grâce au succès de la première trilogie de George Lucas que la série Star Trek avait été ressuscitée, d'abord sur grand écran, puis sur le petit. C'est cette période-là qui fit sortir de l'oubli la version télévisée des année 60, gentiment kitsch mais riche d'un univers potentiellement passionnant. Depuis, Star Trek est venu concurrencer Star Wars dans une guerre fratricide qui ne connaîtra probablement jamais de fin. S'il est difficile de nier que la première trilogie Star Wars domine de la tête et des épaules les films de la série classique de Star Trek, c'est à présent le contraire qui a lieu, tant ce rajeunissement de l'équipage de l'Enterprise efface sans mal la deuxième trilogie de Lucas. Savoir que J.J. Abrams va prendre les rênes de Star Wars est d'autant plus savoureux et on n'est pas trop inquiet du résultat s'il met autant de cœur à cet ouvrage. En ce sens, le rachat de la franchise par Disney ne cesse d'être une réjouissante nouvelle.
En attendant, Kirk et Spock assurent l'intérim avec un tel brio qu'on en vient à oublier Han Solo et sa clique. Revanche tardive mais méritée, d'une saga trop longtemps associé aux pires travers des geeks (élitisme, ridicule, beaucoup de bruit pour pas grand-chose). Depuis le redémarrage aussi malin que spectaculaire effectué en 2009, Star Trek est devenu accessible et attachant. Le résultat d'une alchimie de blockbuster parfait où tout semble soigneusement réfléchi sans jamais rien perdre de sa fraîcheur. Star Trek Into Darkness retrouve en particulier le même sens du rythme que son prédécesseur, en démarrant très fort, en développant très vite et en finissant sur une apothéose qui donne l'impression d'aller au cinéma pour la première fois de sa vie. Quasi épuisant, le film explose en tout sens sans jamais se perdre pour autant. Derrière le spectacle, une caractérisation plus subtile qu'il n'y paraît se poursuit. Le cœur du film reposant sur le resserrement des liens d'amitié débuté dans l'opus précédent. Certes, on n'a pas le temps pour les grands monologues et une philosophie profonde, mais Star Trek n'est pas Solaris et ce n'est pas ce qu'on lui demande.

On demande une bonne histoire, de bons personnages, de bons effets spéciaux et une grande évasion vers l'espace infini. A tous ces niveaux, Into Darkness ne déçoit jamais. Même lorsqu'il revient sur Terre, le film ne donne jamais le sentiment de céder à la banalité des blockbusters habituels. On n'est pas là pour casser des voitures ou se battre entre deux immeubles. Ce n'est pas une énième production Marvel ou Michael Bay. Le lyrisme évoqué au début de cette critique est omniprésent, ne serait-ce que par le formidable thème musical de Michael Giacchino, l'une des rares mélodies à avoir fait sa place dans l'histoire du 7e art des années 2000. Associé aux images iconiques d'Abrams, cela donne toujours des instants grandioses, très évocateurs. C'est du cinéma mythologique, avec ses archétypes et ses péripéties plus ou moins attendues, mais toujours traité avec le juste équilibre.
Il suffit de découvrir le principal antagoniste, judicieusement incarné par Benedict Cumberbatch. On le sait depuis le début, mais l'interprète de Sherlock est né pour jouer les méchants. Il vole le film à chacune de ses apparitions. Il est un maillon essentiel dans cette relecture du second opus de la série cinématographique classique, La Colère de Khan. Miroir astucieux de ce qui reste pour beaucoup le meilleur film Star Trek, Into Darkness lui fait écho et l'améliore à presque tous les niveaux. Bien sûr, les fans reconnaîtront toutes les références, nombreuses. Quant aux autres, ils profiteront de la quintessence de cet univers. Comme avec la reprise de Doctor Who depuis 2005, les Star Trek de J.J. Abrams héritent de 50 années d'enrichissement, tout en y apportant les innovations nécessaires à l'époque. Respectueux du passé, mais aussi totalement lié à son temps, Star Trek Into Darkness est, on le répète, avant tout et surtout un divertissement, qui nous précipite à toute vitesse dans son monde et nous abandonne, deux heures plus tard, au bord de l'épuisement, mais ravis. On en redemande, et cela fait bien longtemps qu'un blockbuster n'avait pas paru aussi court. Puisse cette franchise vivre longtemps et prospérer. |

Le Monde Fantastique d'Oz
de Sam Raimi
Mettons tout de suite de côté le fait que cette « préquelle » soit mise en scène par Sam Raimi. Cela pourrait être Tartempion ou Martin Campbell derrière la caméra que ça ne changerait pas grand-chose. Il faudrait être un exégète du réalisateur d'Evil Dead et de Spider-Man pour repérer les quelques hommages à sa filmographie glissés ici et là. Pour le reste c'est du Disney violant les classiques, premier rejeton évident du triomphe d'Alice au Pays des Merveilles. Mais là où Tim Burton parvenait à faire surnager quelques incongruités intrigantes, Raimi ne fait que remplir le cahier des charges au fil d'un scénario patapouf qui enchaîne les péripéties prévisibles. Sur un faux rythme qui s'éternise quand il faudrait s'emballer et qui accélère quand on aimerait qu'il développe, les scènes attendues se succèdent sans créer la moindre empathie. Il faut dire qu'on aura rarement vu caractérisation aussi sommaire, même au sein d'un blockbuster familial. Il faut remonter à l'horrible trilogie du Monde de Narnia pour s'approcher de ce fiasco.
On pardonnera le visuel kitsch qui dégorge de couleurs numériques et qui font ressembler certains plans à des tests pour daltoniens. Après tout, le film de Victor Fleming était déjà une certaine apogée du kitsch cinématographique. Au même titre que l’œuvre de Raimi, l'originale avait été entièrement tournée en studio, avec la pointe des effets spéciaux (dangereux) de l'époque. Reste que c'était aussi une comédie musicale, et à part une tentative avortée de manière méprisante au 2/3 du métrage, et l'inévitable « tube » effroyable dans le générique de fin, aucune chanson à l'horizon de cet Oz 2013. Reste la tapisserie musicale de Danny Elfman, plutôt correcte, en tout cas à peu près au même niveau que celle d'Alice. La forme a coûté cher, ça se voit, et la 3D essaie de te sauter à la figure à la moindre occasion (c'est d'autant plus drôle en 2D).

L'essentiel repose donc sur les personnages et les comédiens. Là, ça devient triste. N'ayant que très peu à défendre, chacun fait de son mieux. Sauf James Franco, avec sa bonne tête de camé perpétuel, qui semble n'en avoir rien à faire. Tout en pensant au gros chèque qui l'attend à la fin, il réfléchit sans doute à sa prochaine performance surréaliste au sein du plus improbable film indépendant du moment. C'est sans doute ce que se dit aussi Michelle Williams, même si le rôle de Glenda, la gentille sorcière du Sud, n'a jamais été conçu comme un monument de nuances. Cela aurait pu être bien mieux pour Mila Kunis et ses yeux qui font naturellement peur. Mais Theodora subit un traitement catastrophique, qui expédie toute forme d'évolution en deux temps trois mouvements. Quant à Rachel Weisz, elle assure le minimum syndical, tranquillement, gentiment, en attendant aussi la paye. Ceci dit, toute une génération de petits garçons va probablement connaître ses premiers émois devant ce défilé de sorcières toutes plus émoustillantes les unes que les autres. En ce sens Raimi mélange les deux designs prévus pour la sorcière de l'Ouest dans le film de Fleming. Belle comme la méchante reine de Blanche-Neige avant sa transformation, mais aussi laide comme une sorcière plus traditionnelle (c'est cette apparence là qui fut finalement retenue).
Bref, à la sortie de la salle, votre petit frère saura sans doute s'il préfère les blondes ou les brunes, mais il ne retiendra sans doute pas beaucoup plus du film. Pour les petites filles, il reste de beaux costumes et un joli personnage de poupée de porcelaine, merveille d'effets spéciaux, auquel le scénario ne rend pas du tout justice. Encore. Deux très longues heures de vide, qui n'offrent même pas le divertissement léger et spectaculaire qu'on était en droit d'attendre. Comme si Disney se donnait la possibilité de créer d'autres suites situées avant le classique de Fleming, après tout c'est tout à fait envisageable. Une manière comme une autre de remplir le porte-monnaie sans avoir besoin de beaucoup d'imagination, en prenant juste la peine de créer quelques séquences qui pourront directement être adaptées en attractions pour Disneyland. Tout le contraire d'un certain Return to Oz, le très singulier film culte des années 80, qui dépasse en tout point ce regrettable ratage. |

Mama
de Andres Muschietti
Il faut bien l'avouer, sur le papier Mama n'a pas grand-chose pour donner envie. Tous les clichés sont là. Cela débute même dans la cabane abandonnée au fond des bois dont on ne saura jamais vraiment à quoi elle sert, à part à être la cabane qui fait peur au fond des bois et que les divers protagonistes n'auront de cesse de visiter qu'une fois la nuit tombée, en dépit parfois de toute continuité temporelle. Cela se poursuit avec les mômes à la fois dangers et victimes, de préférence au sein de la maison américaine typique, dont on se demande, de Poltergeist au navrant Insidious en passant par Amytiville, si ce n'est pas toujours la même depuis les années 70. Donc il y a un fantôme, triste et légèrement jaloux, qui a adopté deux petites filles perdues et qui cherche à les protéger. Ne vous inquiétez pas, ces révélations tiennent dans le premier quart d'heure du métrage. Ensuite il ne se passe quasiment plus rien et Mama ne fonctionne que sur une suite de scènes attendues et au déroulement mécanique. Parfois ça marche à peu près, parfois ça patine dans le vide, la faute aussi à quelques effets spéciaux pas très convaincants qui donnent une artificialité très numérique à un monstre pourtant conçu avec des techniques à l'ancienne.
Bref, production Del Toro oblige, on se retrouve avec une sorte d'Echine du Diable sans éclat, taillé pour le public américain. Certes, les quelques incongruités s'avèrent intéressantes et on aime bien les gamins bizarres. Mais le film reste toujours à la surface et semble se retenir plus que de raison. Par ailleurs, Jessica Chastain, en héroïne rockeuse sur le retour, affiche un décolleté perturbant mais ne transcende jamais un rôle extrêmement limité. Seule la fin, qui rend tellement hommage à Tim Burton qu'elle flirte avec la parodie, se révèle vraiment réussie. On ne regrette donc pas d'avoir tenu jusque là, car, s'il n'est jamais passionnant, le film se laisse regarder, comme une petite série B qui abuse des « jump scares » pour essayer de maintenir l'attention du public. Pour le genre, c'est finalement assez correct, surtout si on compare avec des machins aussi ridicules que Paranormal Activity ou le Insidious cité plus haut. Mama ne vole pas bien haut mais réussit son crescendo et nous laisse sur une note plaisante. |

Samsara
de Ron Fricke
Si on connaît essentiellement Ron Fricke pour Baraka, son précédent documentaire mélancolique sans parole et en musique, il ne faut pas oublier qu’il fut d’abord le directeur de la photographie de Koyaanisqatsi de Godfrey Reggio. Une association lumineuse qui créa un genre à elle seule. Un principe de mise en perspective de l’humanité face à la nature, par la seule force des images. Au-delà du travail photographique, Koyaanisqatsi inventait un langage purement cinématographique où toutes les possibilités de sa grammaire y étaient exploitées. Accélérations, ralentis, plans fixes, zooms, mouvements d’appareils en tout genre, et même l’intervallomètre permettant de filmer sur de très longues durées le rythme du monde. Révolutionnaire, Koyaanisqatsi l’était aussi sur le fond, plus complexe qu’il n’y paraît, avec ses prophéties bercées par la musique de Philip Glass. Baraka reposait davantage sur un éblouissement, et même s’il y avait quelques scènes plus sombres, le mysticisme de Fricke s’avérait plus innocent que celui de Reggio.
C’est pourquoi Samsara s’apparente à un Koyaanisqatsi 2.0 et non à une vraie suite de Baraka. 20 ans se sont écoulés depuis le précédent documentaire de Fricke, et 30 depuis l’œuvre fondatrice de Reggio. La technologie triomphe, les inégalités aussi. Résultat : le rapport s’est inversé. L’émerveillement est devenu minoritaire et c’est la description du monde contemporain qui forme l’essentiel de Samsara. Le message de Fricke est simple : peu importe la complexité des créations humaines, elles finiront détruites un jour ou l’autre. L’ombre de l’Apocalypse est présente : poussière tu étais, poussière tu redeviendras. Avec une certaine bienveillance cependant, tant on sent Fricke admiratif devant la spiritualité humaine, mais aussi avec un effroi de plus en plus palpable. Les séquences consacrées à l’alimentation industrielle, par exemple, sont édifiantes.

Pas besoin de long discours, tout fait sens dans la simple représentation. Certes, le montage et la musique orientent l’interprétation, c’est aussi un récit, et Samsara avance ses conclusions avec évidence. Le final serre la gorge et rappelle que rien n’est éternel, que s’il y a de la grandeur dans la création, tout finira en désert. Au fil de l’œuvre, l’humanité aura été souvent résumée sous forme de machines ou de mendiants, dessinant une classique métaphore de la condition contemporaine. La beauté des images transcende ce schéma familier, la très haute définition employée donnant l’impression de découvrir des plans jamais vus auparavant et surtout des couleurs qui n’existaient pas. D’un simple point de vue technique, Samsara est un événement en soi.
Le sentiment de redite par rapport aux œuvres précédentes est parfois présent, surtout quand Fricke reprend des scènes entières de Koyaanisqatsi. Mais ce bégaiement à plusieurs décennies d’intervalle est volontaire. Au fond rien n’a changé, l’Homme avance toujours, vers de multiples fins et autant de recommencements. Un jour il n’y aura plus que des déserts. En attendant, il faut en profiter pour s’extasier devant le sublime de notre univers. |

A La Merveille
de Terrence Malick
Que faire après avoir offert l’un des plus grands films de l’histoire du cinéma ? Au-delà du jugement artistique subjectif, impossible de nier que The Tree of Life est l’œuvre la plus personnelle et essentielle de Terrence Malick. Libéré de cette création écrasante, l’auteur se trouvait devant un choix radical : s’élancer vers une liberté nouvelle ou prendre sa retraite. A la surprise de certains, qui n’ont probablement rien compris à son travail, Malick a préféré la première option. A La Merveille arrive donc sur les écrans sans l’attente et l’aspect événementiel qui accompagnaient habituellement les apparitions du réalisateur. Moins ambitieux que The Tree of Life, moins ouvragé, plus réaliste, ce nouveau film est ancré sur Terre et surtout dans le présent.
C’est une Odyssée intime et minimale. L’histoire contée est très classique, familière. Un drame romantique archétypal. Un couple se forme, s’aime, vit ensemble, se sépare, se retrouve… Sur ce canevas usé, Terrence Malick crée un système symbolique et sensoriel, tout aussi radical que celui de son film précédent. Comme d’habitude, les scènes se construisent par fragments. Fragments d’images (une liberté absolue du cadre), fragments de sons (un travail complexe auquel a participé Daniel Lanois), fragments de sensations (silhouettes et petites perceptions). Cette approche particulière de la narration peut perturber les habitudes des spectateurs. Chez certains la réponse est proche d’une lecture du Ulysse de James Joyce. S’en suivent des réactions de rejet parfois très virulentes, allant de la moquerie à l’invective (rien n’est plus incongru que de voir des personnes, théoriquement saines d’esprit, insulter un écran de cinéma).

La succession de scènes d’intimité, très proches des êtres, de leurs défauts physiques, permet de scruter les émois avec nuance. Chaque plan, chaque comportement, est une représentation des idées et des émotions. Chaque objet, chaque lumière, chaque action implique plusieurs interprétations. Le film réclame des efforts de compréhension de la part des spectateurs mais peut tout aussi bien être simplement ressenti. Les deux démarches parvenant souvent à des conclusions similaires. Se laisser porter c’est retrouver son propre vécu, parfois le plus intime, dans son évidence et son dépouillement. C’est un autre aspect des œuvres de Terrence Malick qui met quelquefois mal à l’aise les spectateurs peu enclins à se contempler dans un miroir sans les garde-fous des codes classiques de la fiction.
C’est un film sur l’émerveillement et sur l’incertitude. Situé pour la première fois à notre époque, To The Wonder fait surgir des éléments de réalisme social d’actualité. Ces scènes forment un des moteurs du doute. L’amour s’exprime partout mais demeure insaisissable. Comme le Dieu qu’on ne cesse d’appeler sans réponse. Cette pureté n’est donc jamais à confondre avec de la naïveté. Une grande joie sera toujours suivie d’une tristesse encore plus grande. Sans cesse le désir s’oppose à la réalité. Entre douceur et cruauté, l’œuvre ne perd jamais espoir. En ce sens la fin s’avère, comme toujours, sublime. En forme d’illustration d’un état mental, elle montre l’héroïne tournant le dos à ce qui aurait pu être et entreprendre un travail de deuil, avant l’ascension vers la lumière et le soleil, jusqu’à la Merveille. Et le cheminement de l’amour de revenir à son point de départ pour recommencer. Un nouvel amour, une nouvelle histoire.

A La Merveille n’est ni Le Nouveau Monde, ni The Tree of Life, il n’en demeure pas moins supérieur au reste de la production cinématographique. Terrence Malick domine son époque de la tête et des épaules. Le film est à la fois expérimental et accessible ; à la fois poétique et philosophique, ménageant la contemplation et la réflexion. Un cinéma du cérébral et du ressenti, qui accompagne les pensées, les illustre et les guide vers une certaine transcendance. Chaque film du metteur en scène appelle des visionnages infinis et dépasse largement le cadre du divertissement. Les œuvres de Terrence Malick épousent au mieux le mouvement de l’existence, le rythme de la vie et semblent pouvoir ne jamais s’achever. Un univers de chaos apparent où au final rien n’est dû au hasard. |

Flight
de Robert Zemeckis
Ah ne vous méprenez pas, ici on aime Robert Zemeckis. Technicien hors pair, auteur de quelques uns des meilleurs divertissements populaires de l’ère des blockbusters, le réalisateur aura souvent été mésestimé, seulement considéré dans l’ombre du mentor Steven Spielberg. Certes, Zemeckis doit beaucoup à Spielberg et pour ceux qui ne jurent que par le concept « d’auteur », il y a peu d’aspérités dans sa filmographie. A part peut-être une tendance au puritanisme et au politiquement correct. Avec de l’iconoclasme. Dans ses meilleurs moments, Zemeckis sait secouer ses bonnes pensées pour y instiller des incongruités pas du tout appropriées pour le grand public. Cela donne Roger Rabbit (certainement son chef-d’œuvre), mais aussi Retour Vers le Futur, Beowulf, la majeure partie de l’attachant Forrest Gump, etc. La liste de ses réussites est longue.
Flight est plus problématique. Très sérieux dans son propos, le film ne dévie de sa trajectoire que pour des touches d’humour de très mauvais goût. Exemple principal avec le personnage incarné par un John Goodman en roue libre. L’alcool c’est mal, mais la coke c’est drôle. De l’humour noir ? Un laisser-aller total face à la pesanteur du reste de l’histoire ? On ne sait pas trop tant ces moments désarçonnent. Pour le reste, le talent formel de Zemeckis n’est pas à blâmer, c’est magnifiquement mis en scène, même si on soupçonne bien vite que l’intérêt de l’auteur pour ce scénario ne reposait que sur la possibilité de filmer une nouvelle scène de crash aérien impressionnante. La suite repose avant tout sur la performance de Denzel Washington, parfait dans le rôle du gars qui veut un deuxième Oscar mais qui n’a aucune chance face à Daniel Day Lewis.
Le problème c’est que, malgré ses instants de folie (le crash, Goodman, Denzel Washington en chouette salaud), Flight ne cesse de revenir dans les filets du gros téléfilm à thèse. Oh mon Dieu, l’alcool et le mensonge c’est mal ! C’est même pire que la drogue ! C’est terrible ! L’antihéros se fâche même avec sa famille ! Avec son fils ! Oh mon Dieu quelle horreur ! Heureusement, à la dernière minute, et comme prévu depuis la première scène, le vilain bonhomme se repentira, sera bien puni et tout rentrera dans l’ordre, parce qu’au fond il a bon cœur. C’est édifiant au-delà du raisonnable et même du rationnel. Et d’une pesanteur effroyable, que Zemeckis et Washington parviennent à peine à rendre regardable. Grâce à eux, Flight n’est pas si raté, mais la sensation qu’il laisse penche surtout vers le désagréable. |

Argo
de Ben Affleck
Bon, à l’heure où j’écris ces lignes Argo est largement le favori à l’obtention de l’Oscar du meilleur film lors de la prochaine cérémonie des bonshommes dorés. Après avoir remporté des Golden Globes et autres reconnaissances critiques plus ou moins obscures, le troisième opus de Ben Affleck en tant que réalisateur a déjà brillamment rempli son contrat. Le comédien conspué de Daredevil et de Pearl Harbor, le comparse catastrophique de Jennifer Lopez, qui cherchait à toute force à s’acheter une crédibilité artistique derrière la caméra, a réussi son pari. Il faut dire qu’il a sorti le grand jeu. Le thriller politique 70’s avec reconstitution parfaite, sujet fort et suspens consistant. En prime, le dynamisme et l’humour qui font défaut au Zero Dark Thirty de Kathryn Bigelow. Ici pas de polémique, c’est du propre, du carré, et la propagande de la CIA ne prend même pas la peine d’avancer masquée.
Là où Zero Dark Thirty et son sérieux papal tendaient à transformer le propos en calvaire, Argo joue la carte du divertissement pur. C’est donc avant tout une course contre la montre, souvent cocasse, parfois angoissante, avec tous les rebondissements d’usage jusqu’à la dernière minute. En plus on en profite pour en remettre un petit coup dans les dents de l’Iran des Ayatollahs, c’est donc du travail à l’américaine rondement mené. La preuve, il y a même John Goodman. Et tout un casting aux petits oignons, où le moindre second rôle possède le visage Bryan Cranston. Ne jouons pas la mauvaise foi juste pour la forme, Argo est très amusant et relativement prenant, il est donc aisé de se faire balader pendant deux heures. De là à y voir le chef-d’œuvre de l’année, il y a un monde, mais les Oscar sont les chantres du conformisme et il est rare de les voir ruer dans les brancards (il faudrait remonter à Macadam Cowboy, probablement). Un bon film suffit au consensus mais une surprise est toujours possible, surtout si elle est soutenue par Harvey Weinstein…
|

Cloud Atlas
de Andy et Lana Wachowski et Tom Tykwer
Ecoutez, écoutez les clameurs autour de vous. Peut-être y participez-vous. Ecoutez… « Ohlala, les blockbusters ça vole pas bien haut, hein », « ohlala, c’est juste du bruit et des effets spéciaux », « ohlala, c’est du divertissement mais c’est quand même très mauvais », « ohlala, on dirait un téléfilm ». Oui, le cinéma ne ressemble parfois plus beaucoup à du cinéma. Ou du moins on nous apprend à nous contenter de peu. Mais, et c’est là le paradoxe qui nous intéresse aujourd’hui, dès qu’une anomalie émerge, elle est battue par la foule en colère encore plus sûrement que le dernier des spectacles décérébrés.
Voilà, posons les cartes sur la table. Cloud Atlas, le nouveau bébé conjoint des frères Wachowski et de Tom Tykwer descend de la lignée des œuvres maudites car différentes. Si je vous cite The Fall, Southland Tales, The Fountain, vous pensez : « ah beurk beurk beurk, pouah pouah pouah », vous pouvez arrêter là, le prochain film Marvel sort dans peu de temps. Pour les autres, poursuivons notre investigation avec des faits et rien que des faits : une coproduction majoritairement américano-germanique où presque tous les pays européens ont apporté leur obole (sauf la France, hein, bien sûr). 100 millions de dollars de budget, pour un bide intergalactique aux USA (mais le film se remboursera de justesse à l’international). Des acteurs joyeusement has been qui étaient les préférés de votre petite sœur il y a quinze ans (Tom Hanks, Hugh Grant, Halle Berry, Susan Sarandon). Un festival de maquillages tous plus voyants les uns que les autres (ne vous inquiétez pas, c’est fait exprès). Et pas moins de six films en un sur presque trois heures, imbriqués les uns dans les autres à toute vitesse. Autant de raisons de s’enthousiasmer, de s’inquiéter et, pour la majorité, de vouer Cloud Atlas au rayon des nanars.

Forcément, il s’agit d’une des œuvres les plus ambitieuses de l’histoire du cinéma, ou du moins du cinéma de divertissement, car les Wachowski poursuivent leur carrière en artisans passionnés, qui estiment que le cinéma peut autant amuser qu’émouvoir, et qu’on peut mêler action spectaculaire et mélodrame philosophique sans honte. Naïf, lacrymal, exagérément romantique, gaillardement revendicatif, passant de la poésie pure au mauvais goût en une seconde, Cloud Atlas s’avère monumental, sincère et désarmant. Fini les errances post-adolescentes et les influences mal digérées de la trilogie Matrix. Les Wachowski offrent ici un remake mille fois plus réussis de l’ensemble des trois films, en une seule histoire. Et il y en a cinq autres. Drame historique maritime, pamphlet anti esclavage (décidément la grande tendance de ce début d’année), romance musicale, thriller 70’s dans les rues de San Francisco, comédie pure, SF clinquante, post-apocalyptique trash, il y a tout cela dans Cloud Atlas et bien davantage.
Dans le mal-aimé Speed Racer, les Wachowski avaient tout donné dans l’expérimentation formelle, ici il s’agit davantage de torturer la narration. C’est en ce sens que Cloud Atlas se rapproche de The Fall (et son rapport conte/réalité), The Fountain (la narration métaphorique) et Southland Tales (la déconstruction par le prisme des symboles et codes de communications actuels). Les Wachowski font preuve de davantage de simplicité que les trois œuvres citées, ce qui correspond d’ailleurs à leur propos. On est là pour écouter une histoire, six histoires liées avec plus ou moins d’évidence, mais qui mènent à un final classique et touchant. Avec toujours la perspective que chaque récit contient un fragment de tous les autres, que tout a déjà été conté mais que cela importe peu du moment qu’on le fait avec du cœur.

De cœur, Cloud Atlas en déborde, de manière exaltante. Les Wachowski n’ont plus besoin de se dissimuler derrière Baudrillard, Platon, Descartes et tout le Gradus Philosophique. Ce sont des auteurs libérés, qui ne souffrent plus d’un complexe d’infériorité, ils font du divertissement et s’en amusent autant que le spectateur. Les références pleuvent encore, essentiellement à l’histoire du cinéma, mais elles glissent comme autant de clins d’œil. L’important c’est d’enchaîner les sentiments, les sensations. En cela, Cloud Atlas ressemble beaucoup à Holy Motors, mais en nettement plus réussi, en moins cynique, en moins morbide, en moins poseur. Les histoires ne sont pas seulement effleurées, elles sont ici pleinement développées et l’hommage au 7e art n’en est que plus convaincant.
Infiniment libre, Cloud Atlas peut tout se permettre, en particulier ce que la censure américaine redoute en matière de violence ou de nudité. Le film n’est pas calculé en vue d’une tranche d’âge particulière, en vue d’un chiffre au box-office. Il existe en lui-même et pour lui-même, sans se poser la question de ce qui est convenable ou non, de ce qui plaira ou non aux critiques (une nouvelle fois directement malmenés dans un élan libérateur qui appelle le bâton pour se faire battre). Des œuvres de ce calibre sont rares, souvent conspuées, mais elles appellent au vrai sens du « film culte ». Cloud Atlas contient sa propre critique : peu de gens le verront, peu de gens l’aimeront, mais même si un seul est convaincu c’est suffisant. Dans quelques décennies, il est fort probable qu’on se souviendra davantage de ce film que de celui qui remportera les Oscars, les César, qui aura été le plus grand succès de l’année. Une délicieuse anomalie, oui, le virus dans le programme, l’étrangeté qui secoue les habitudes, l’intrus dans la soirée parfaitement organisée. Pourtant, juste un récit, juste un film, juste un divertissement, juste du cinéma, rien que du cinéma. |

Lincoln
de Steven Spielberg
Attention, biopic procédural académique de 2h30. Sujet édifiant : l’abolition de l’esclavage aux USA. Personnage intouchable : Abraham Lincoln. Derrière la caméra : Steven Spielberg. Devant : Daniel Day Lewis. Sur le papier c’est du Panzer. Le truc pour les sorties scolaire, la terreur des classes de Seconde, le passage obligé, le film qui vient aux Oscars comme une formalité. Pourtant, par-delà sa reconstitution impeccable et son classicisme absolu, Lincoln est tout sauf poussiéreux. C’est une œuvre exaltante et vivante, qui ne montre quasiment que des vieux birbes s’ébrouant dans les coulisses de la politique avant de s’élancer dans des débats publics aux résonnances on ne peut plus contemporaines. C’est Spielberg se souvenant de Capra, en moins audacieux, certes, mais en tout aussi prenant. Quitte à se jouer de la réalité historique et en rajoutant sur l’humour, pour mieux appâter le spectateur récalcitrant.
On ne remettra pas une couche sur la perfection formelle de l’œuvre, de la musique de John Williams à la photographie de Janusz Kaminski, tout le monde joue sa partition sans faute. On soulignera, car il le faut bien, la justesse de Daniel Day Lewis, épatant et quasi sobre (enfin, sur l’échelle habituelle du comédien), qui laisse largement de la place aux seconds rôles prestigieux. Ils sont d’ailleurs presque aussi nombreux que dans un Tarantino, le moindre sous-fifre ayant le visage de James Spader, de John Hawkes ou de Jackie Earle Haley. Mieux encore, Spielberg et Lewis offre à Tommy Lee Jones les scènes les plus émouvantes. Oui, c’est un film sur Lincoln, enfin sur un mois de son existence, mais c’est surtout un récit politique, stratégique, au suspens indéniable, qui dévoile a minima comment la grande histoire se construit souvent sur de petits riens.

Évidement, de la première à la dernière scène c’est une œuvre de Steven Spielberg, où tous ses motifs habituels se dessinent, parfois de manière discrète (le regard de l’enfant sur les drames adultes) et parfois omniprésente (l’égalité absolue entre les humains). C’est un film que le réalisateur cherchait à réussir depuis bien longtemps, celui qu’il avait effleuré avec La Couleur Pourpre et complètement raté avec Amistad. Pour l’auteur ce n’est probablement pas un accomplissement aussi personnel et important que La Liste de Schindler, c’est néanmoins une entrée essentielle au sein de sa filmographie. Incontournable. |

Django Unchained
de Quentin Tarantino
Seul un film de Tarantino peut procurer le plaisir d’un film de Tarantino. Depuis son chef-d’œuvre, Kill Bill, le bonhomme s’était un peu perdu en route, réussissant à moitié des opus ambitieux mais maladroits (Boulevard de la Mort et Inglourious Basterds). On croyait avoir perdu le sale gosse de Pulp Fiction au profit d’un Auteur trop content de faire la une des Cahiers du Cinéma avec son moindre éternuement. De l’expérience Basterds, le réalisateur a retenu le jeu avec la réalité historique mais ici elle ne vient jamais écraser la série B qui domine. Encore un récit de vengeance, bien sûr, après tout Tarantino ne sait faire que cela, encore un western, il ne sait faire que ça aussi, même si pour la première fois le genre avance à visage découvert. En ce sens Django Unchained a quelque chose de l’œuvre somme, celle qui sommeillait depuis Reservoir Dogs. Mais en plus humble qu’Inglourious Basterds, en modèle réduit, à l’image du dîner dans la plantation de l’affreux monsieur Candie. Un terrible suspens, deux fois plus long que la séquence de l’auberge, moment-clef du film précédent, avec résolution sanglante cent fois plus spectaculaire.

Tout ce que fait Tarantino a des allures de best of, c’est un cinéma du trop-plein, qui fourmille de détails, de répliques, d’émotions. C’est aussi un cinéma profondément immature et cathartique, qui s’autorise tout ce qu’il ne faut pas faire, en dépit de toute politesse et sans notion du bon ou du mauvais goût. Tarantino descend logiquement du même arbre que Sergio Leone, mais aussi, probablement, de la même montagne que Fellini, avec les obsessions et les fantasmes, les clins d’œil et la complaisance. Entrer dans la danse et accepter les règles c’est atteindre une extase cinématographique unique, rester sur le palier, simple spectateur, c’est s’exposer à une exaspération grandissante ou à un ennui à couper au couteau.
C’est très enfantin, comme jouer aux cowboys et aux indiens, enfin, ici, aux maîtres et aux esclaves. Mais avec, derrière ce fun omniprésent, une vraie intelligence qui ne cesse de vouloir s’effacer au profit du gag ou du bon mot. Pour exemple, le vrai méchant de l’histoire n’est pas celui qu’on croit, ce qui permet à l’acteur fétiche du réalisateur de délivrer l’une de ses meilleures, si ce n’est la meilleure, de ses performances. Si c’est probablement la plus grande surprise de Django Unchained, l’avalanche de stars invitées et d’apparitions fera la joie des cinéphiles de tout niveau. Ce serait criminel d’en faire la liste, comme il est criminel d’entrer dans les détails de l’histoire. Tout ce qui fait le génie du réalisateur est ici présent. La mise en scène s’est assagie, enfin, un petit peu, pour mieux laisser place aux personnages et à la dramaturgie. Ce n’est pas l’alchimie parfaite de Kill Bill, mais on en est proche, très proche.

On pourra théoriser, bien sûr, autant qu’on le souhaitera, jusqu’à plus soif. Mais le film ne s’y prête que peu. Il y a des bons et des mauvais, de l’amitié, de l’amour, et des gunfights bien gores. C’est souvent hilarant et parfois insoutenable. Il y a des zooms et des dézooms, des choix musicaux attendus et d’autres parfaitement incongrus, de la country et du rap, du Ennio Morricone et des chansons amusantes. C’est du Tarantino, que voulez-vous ? On devrait avoir l’habitude, mais finalement ses films sont rares. Peut-être faudrait-il faire preuve d’un minimum d’esprit critique plutôt que de se réjouir grassement d’insultes fleuries ou d’explosions sanglantes. Oui, peut-être. Mais ce sera la note maximale. « Sorry, I couldn't resist. » |
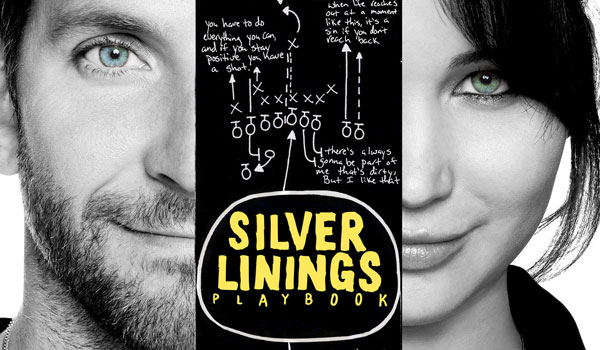
Silver Linings Playbook
de David O'Russell
Renommé de manière absurde Happiness Therapy en France, Silver Linings Playbook ne va pas révolutionner le monde de la comédie romantique, mais il en propose une variation aussi classique dans ses grandes lignes que charmante dans ses détails. Avec plus ou moins de succès David O’Russell (Les Rois du Désert, I Heart Huckabees) aime à investir des schémas classiques pour leur redonner du lustre. Rien de bien transcendant a priori ici : deux maniaco-dépressifs vont se trouver au fil de deux heures de quête existentielle faite de hauts et de bas. Une touche de drame familial pour le bon dosage et plein de jolies paroles sur l’amour, l’amitié, la filiation, le courage dans toutes les situations de la vie, enfin, le cahier des charges bien rempli. Des comme ça, il en sort toutes les semaines. La différence, bien sûr, est dans l’exécution.

Revenu à davantage de sobriété depuis The Fighter, Russell n’en fait pas trop derrière la caméra, malgré quelques plans sophistiqués et quelques morceaux de bravoure notables. Il trouve la tonalité juste, les excès des personnages ne semblent jamais agresser l’histoire plutôt que de la soutenir. En partant de très loin, le récit devient rapidement attachant. Ne le cachons pas, l’essentiel du succès de Silver Linings Playbook réside dans ses interprètes. Deux surprises : l’excellence de Bradley Cooper qu’on n’imaginait pas aussi bon et le grand retour d’un Robert De Niro qui flirte avec le cabotinage mais toujours au service de son rôle. Evidemment, le principal attrait c’est Jennifer Lawrence dont je ne cesse de vous répéter depuis quelques années qu’elle est la meilleure actrice de sa génération, que ce soit dans les grands films comme dans le tout-venant. Elle dévore l’écran de sa présence et installe confortablement son statut de star, à la fois en tant que beauté irrésistible et en tant qu’actrice n’ayant pas froid aux yeux. Non, Silver Linings Playbook ne va pas changer l’histoire du cinéma, mais au sein d’un genre plus que sinistré, et même ravagé par la médiocrité des deux côtés de l’Atlantique, il s’agit d’une réussite incontestable. |

Zero Dark Thirty
de Kathryn Bigelow
Qu’est-ce que l’académisme ? Ce qui plaît à l’académie (des Oscars dans le cas présent) ? Probablement. Zero Dark Thirty est taillé dans le marbre de l’académisme. Sujet fort au sein d’un genre respectable, performance d’une actrice ou d’un acteur qui fait cavalier seul, mise en scène impeccable et sans risque. Edifiant et didactique, le film de Kathryn Bigelow avance mécaniquement sur un faux rythme, on commence avec la « question de la torture », puis la question des « attentats terroristes », puis la « question des guerres internes à la CIA », puis « la traque palpitante » et enfin le moment que vous attendiez tous : « l’assaut en temps réel ». Ouf, il se mérite. C’est du cinéma puissant mais laborieux, qui hésite tout le temps entre retenu et explosion. La mise en scène n’a aucun éclat et Jessica Chastain joue la transparence, c’est la partie retenue. Mais c’est Kathryn Bigelow, miss Point Break et Strange Days, on ne se refait pas. Donc il y a des scènes de suspens à couper au couteau, comme dans Démineurs. Mais avec l’excuse de l’Histoire.

Cessons-là les billevesées, Zero Dark Thirty est un bon film. Un thriller politique, plutôt à l’ancienne, Hollywood nous en sort tous les ans, ils font trois petits tours aux Oscars et puis s’en vont. Celui-ci fait partie du haut du panier. Parce que la réalisatrice accomplit son devoir proprement, avec une certaine objectivité au-delà de la propagande de la CIA. Par instant on entrevoit quelque chose, un éclair, un truc, peut-être un peu d’humanité, au fond, là, dans le regard de Jessica Chastain. C’est bref, car voilà les Navy Seals qui passent à l’attaque, dans une séquence froide comme la mort, tranchante comme une baïonnette. Ce n’est pas un film fun, ce n’est pas un film de guerre où on joue à la guerre. C’est presque la réalité, et en même temps tout semble faux. C’est du cinéma, du bon cinéma à défaut d’être du grand cinéma. Arrive la dernière scène, on ne sait pas très bien si les gentils ont gagné, d’ailleurs personne ne gagne jamais dans ces guerres là, mais Jessica est soulagée et nous aussi. La cloche a sonné, le cours magistral est terminé. |

Le Monde de Charlie
de Stephen Chbosky
Ne cherchez pas à comprendre si vous ne comprenez pas. Vous voyez, c’est un "teen movie", un film d’adolescents. C’est prévisible, classique, sans génie particulier ni dans l’histoire, ni dans la mise en scène. Encore un film d’ados, quoi. On commence à regarder cela d’un œil un peu fatigué, mais sans haine particulière. C’est mignon. Rapidement, il y a un truc. Le film se met à nous parler. A nous tutoyer même. Par fragments, puis par scènes entières, soudain c’est de nous qu’il s’agit. Mince alors. On a fait ça, on a vécu ça, on a, bien sûr, écouté ça en boucle. Zut alors. On a fait des mixtapes avec ces chansons-là. On a longtemps désiré vivre dans le Rocky Horror Picture Show. Bon, tout n’est pas nous, notre vie n’est pas si pleine de traumatismes et de mélodrames en tout genre. C’est une fiction, heureusement. Mais ça, et ça aussi, là, c’est nous. Mais comme dans un conte, vous savez, un truc impossible. On aurait bien voulu que la première fille qu’on ait embrassée soit Hermione Granger. Non, hein, en Seconde on n’a pas emballé Emma Watson, ni son sosie d’antan. Peu importe, c’est la réalité par le prisme du cinéma.

Et donc ? Et donc c’est merveilleux, absolument merveilleux. Pas un grand film, attention, mais un film qui nous parle à nous, c’est presque gênant. Regardez, attendez, je fais la liste : XTC, Galaxie 500, David Bowie, New Order, L7, Sonic Youth, Dexys Midnight Runner, The Smiths, les Cocteau Twins… Oui, c’est probablement de la corruption de sens critique, ce n'est pas très honnête comme méthode. Peu importe, ce film, c’est une mixtape de rêves. La différence avec ton "teen movie jukebox" habituel va au-delà du choix des musiques. Elle se situe dans leur utilisation sensible, sensée, attachante. On ne devrait pas, hein, on a passé l’âge, ou plutôt, voilà, on a enfin l’âge pour ça. Alors on se souvient. On se souvient de ce qui a été et de ce qui aurait pu être. Et on est ému. C’est comme ça. |

The Master
de Paul Thomas Anderson
The Master est un peu le versant cérébral de l’épidermique Martha Marcy May Marlene. Deux approches complémentaires du mécanisme d’endoctrinement. Si le film de Sean Durkin évoquait surtout les conséquences, celui de Paul Thomas Anderson s’interroge sur les commencements. Création d’un mouvement sectaire (ici la Scientologie, jamais nommée mais souvent évoquée de manière détournée) et recrutement d’un sujet alpha. Sur le terrain de la plus grande détresse psychologique, la manipulation fait son nid. Les méthodes pseudo psychanalytiques de Ron Hubbard sont dépeintes lors d’intenses scènes promptes à secouer le spectateur.
Mais le réalisateur, adepte des chemins de traverse, refuse le didactisme et la démonstration bête et méchante. Il préfère la complexité psychologique et la réflexion. Le manichéisme ne pointe que rarement le bout de son nez et si les caractères sont « bigger than life », ils se veulent avant tout humains. D’où l’insistance sur les détails, les petits vices, les grandes faiblesses, les éclats et les murmures. On retrouve ici le même sens du rythme, le même tangage entre retenu et explosion qui faisait la force de There Will Be Blood. Moins emphatique, moins puissant que cette œuvre qui reste le sommet de son auteur, The Master n’en demeure pas moins un achèvement remarquable.

La complexité des thèmes abordés, la richesse psychologique des protagonistes, les nuances innombrables donnent à ce film austère des atours irrésistibles. On y vient d’abord pour la mise en scène toujours aussi magnifique et pour les hallucinantes performances des comédiens, mais on y revient pour les dialogues et les ellipses, pour les duels et les monologues, pour les non-dits. Ce cinéma, qui fit notamment les beaux jours du Nouvel Hollywood dans les années 1970, est aujourd’hui qualifié d’exigeant. Non. Ou plutôt oui, contrairement aux blockbusters pour adolescents et aux interminables explications façon Nolan, The Master ne se donne pas avec évidence. Comme Cosmopolis l’année dernière, ce n’est pas un divertissement devant lequel on pose son cerveau sur le siège d’à côté. C’est du vrai, du très grand cinéma intelligent et admirable.
Aussi retords que généreux, le film ne cesse de défricher des pistes, de semer des symboles, d’offrir des interprétations possibles. Car l’âme n’est pas la fille d’une seule cause, personne ici ne pourra désigner un unique coupable. La faute à qui ? A quoi ? Au sexe ? A la mère ? Au père ? A l’alcool ? A la guerre ? A l’amitié ? A l’amour ? A la femme ? A l’homme ? Mais à tout cela en même temps, bien sûr ! Chaque pièce du puzzle vient garnir la fresque introspective. La fin ne répondra certainement pas aux questions ; elle en pose, au contraire, bien davantage. On reviendra vers The Master, nouvelle apogée peu aimable, et pourtant incontournable, de la carrière de Paul Thomas Anderson. Le réalisateur ne cesse d’affiner et d’affirmer son cinéma, repoussant à chaque nouvel opus ses propres limites et celles de ses spectateurs. Oui, The Master est moins facile à adorer que There Will Be Blood, mais il en tutoie l’immensité. |

L'Odyssée de Pi
de Ang Lee
Évacuons tout de suite l’habituel sujet qui fâche : non, L’Odyssée de Pi ne vaut pas le roman, il en est à la fois très proche tout en en coupant bon nombre d’éléments essentiels. Moins viscéral, moins poignant, le film d’Ang Lee propose une illustration familiale d’une imposante splendeur visuelle et qui préserve l’âme du livre sans toutefois pleinement la saisir. Ne vous inquiétez pas, quel que soit le quai par lequel vous prendrez la mer, par le papier ou par l’image, les deux voyages sont complémentaires. Ne méprisez ni l’un, ni l’autre, au-delà du message édifiant, L’Odyssée de Pi est une œuvre impressionnante et attendrissante. C’est aussi, désormais, un étonnant film de Noël.
Car il y a quelque chose de l’esprit des Fêtes dans ce film. Bien sûr, dans le visuel, très chargé, entre Bollywood et Peter Jackson. La 3D s’avère une vraie réussite et entre dans le faible nombre des œuvres qui justifient la technique. Bref, on en prend plein les yeux. Certains trouveront cette débauche excessive, elle colle parfaitement à la magie du récit. C’est un conte, cruel, déchirant et exaltant. On ne demande ni vraisemblance, ni grande subtilité, on vient pour l’émerveillement.

En ce sens, impossible d’être déçu, les deux heures filent en un clin d’œil, même en ayant déjà lu le roman. Probablement parce qu’Ang Lee a toujours été un excellent illustrateur auquel il manquait parfois un peu de cœur. Dans ce récit, il y a de l’émotion en abondance, des surprises et des frayeurs. C’est une montagne russe en huis-clos océanique, une apothéose du divertissement familial. A ce juste dosage entre kitsch et beauté, entre bons sentiments et âpreté, entre grande aventure et philosophie intime, on reconnaît un vrai film de Noël. L’Odyssée de Pi mérite de faire partie de cette élite et d’être partagé avec tous ceux qui nous sont chers. |

Bernie
de Richard Linklater
Dans la grande famille des réalisateurs contemporains généralement respectés mais globalement sous estimés, Richard Linklater mérite une place de choix. On le connaît surtout dans nos contrées pour ses deux comédies romantiques atypiques et très réussies, Before Sunrise et Before Sunset, dont le troisième volet sort d’ailleurs cette année. Mais sa filmographie est parsemée d’œuvres plus ou moins intéressantes mais qui valent généralement le détour ne serait-ce que pour un sens frappant de la mise en scène et surtout un vrai génie dans la direction d’acteurs. Nouvelle preuve avec Bernie qui tire le meilleur de comédiens plutôt réputés pour leur cabotinage effréné.
Du cabotinage, il y en a, mais au service d’une reconstitution où les protagonistes réels s’avèrent tout aussi excessifs que leur double à l’écran. A partir d’un fait divers relativement banal, Linklater tire un portrait aigre-doux d’une petite ville du Texas. On attend la caricature habituelle, les clichés plein de santiags et d’accents à couper aux couteaux, l’histoire se révèle bien plus subtile que cela. Sans rien dévoiler, difficile d’en expliquer toute la saveur, mais ce faux documentaire très documenté mêle objectivité et exagération sans jamais verser totalement dans la satire.
C’est souvent drôle, souvent cruel, plutôt délicat. On remerciera encore le réalisateur d’avoir su tirer le meilleur de Jack Black en demi-ton, de Shirley MacLaine en vieille peau acariâtre et de Matthew McConaughey qui continue à se tailler une filmographie des plus intrigantes. Rien que pour les interprètes, Bernie est à voir. C’est une œuvre étrange, comme l’auteur aime les peindre, en faisant fi des codes d’un genre précis et en profitant d’une liberté quasi-totale. Ne passez pas à côté.
|
|
|