
Actress - R.I.P.
Oh chic ! Un best of des années 90 du label Warp. Boards of Canada, Aphex Twin, Plaid, Squarepusher, Autechre… Ils sont venus, ils sont tous là. L’album d’Actress est donc très plaisant, surtout si on manque d’electronica, mais il n’apportera aucune révélation à ceux qui connaissent déjà leurs petits Selected Ambient Works, Not For Threes et autres Music Has the Right to Children par coeur.

Allo Darlin' - Europe
En manque de pop précieuse ? Rose Elinor Dougall n’offre que trois titres cette année, c’est la catastrophe ? Se faire un fix de Sundays ne suffit plus ? Heureusement Allo Darlin’ est là, avec un album mignon tout plein ; tout frais, tout léger, juste un peu trop lisse pour vraiment accrocher. Il faudrait un petit quelque chose pour sortir de l’ordinaire, pour imposer une présence. Cependant cela s’écoute avec facilité et plaisir, c'est distingué et parfaitement exécuté, c’est bien l’essentiel.

Antony & The Johnsons - Cut The World
Comme Kylie Minogue cette année, Antony et ses Johnsons s’offrent un orchestre symphonique pour rajouter de l’emphase à quelques classiques du groupe. C’est sensible, sophistiqué, un peu kitsch par moments et atmosphérique au possible. Rien qu’on ne connaissait déjà de la part de l’artiste, certes, mais on n’en demandait pas davantage.

Cate Le Bon - CYRK
Parmi toutes les excentriques du néo-indierock ou du post-VelvetUnderground, enfin ne me demandez pas de vous parler d’étiquettes. Bref, parmi toutes les heureuses chanteuses à guitare plus ou moins acoustique qui sillonnent le milieu indépendant, Cate Le Bon a su se faire sa place, en particulier grâce à Cyrk et à quelques compositions dynamiques et dissonantes, pleines de personnalité.

Burial - Kindred
Celui qui peut en partie se vanter d’avoir lancé le genre Dubstep aura prouvé avec un simple Ep et trois morceaux qu’il est toujours le maître en son domaine. Une sorte de best of (Kindred), un violent coup de pied techno dans la fourmilière (Loner) et une renaissance en apothéose avec ce qui est peut-être la meilleure composition de Burial (Ashtray Wasp). Le londonien n’a pas dit son dernier mot.

Cloud Nothings - Attack on Memory
Alors voilà, on en est là. Des gamins d’à peine vingt ans lancent le revival Grunge. On se sent vieux et cela se nomme « attaque sur la mémoire », c’est explicite. Pourtant c’est vraiment bien. Surtout que ce n’est pas qu’un vague hommage aux grandes heures des Melvins par une bande de boutonneux. A écouter en priorité, l’ambitieux Wasted Days, neuf minutes de rock crade bien plus malin qu’on ne peut l’imaginer de prime abord.

Death Grips - No Love Deep Web
Le punk-rap situationniste de Death Grips en a remis un coup dans les valseuses quelques mois à peine après The Money Store. En balançant No Love Deep Web gratuitement sur internet sans prévenir les gentils petits businessmen du label Epic. Une rocambolesque affaire, un joli coup de pub, et un album aussi génial et inécoutable que le précédent. Soit on est fou et on s’enfile tout d’une traite (plutôt subir Metal Machine Music), soit on picore. Et à l’image de Black Dice ou No Love, cela fait vraiment du bien par où ça passe.

Dirty Projectors - Swing Lo Magellan
Polémique en chambre dans le petit monde du rock indépendant : le dernier album des Dirty Projectors est vraiment trop pop. Mince alors ! C’est devenu facile à écouter. Enfin, tout est relatif. La pédale douce a été mise sur les ruptures de ton, il y a même des chansons qui sonnent à peu près justes. Pas d’inquiétude, cela demeure dissonant au possible et relativement bordélique. Oui, c’est accessible, sans rien perdre de son étrangeté. C’est donc très bien.

Dirty Three - Toward The Low Sun
Vieux briscards ayant l’habitude de prêter main forte à quelques excentriques notoires (Nick Cave, Cat Power, Will Oldham, PJ Harvey), Dirty Three a depuis longtemps rejoint les rangs des groupuscules cultes. La figure de proue (barbue) de Warren Ellis suffisant à drainer les auditeurs vers des albums expérimentaux et parfois peu engageants. Violon dingue, piano ivre et batterie en folie, lentes progressions, brusques frénésies, tout est présent dans Toward The Low Sun.

Rose Elinor Dougall - The Distractions Ep
Si on attend avec impatience la suite de l’excellent Without Why de 2010, Rose Elinor Dougall nous fait gentiment patienter avec trois titres corrects, légèrement plus rock que la jolie "chamber pop" proposée précédemment. Pas de quoi en avoir le tournis, mais c’est toujours aussi charmant.

Godspeed You! Black Emperor - Allelujah! Don't bend! Ascend!
En dix ans d’absence, rien n’a vraiment changé pour Godspeed You! Black Emperor, ni les revendications politiques, ni surtout la musique. Deux pièces montées de 20 minutes, plus deux petits (enfin, moins de dix minutes quoi) intermèdes bruitistes. Tranquille, la routine. Toujours une excellente musique d’ambiance, parfaite pour les allergiques aux symphonies classiques.

The Hunger Games - Soundtrack
C’est désormais la règle à Hollywood : des sagas pour adolescentes en rut, oui, mais avec des chansons de qualité. C’est comme ça depuis Twilight (qui attaquait à coups de Thom Yorke, de Battles, de Grizzly Bear et de Bon Iver) et Le Chaperon Rouge (avec un inédit démentiel de Fever Ray). En toute simplicité. The Hunger Games élève encore la barre avec son générique de fin à base d’Arcade Fire conquérant. Alors oui, il y a des choses un peu vilaines au milieu de tout ça (Maroon 5, horreur, malheur), mais étrangement le bon, et même le très bon, domine (Neko Case, The Decemberists, Carolina Chocolate Drops, The Secret Sisters, Birdy et deux titres plutôt sympathiques de la superstar Taylor Swift). Franchement on n’en espérait pas tant.

Icona Pop - Iconic Ep
Sérieux concurrent au titre de single de l’année, I Love It des joyeuses suédoises d’Icona Pop n’avait pas le temps de trouver un album écrin avant sa date de péremption. Résultat un Ep monté de bric et de broc avec une vieillerie sympa (Manners), une collaboration correcte (Sun Goes Down) et trois trucs affreux à faire hérisser les cheveux sur la tête. On se doute que I Love It doit beaucoup à Charli XCX et on conseille aux trois demoiselles de continuer à travailler ensemble. En tant que phénomène durable Icona Pop a encore beaucoup à prouver, en tant que one-hit wonder on est déjà conquis.

Nicki Minaj - Pink Friday : Roman Reloaded
Alors oui, on peut m’accuser de parler de ce qui n’est absolument pas mon domaine : la bubble pop grand public pour petites filles hystériques. Car c’est un peu le tournant de la carrière de Nicki Minaj. On l’avait découverte, renversante, en invitée sur le fameux album de Kanye West. Depuis elle s’est transformée en débiteuse de tubes pour NRJ12. Dans un monde porno fluo où Barbie a abusé de la chirurgie esthétique, Nicki déverse un vague R’n’B technoïde agressif et efficace mais souvent hideux. Il faut un estomac solide pour écouter ça.

Ministry - Relapse
Al Jourgensen est une diva, ça, on le savait déjà. Résultat, la séparation définitive de Ministry n’aura duré que quatre ans, ce qui, en son genre, est un record. Le professeur Jourgensen a donc toujours quelque chose à dire, et rien de neuf. Les textes n’ont pas grand intérêt et pour ceux qui veulent du rock de gauche autant se réécouter un bon vieux Dead Kennedys. Reste la musique, hyper bourrine et produite avec du clinquant dans les guitares sales. Cela peut défouler à l’occasion, mais c’est aussi très obsolète.

Passion Pit - Gossamer
Passion Pit se transforme sur ce second album en faiseur d’hymnes pour hipsters. Pas forcément un mal quand cela donne l’entêtant, voire saoulant, Take a Walk. Sur la durée d’un album, le coup de force patine un peu dans la choucroute. Pas vraiment désagréable mais gentiment vulgaire.

A.C. Newman - Shut Down the Streets
On aime A.C. Newman, cœur vibrant des New Pornographers, on adore aussi sa carrière solo qui prend avec ce troisième opus un ton encore plus personnel. De la jolie pop intime, sans excès, qui évoque la mort, la famille, les préoccupations du quadra en plein accomplissement existentiel. C’est très beau sans malheureusement bouleverser autant qu’on aurait pu le souhaiter.

Frank Ocean - Channel ORANGE
C’est en écoutant Sweet Life, premier morceau phare de Channel Orange qu’on comprend : Frank Ocean se rêve Stevie Wonder. Ou peut-être Marvin Gaye. Mais il est difficile de ne pas penser à Innervisions et à Songs in the Key of Life à l’écoute de cet album remarquable au sein d’un paysage R’n’B formaté pour le passage à la radio et dans les robinets à clips télévisuels. Plus raffiné, plus talentueux, plus humain aussi, Frank Ocean est définitivement à part. Même lorsqu’il s’égare dans les 10 minutes de Pyramids, un morceau pas vraiment à la hauteur de ses ambitions, le chanteur préserve l’essentiel. Crier au chef-d’œuvre semble cependant prématuré, la marge de progression étant plus qu’évidente.

Santigold - Master of My Make-Believe
En écoutant GO!, le premier morceau du nouvel album de Santigold, on jurerait un inédit pop de M.I.A., la même voix, les mêmes effets. C’est moins violent, moins déstructuré, définitivement taillé pour le grand public, mais il y a de ça. Dès le second titre, Disparate Youth, on retrouve la Santigold qu’on connaît, celle de L.E.S. Artistes. Master of My Make-Believe n’apporte rien de nouveau et s’essouffle assez vite, mais il n’est pas honteux pour autant. C’est déjà pas mal.

The Shins - Port of Morrow
La limite est parfois très fine entre un album pop et un album « trop pop ». Mais, me direz-vous, comment peut-on être trop pop ? Cas d’école avec le nouveau disque de The Shins qui d’un instant à l’autre passe de la légèreté qu’on aime chez eux à des refrains taillés pour une comédie romantique de chez Disney (le très embarrassant No Way Down). Ce n’est jamais affreux car toujours suffisamment ciselé avec de chouettes mélodies. Mais c’est limite, les gars, très limite.

Spiritualized - Sweet Heart Sweet Light
On est toujours heureux d’avoir des nouvelles de Jason Pierce. On connaît les problèmes de santé du démiurge de Spiritualized et chaque album pourrait être le dernier. En 2008, l’excellent Songs in A&E prouvait que le bonhomme en avait encore sous le coude. Avec Sweet Heart, Sweet Light on revient vers une copie grandiloquente de son chef-d’œuvre Ladies & Gentlement We Are Floating In Space. Le sommet du disque déboule dès le début, Hey Jane n’ayant rien à envier aux plus grandes compositions de l’artiste. La suite use et abuse des chœurs et des arrangements symphoniques. C’est assez grandiose même si un peu pompeux et prévisible.

Andy Stott - Luxury Problems
Ah, encore un joli album de vocaux féminins électroniques ? C’est ce qu’on peut penser pendant deux minutes et trente secondes, jusqu’à ce qu’une pulsation d’infrabasses vienne révéler la vraie nature de Luxury Problems. C’est une terre de contrastes, on ne peut pas dire mieux. La voix angélique d’Alison Skidmore voguant sur les arrangements abrasifs d’Andy Stott. Le choc est brutal et délicieux. L’album ne se limite pas à cela, car des instrumentaux minimalistes et mystérieux le parsèment. Entre trip-hop ressuscité et industriel ténébreux, la musique de Stott dessine son propre univers. Pour meilleur exemple Sleepless, où progresse peu à peu une techno brutale et complexe, faite de rythmes dégingandés et de basses qui font trembler les murs. Magnifique et nettement plus facile à écouter qu’il n’y paraît de prime abord.

Swans - The Seer
C’est toujours un événement lorsqu’un groupe culte offre son meilleur disque après trente ans d’existence. C’est assez rare. Presque unique en son genre. Surtout quand ledit groupe revient tout juste d’une séparation de presque quinze ans. Nul doute que l’énergie et la rage s’est accumulé chez Swans pour accoucher de The Seer, Léviathan sonore de deux heures, où le morceau titre dure pas moins de 32 minutes. Répétitive, scandée, oppressante, cette musique fera fuir beaucoup d’auditeurs. L’unanimité liée à l’accueil de l’album ne cesse de surprendre. Peu nombreux sont ceux qui écoutent The Seer en entier. Pourtant c’est un envoûtement, une hypnose horrifique, traversée parfois par d’étonnants éclats de beauté pure. Entre sadisme et masochisme, l’expérience extrême de 2012. Pour avoir mal là où ça fait du bien.

Taken by Trees - Other Worlds
On ferme les yeux. On est aux Caraïbes. Après l’Afrique fantasmée de East of Eden, toujours le chef-d’œuvre de Victoria Bergsman, Taken by Trees rêve de soleil, de cocotiers et d’eau scintillante. Pour comprendre il suffit de regarder le clip sensuel et paradisiaque de Dreams. Tout y est, sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés. Other Worlds, en tant qu’album concept, joue sur la même corde tout du long. On pourra trouver cela un peu répétitif, mais le disque tire sa révérence avant de lasser. Entre la voix mutine de Victoria et ses mélodies délicieuses, difficile de faire la fine bouche. C’est tendre, chaleureux, un vrai bain d’innocence.

Tame Impala - Lonerism
Wooooo, un album de rock psychédélique. A l’ancienne. Avec les sons qui font des vagues, des échos, des trucs qui clignotent, des guitares qui tourbillonnent. C’est coloré et bordélique, mille fois trop long (pourtant ça ne dure que 50 minutes), plein d’idées et de repiquages, avec quelques vrais tubes (Be Above It, Music to Walk Home to, Elephant). La production forcément dantesque de Dave Fridmann fait tenir tout le fatras debout. Il a l’habitude, le bonhomme, à force de bosser avec les Flaming Lips. D’où l’omniprésence de rythmiques titanesques qui roulent et cognent dans tous les sens. Et l'impression persistante d'avoir déjà entendu cela très souvent. En nettement moins subtil, il s’agit d’un album à l’image du Shields de Grizzly Bear, il réclame de la patience, mais elle est largement récompensée.

Sharon Van Etten - Tramp
Sharon Van Etten incarne à la perfection la « singer-songwritter » des années 2010. Forte personnalité, application à la lettre de toutes les règles du folk-rock, traînant ses guêtres sur le même label que Bon Iver. Indie jusqu’au bout des ongles. Il ne faut pas que les a priori vous assaillent, Tramp est au moins aussi bon que Epic, son précédent opus. Un splendide recueil de chansons, toutes très réussies. Il manque un brin de folie, sans doute, une pointe d’originalité, mais c’est parfait quand on a envie d’écouter quelque chose d’agréable sans se compliquer.

Xiu Xiu - Always
Pour célébrer une décennie de Xiu Xiu, Jamie Stewart offre aux fans du groupe un album en forme de best of où tout ce qu’on aime abonde. Rien de surprenant, donc, pour qui suit Xiu Xiu, pourvoyeur régulier d’un excellent disque par an. Mais on trouvera ici quelques-unes des chansons les plus accessibles (tout est relatif) de leur vaste cursus. Avec des rythmes plus simples, des mélodies plus affirmées, des morceaux tels que Hi, Honey Suckle, Gul Mudin ou Beauty Towne s’avèrent parfaits pour ne pas trop effrayer les nouveaux venus. La seconde moitié d’Always fait ressurgir les aspérités habituelles et certains auront du mal à contempler de tels abysses. Pour les autres ce cadeau trouvera une place de choix dans leur collection.

Zammuto - Zammuto
Le miraculeux duo de The Books a décidé de mettre un terme à sa collaboration. Il nous reste une des discographies les plus novatrices et passionnantes des années 2000, à retrouver en intégralité dans le coffret A Dot in Time. Pas le temps de se lamenter, Nick Zammuto est déjà de retour avec un album solo qui comble un peu le manque. Avec ses morceaux frénétiques et dégingandés, cet effort ne dépaysera pas les fans de The Books. Il manque juste un peu de la douceur rêveuse, de la folk squelettique, de la poésie qui faisait le charme des premiers opus du groupe. Zammuto est clairement plus robotique, comme le signifie très bien le single F U C-3PO. C’est donc un peu froid et épuisant, mais très prometteur.
|
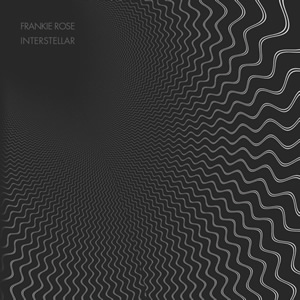
Frankie Rose - Interstellar
Interstellar. Peu de titres donnent une image aussi juste de l’œuvre qu’ils annoncent. La pochette de l’album est encore plus prometteuse : un tourbillon d’ondes filant vers l’infini, comme une plongée en hyperespace ou dans un trou noir. Dès le premier morceau, on est transporté loin, très loin dans les étoiles. Tout d’abord dans un flottement, un murmure plein d’échos, puis nous voici expédiés au-delà des galaxies par une accélération rythmique. C’est du space rock, transcendé par une production sublime qui donne à chaque chanson des allures de petites symphonies spatiales. Frankie Rose s’y connaît en rock mêlant avant-garde et nostalgie, elle qui a fait partie des Dum Dum Girls et des Vivian Girls.
Tout ce qui pourrait ici sembler routinier est sans cesse bousculer par les bonnes idées. Des chansons courtes, souvent à peine trois minutes, un disque tout aussi bref, une demi-heure, et le sentiment de voyager à bord d’une fusée parcourant les contrées idéalisées d’une science-fiction uchronique. Baigné par une cohérence absolue de sons et de thèmes, chaque morceau est une petite merveille en soi. Jusqu’à toucher la beauté totale sur le cœur palpitant qu’est Pair of Wings. Interstellar se rêve Odyssée et fait scintiller les espaces silencieux. Une œuvre aussi planante que percutante, absolument magnifique. |

Holly Herndon - Movement
Le premier album d’Holly Herndon est une expérience. Attention, loin de moi l’envie de galvauder cette expression si souvent martyrisée. Movement est un disque qui s’écoute fort. Au casque. Ou en faisant vibrer le caisson de basses. Le premier morceau se nomme Terminal et commence avec un frissonnement. Un souffle de bruit blanc qui court de droite à gauche en glissant sur la stéréo. Puis surgit une simple note de basse, un son d’une puissance totale qui gagne progressivement en ampleur. C’est le son de l’univers post-apocalyptique de Terminator. Dans ce paysage désolé viennent galoper des clignotements synthétiques, comme autant de papillons se cognant contre les parois d’un bocal, comme autant de créatures se heurtant à une vitre invisible. En quelques minutes, nous sommes ailleurs, dans un au-delà cinématographique, dans une fin du monde où les machines joueraient avec les derniers humains. On entend vaguement une voix murmurer, à mesure que les coups sourds d’un rythme aveugle cognent dans les enceintes. Peu à peu les vestiges sont balayés. Avons-nous déjà entendu ça ? Pas le temps de se poser la question, ce n’est que le premier morceau.

La piste suivante est la plus accessible. Il s’agit du génial Fade, épopée techno qui scintille dans les ténèbres d’une cité en fusion. Le spectre sonore convoqué par Holly Herndon semble s’étendre à l’infini. De partout surgissent les basses, les claps, les éclats vocaux et même un cri du cœur (« I’ll be there »), répété en litanie comme une bouée de sauvetage dans l’effondrement du dancefloor. En somme, le morceau de danse électronique le plus remarquable de 2012. Et nous n’en sommes qu’à la piste 2.
Breathe suit son patronyme au pied de la lettre. Respiration profonde et apnée, puis relâchement soulagé comme un nageur remontant précipitamment à la surface. Sensation de noyade, soulagement du souffle retrouvé. Mais la fonction vitale est une nouvelle fois perturbée par des spasmes électriques. Comme des androïdes essayant de comprendre en quoi consiste un acte qui leur serait inutile. On prendrait le disque en cours de route, on jurerait un inédit du dernier Scott Walker, tant rien ici ne ressemble à quelque chose de connu. De ces respirations vibrantes d’échos et de larsen nait peu à peu un magma palpitant et grotesque. C’est le chaos primitif, une renaissance.

Retour des basses qui font trembler les murs avec Control And, sorte d’interlude angoissé et fantomatique qui débouche sur les circonvolutions de la chanson Movement. La rousse au regard perçant souhaitait véhiculer une sensualité ultra sensorielle avec sa musique. Nul doute que vous ne trouverez pas plus viscéral cette année. C’est une ondulation cybernétique, un rêve humide pour la Motoko de Ghost in the Shell. On peut sans doute danser, avec nos câbles correctement branchés dans le cortex. Coups de boutoir des basses, langueurs de la voix cachée au fond du mix, frénésie des spasmes électriques. L’érotisme du futur ne sera pas au goût de tous.
Le temps d’un Interlude où des fragments sonores viennent se jeter contre nos tympans en autant d’univers mort-nés. Il est déjà l’heure de la conclusion, Dilato. Le retour de l’humanité qu’on croyait à jamais dévorée par les machines. Des notes a capella, des voix qui se croisent, s’empilent, s’évitent, résonnent en chœur. En une simplicité digne des premiers temps, l’origine d’un monde. Cérémonie secrète à la divinité Dilato ? Rien d’aussi sérieux, fort heureusement. Juste le plaisir d'inventer et de repousser toujours un peu plus loin notre expérience de la musique. |

Grizzly Bear - Shields
Donc, voilà, c’est le disque de l’année. C’est à peu près plié. Cela se jouera chez les professionnels entre Shields et le bel album orange de Frank Ocean. Que vous dire alors ? Vous avez probablement déjà écouté le nouveau Grizzly Bear. Plusieurs fois, minimum, car ce n’est pas une musique qui s’offre dès le premier rendez-vous. Bien sûr, il y a toujours une ou deux chansons aguicheuses, comme Yet Again et surtout l’impérial Half Gate, mais voici un groupe qui se refuse aux évidences. Pas de découpage classique, pas de couplets, pas de refrains, ou si peu. Des fragments de mélodies, oui, pour amadouer l’auditeur et l’entraîner loin de chez lui. En ce sens, Grizzly Bear est le digne descendant de Radiohead. On leur promet d’ailleurs la couronne de roi du monde indépendant, le trône de ceux qui parviennent à dépasser le cadre des initiés pour séduire le grand public. Progression normale pour des petits gars déjà auteurs d’un tube en or (Two Weeks sur Veckatimest, l’opus précédent) et qui ne cessent d’élargir leur paysage sonore.
Difficile à présent de ne pas reconnaître les vastes horizons qui entourent cet album, des premières mesures de Sleeping Ute à la conclusion lyrique de Sun In Your Eyes. Mais, comme mentionné précédemment, Shields ne se donne pas en un soir. Ses méandres demandent de l’attention. Soit que la balade se fasse crépusculaire (Adelma) ou exigeante (The Hunt), il y a ici de quoi se perdre des nuits entières. On y revient, encore et encore. Au fur et à mesure, tout fait sens ; les six minutes de A Simple Answer et son rythme tambourinant, autant que les fioritures de What's Wrong. Et on s'extasie encore sur l'intensité de Half Gate, monument en hommage à ceux qui n'ont pas peur du lyrisme le plus souverain. Qu'une musique aussi passionnante puisse se révèler à ce point fédératrice ne peut que rappeler le triomphe de Funerals d'Arcade Fire. Grizzly Bear n'en sont peut-être pas encore à leur chef-d'œuvre définitif, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Puissent-ils nous abreuver encore longtemps de disques aussi extraordinaires. |

Porter Ricks - Biokinetics
Expliquer la techno minimale à un néophyte n’est pas toujours chose aisée. On peut évoquer l’ambient, mais ça restera nébuleux pour le petit curieux. Parler du jazz peut aider, expliquer le plaisir pris au genre, que ce soit en simple musique de fond comme en écoute attentive. Tout ici se réduit à son essence. Un fantôme de rythme, une bribe de basse, un souvenir de mélodie. Cela peut aller très loin, jusqu’à l’effacement en direct des pistes comme sur les fondamentales Disintegration Loops de William Basinski. Rien d’aussi radical chez Porter Ricks, héros de la « minimal techno » au même titre que Basic Channel. Précisons d’emblée qu’il s’agit là de la réédition d’une compilation sortie en 1996. Peu importe, quinze ans plus tard, Biokinetics n’a pas pris l’ombre d’une ride et on peut gager que cette musique n’est pas prête de subir le poids des ans. Tout est affaire ici de répétitions et d’infimes variations, de lentes montées et de longues descentes, une sensation de flottement. Comme la mer qui ondule, d’où les références nombreuses à l’océan (Port Gentil, Nautical Zone, etc.). Certains seront pris de mal de mer, d’autres seront bercés, l’aspect hypnotique est indéniable. Parfois il en faut peu pour être heureux. |

Amanda Palmer & The Grand Theft Orchestra
Theatre is Evil
Il est toujours difficile de décider si on adore ou si on déteste Amanda Palmer. Peu de personnalités se révèlent aussi polémiques dans le paysage musical d’aujourd’hui. On aime Amanda Palmer pour ses débuts avec les Dresden Dolls. Mais on est aussi épuisé par son omniprésence médiatique, la suivre sur Twitter c’est s’exposer à un spam continu. En retour, l’artiste a instauré une proximité rarissime avec ses fans avec lesquels elle ne cesse dialoguer. C’est grâce à un appel à contributions auprès d’eux qu’elle a obtenu pas moins d’un million de dollars pour concevoir son nouveau disque. Exhibitionniste, punk et diva, Amanda Palmer est la version vraiment freak de Lady Gaga. Du genre à collaborer (nue) avec les Flaming Lips, à épouser Neil Gaiman et à ne reculer devant rien, ni le ridicule, ni le génie.
La preuve avec ce nouvel album solo, en compagnie de musiciens enveloppés sous le patronyme de Grand Theft Orchestra. Financé entièrement par les fans, Theatre is Evil n’est pas un vol caractérisé, au contraire. 71 minutes, spectaculaires, denses et variées, qui dessinent le sommet de la carrière de l'artiste. Les balades piano et voix de l’époque Dresden Dolls sont bien présentes, mais le spectre sonore s’est enrichi, comme le démontre la tonitruante entrée en matière de Smile. Même lorsqu’elles se font intimes (le Bowiesque Grow Man Cry, Trout Heart Replica, le magnifique The Bed Song, Berlin), les chansons gardent une énorme présence et regorgent de détails. Les tubes évidents (Do It With a Rockstar, Want it Back, Massachusetts Avenue, Melody Dean, Olly Oxen Free) sont nombreux et peu avares en surprises et autres contre-pieds.

Qualité des textes et des gimmicks, charisme au maximum, Amanda Palmer transcende son envahissante énergie à grands coups de générosité. Peu de disques peuvent se vanter de respirer autant la liberté et l’altruisme. C’est un cri du cœur envers les groupies et les amoureux transis, un cadeau pour tous les fans. Et au-delà du simple remerciement, c’est une vraie œuvre d’art, un enchaînement non stop de morceaux théâtraux, baroques et sublimes. Amanda Palmer se révèle attachante et même émouvante. D'un coup, tous les excès sont justifiés et pardonnés. Petits ados, petites ados, si vous devez avoir une égérie, faites que ce soit celle-ci. |

Dan Deacon - America
On ne peut pas retenir les génies. Ca leur prend parfois du temps, mais ils finissent généralement par aller là où ils le souhaitent. Dans le cas de Dan Deacon, on se demande si ce long cheminement est conscient ou non. Le bonhomme, de formation classique dans un conservatoire de New York, compose depuis le début des années 2000 une musique hors normes, tout simplement un joyeux bordel de sons rigolos et d'idées saugrenues. Au fil de concerts épiques, le culte s’est érigé. On aime Dan Deacon pour ses élans festifs et sa folie. On aime Dan Deacon pour les univers incroyables qu’il dessine à coups de bip-bip et de voix étranglées. Spiderman of The Rings et Bromst laissaient entrevoir des ambitions allant bien au-delà du gag. Réécouter pour cela les douze minutes de Wham City.
America est une nouvelle étape vers un accomplissement qui semble inévitable : Dan Deacon compose de l’opéra électronique, des symphonies pour Game Boys, des épopées pour synthétiseurs cassés. La seconde moitié de ce nouvel album est une longue suite en quatre parties, monument évoquant l’émerveillement que procure la traversée des USA en long en large et en travers. Avec le surgissement d’un orchestre classique au milieu des déchirements électriques, la musique n’a aucun mal à créer des images puissantes. On est à mi-chemin entre Sufjan Stevens et Godspeed You! Black Emperor ; avec une liberté encore plus vaste et un humour omniprésent. Car il y a toujours quelque chose d’humble chez Dan Deacon, même quand il peint des fresques. Comme le prouve la première partie d’America qui délivre des petites choses plus traditionnelles, du moins pour du Deacon, avec en particulier un vrai petit tube, True Thrush. Mais dès les premières minutes, on sent que le compositeur est déjà ailleurs. Malgré son ampleur, America n’est encore qu’une promesse. Le meilleur est à venir. Ca va être bien. |

Jens Lekman - I Know What Love Isn't
Jens Lekman est notre part de romantisme. L’artiste suédois incarne notre lyrisme enfoui, ce petit quelque chose d’adolescent qu’on appelle fleur bleue. Avec humour et évidence, ses textes expriment les sentiments qu’on croit toujours morts et enterrés depuis la dernière fois qu’on a eu le cœur brisé. Mais voilà : “You don't get over a broken heart You just learn to carry it gracefully”. Une nouvelle fois, Jens Lekman offre une multitude de citations pour souffrir en riant, pour effleurer la nostalgie avec ironie, pour oublier en se remémorant. I Know What Love Isn’t n’est pas le monument Night Falls Over Kortedala. Ici tout se pare de discrétion, la superproduction intime a laissé place à une musique plus classique. Cependant les chansons demeurent magnifiques, avec leurs arrangements luxueux et leurs mélodies entêtantes. Mais après les expériences et le faste de l’album précédent (disque de l’année 2007 sur ce site), la première moitié de ce nouvel opus joue la carte de l’apaisement, de la simplicité. Jens cède juste à la mode du solo de saxophone, décidément incontournable.
Ce n’est qu’à partir de Some Dandruff On Your Shoulder que le disque prend son essor et déploie tous ses trésors sonores et textuels. S’enchaînent alors quelques unes des plus belles chansons de 2012 (The World Moves On, The End of The World Is Bigger Than Love, Every Little Hair Knows Your Name…). Attention cela ne veut pas dire que l’album n'est qu'à moitié réussi, loin de là. Au contraire, c’est un crescendo, une montée en puissance irrésistible. Là où Night Falls Over Kortedala était un sommet uniforme, I Know What Love Isn’t choisit une approche plus mesurée, qui finit par flirter aisément avec les chefs-d’œuvre de l’opus précédent. Le Morrissey des années 2000 nous fait de nouveau fondre. Son mélange de premier et de second degré, cette distance polie entre dérision et douleur, abattent nos murailles de cynisme. Non, nous non plus on ne sait pas ce qu’est l’amour, mais cela doit probablement ressembler à une chanson de Jens Lekman. |
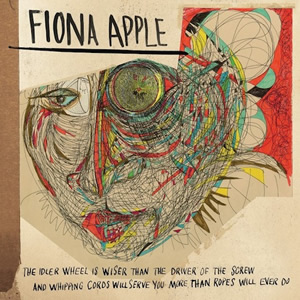
Fiona Apple - The Idler Wheel...
Si 2011 fut l’année du retour en grâce de PJ Harvey, 2012 sera placée sous le signe de Fiona Apple. Avec son quatrième album en 16 ans de carrière, et le premier depuis 7 ans, la chanteuse a su se faire désirer et créer une base de fans transis et fidèles. Il faut avouer que sa personnalité, mélange de sincérité absolue, de sentiments épidermiques et de malaise diffus, a tout pour séduire les amateurs de chansons qui touchent au cœur. Dès le premier morceau de The Idler Wheel, on se souvient. Fiona Apple a trouvé sa place, quelque part parmi les innombrables descendantes de Kate Bush et de Patti Smith. C’est son album le plus dépouillé, le plus personnel et le plus intemporel. Les arrangements se contentent du minimum : piano, voix, percussions et quelques fioritures souvent surprenantes. L’accent est donc mis sur Fiona, ses textes, son âme, ses métaphores ou ses aveux qui saisissent à la gorge. A l'image du morceau d'ouverture, Every Single Night, au vidéo clip en forme de cauchemar éveillé.

The Idler Wheel plonge dans l’intime pour en faire surgir la quintessence. Du classique « I love you, you, you, you » au « How can I ask anyone to love me, when all I do is beg to be left alone », en passant par le terrible « I ran out of white doves' feathers to soak up the hot piss that comes from your mouth every time you address me », les confessions ne se parent d’aucune pudeur inutile. La musique de Fiona Apple n’en est pas moins d’une élégance totale, d’une justesse bouleversante. C’est un disque audacieux, accessible mais insaisissable. Tous les ingrédients d’un chef-d’œuvre incontournable. |

La Sera - Sees the Light
L’éternelle revanche de la pop. Attention, ça va aller très vite. 30 minutes, 10 chansons, une moyenne de 3 minutes. La voix toute mignonne, les rythmes sympas, les mélodies grosses comme ça et des guitares qui scintillent. En ligne de mire, je vous le dis, on devine Blondie et les premiers Pretenders. C’est de l’or en barre, que voulez-vous ? Irrésistible. Surtout avec la petite touche mélancolique qui fait débuter ce deuxième opus par une chanson toute tristoune mais tellement belle (Love That’s Gone). Avant d’embrayer sur l’un des singles de 2012, Please Be My Third Eye. Quand on écoute Katy Goodman (des Vivian Girls), tout cela paraît si simple, si évident. Alors pourquoi toute la pop n’est-elle pas de ce niveau ? Hein ? Si c’est si facile de composer des miniatures qu’on a l’impression de connaître depuis toujours. Pourquoi est-ce qu’on ne nous inonde pas de ces merveilles par l’intermédiaire des robinets à clips des télévisions sinistrée ? Pas besoin d’aller chercher la réponse. Non, sortir un album de cette trempe n’est pas donné à tout le monde. Merci La Sera, merci Katy. |
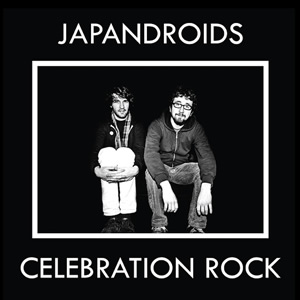
Japandroids - Celebration Rock
Cet album rend lyrique. Faites un tour des principaux sites de musique du web (Pitchfork, Stereogum, Tiny Mix Tapes & co), vous tomberez sur des critiques qui partent en vrille, ou du moins qui se sentent pousser des ailes. Il faut dire que le deuxième album de Japandroids s’approche dangereusement de l’idéal rock. 30 minutes d’énergie pure, avec les grosses guitares et la batterie qui cavale. Des chansons grandes comme le monde et des refrains de géants. Le point d’orgue est The House That Heaven Built, sérieux concurrent au titre de single de 2012. Tout y est. En particulier le refrain à base de « oh oh oh ohohoh ! ». C’est une plongée dans un torrent, l’impression de foncer à toute vitesse au volant d’un bolide, c’est une fusée et surtout, comme annoncé en prélude du disque, c’est un feu d’artifices. Celebration Rock que cela se nomme, enfin, sérieusement, on ne peut pas dire mieux. Forcément, l’esprit critique se retrouve tout embrumé. Trop fort, trop adolescent, trop rock’n’roll. My my hey hey, ce sacripant ne mourra jamais. |

Chromatics - Kill for Love
A l’image de M83 l’année passée, Chromatics étend ses ailes avec son dernier opus. Les promesses de Night Drive se trouvent confirmées au fil d’un long album conceptuel, nouveau voyage nocturne au fil des routes qui plongent dans l’inconnu. Le cœur de Night Drive contenait une reprise de Kate Bush, Kill For Love s’ouvre sur une chanson de Neil Young. A la fois très proche de la version acoustique de Into The Black, cette relecture s’en éloigne suffisamment pour en assurer une appropriation rêveuse. Cette douceur onirique habite les 77 minutes de l’album, même lorsque les guitares s’amoncellent ou que les rythmes martèlent. Dans un mouvement purement cinématographique, Kill For Love abandonne peu à peu les structures classiques et les chansons s’évanouissent. D’amples instrumentaux atmosphériques viennent flirter avec le silence et la palpitation des phares qui sillonnent les villes endormies. Johnny Jewell, le démiurge de Chromatics, trouve ici la juste balance entre accessibilité et expérimentations. Il nous attire par des refrains grandioses puis nous fait basculer dans son univers. Bien sûr, les échos des années 80, de New Order et de Kraftwerk, sont toujours omniprésents, mais c’est là le son dominant de notre époque. Avec au final l’un des albums les plus séduisants de l’année 2012. |

Beach House - Bloom
Votre serviteur n’a jamais dissimulé son amour pour la « dream pop » et ses semblables. Mettez-moi du post-rock, post-punk ou de l’ambient dans les esgourdes et vous avez de fortes chances de me plaire. Le principal risque du genre étant de sombrer dans l’insipide et le ronronnant. En l’espace de quatre albums, le duo Beach House s’est imposé comme le groupe actuel phare du genre. Tout y est : les belles mélodies, l’atmosphère vaporeuse, les réverbérations infinies, la jolie voix, la douce étrangeté, la mélancolie adolescente. Rien ne manque. Cette impression de perfection, qui de prime abord pourra sembler un peu trop lisse et glacée, gênera certains auditeurs. On est pourtant avec Bloom dans la quintessence d’un genre. Le vrai débat se situe essentiellement dans une polémique pour les décennies à venir, à savoir : quel est le chef-d’œuvre : Teen Dream, sorti en 2010, ou Bloom. Dans les faits, Bloom a des allures de Teen Dream 2, tant les similitudes sont nombreuses. Pour les départager, tout sera question de sensibilité, d’expériences personnelles et d’affinités avec les différents morceaux. On retrouve ici les dignes successeurs de Zebra (Myth) ou de Used to Be (Lazuli). Les chansons sont toutes d’un niveau exceptionnel et forment un point d’orgue constant. Le groupe tient une formule et ne la lâche pas. Encore mieux, ils osent le revival 90's absolu en planquant un morceau à la fin de l'album, après le long silence où résonnent encore les échos de l'incroyable rythmique d'Irene. Jusqu'où pourront-ils nous promener ainsi ? Pour l’instant, on n’a toujours pas envie de s’éveiller de cette pop de rêve. |

Death Grips - The Money Store
De temps à autres surgissent des albums dont on perçoit immédiatement l’importance, voire le côté révolutionnaire, mais qui se révèlent plutôt déplaisant à écouter. Certains groupes essentiels se sont fait une spécialité de ce genre de pratique (les japonais de Boris, par exemple). Dans le cas de Death Grips, on flirte avec une limite. Les morceaux sont globalement accessibles, en particulier pris les uns indépendamment des autres, mais sur la durée The Money Store est un vrai et littéral casse-tête. Le post-hip-hop-electro-doom-rap-punk du groupe ne ressemble pas à grand-chose de connu, dès Get Got, on est ailleurs. Là où tant d’autres sniffent la ligne des années 80, que certains commencent à s’ébattre dans les années 90. Death Grips est déjà dans les rues des mégalopoles de 2030. On imagine sans mal cette musique surgir des ghettoblasters des cyberpunks et autres racailles du futur. C’est violent et fun, bruyant et bizarre. On s’y sent perdu, tourneboulé, amusé et agressé, tout en même temps. Les « tubes » que sont I’ve Seen Footage et surtout le détraqué Hacker nous projettent dans un ailleurs entre excitation et terreur. Quelque chose est en marche ici, probablement la prochaine métamorphose de la musique populaire. Le choc est rude, mais les lendemains ne cesseront jamais de chanter.
|

The Walkmen - Heaven
Puisse cette humble critique être un chant d’amour ! Oui, puisse-t-elle simplement vous donner envie de vous plonger et de vous replonger dans la discographie exemplaire de The Walkmen. A l’image d’autres groupes d’exception, que tout le monde respecte, mais qui n’ont jamais accédé au succès interplanétaire que tout leur promettait (Spoon, suivez mon regard), The Walkmen ce sont 7 albums en 11 ans de carrière, tous aussi bons les uns que les autres. De leur premier opus (Everyone who pretended to like me is gone) jusqu’à Lisbon en passant par Bows + Arrows, leur constance mérite toutes les louanges. Mais le risque d’être irréprochable est finalement de passer de plus en plus inaperçu. On se dit : « ah voilà le nouveau Walkmen, toujours aussi chouette ». On l’écoute, on prend du plaisir et on passe à autre chose.
Sonnant comme un aboutissement, une sorte de bilan d’un peu plus d’une décennie d’existence, Heaven est le disque idéal pour dépasser l’accueil poli et rappeler que The Walkmen ne font pas seulement partie des valeurs sûres. Ce groupe a du génie. Et au fil de 13 chansons magnifiques, on ne cesse de se souvenir pourquoi on les aime tant. Il y a du cœur dans cette musique, une âme. Le petit quelque chose en plus qui fait toute la différence. Est-ce que cela s’explique ? Les structures sont connues, les arrangements aussi. C’est un groupe de rock. Tout ce qu’il y a de plus classique. Et pourtant les chansons ne ressemblent à aucune autre et font vibrer toutes les cordes des sentiments. Aimez The Walkmen, réjouissez-vous de leur existence et délectez-vous de ce Heaven tombé des cieux. |

Confessions (Kokuhaku) - Soundtrack
Mélange de douceur, de kitsch, de lyrisme et de violence, la bande-originale de Confessions (Kokuhaku) est exactement à l’image du film qu’elle accompagne. Sophistication absolue et grand écart permanent sont au programme, jamais vraiment loin de la maladresse ou de l’excès. Ici de la J-pop rebondissante, là de l’indie rock planant (Radiohead et The XX), quelques bribes de classique (Bach, forcément). Surtout l’omniprésence du groupe expérimental Boris, perle de la scène musicale japonaise, qui apparaît sur pas moins de 6 morceaux sur les 19 du disque. Véritables stars du disque, les gars de Boris collent des frissons à coups de guitares qui cisaillent, d’envolées métalliques ou d’atmosphères minimales. Premier et second degré cohabitent autant sur cette soundtrack que dans l’œuvre de Tetsuya Nakashima, mais ici avec une cohérence encore plus évidente. Ce qui permet à la musique d’exister comme un tout indépendant, bien au-delà des images. C’est une expérience en soi et surtout une formidable réussite en matière de BO compilation, dont l’homogénéité, malgré toutes les émotions abordées, s’avère exceptionnelle. Indispensable, même sans avoir vu ou aimé le film. |
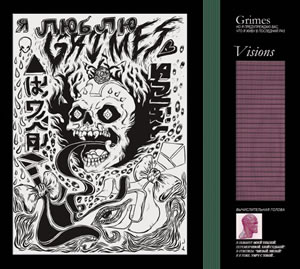
Grimes - Visions
C’est la star de ce début d’année, et la vague pourrait l’amener très haut jusqu’à la fin de 2012. Claire Boucher, alias Grimes, canadienne de tout juste 24 ans, s’est transformée en coqueluche planétaire. Sa musique, électro régressive joyeuse et complexe, fait danser d’un bout à l’autre du globe. A la première écoute, Visions laisse perplexe. Un peu trop long, gentiment foutraque, l’album oscille entre le coup d’éclat et le coup dans l’eau. Surtout, il faut dépasser l’impression d’entendre parfois un vieux Madonna. La voix de souris qui couine, les synthés pip-pip, les boîtes à rythme maigrichonnes… Le tube Oblivion, c’est Lucky Star et Material Girl qui grelottent dans la cave. Il faut laisser le temps à cette musique de faire sa place. Car elle ne manque pas de personnalité, à l’image de la chanteuse, petite chose comico-trash, attachante et timbrée. Probablement émouvante, derrière toutes ses frasques où flotte le parfum des années 90 extasiées.
On est convaincu sans hésitation par des morceaux comme Eight, dans lequel Kraftwerk percute le fantôme de Britney Spears. De même avec le défilement rêveur de Symphonia IX ou les atermoiements psychédéliques de Skin qui voisinent avec le travail de Julia Holter. Tendu entre ambitions sonores et envie d’amuser, la musique de Grimes peut probablement aller encore plus loin dans l’éclectisme et la maîtrise. Visions est néanmoins un accomplissement remarquable, qui ne cesse de se dévoiler au fil des écoutes. Laissons-lui du temps et revenons en fin d’année, voir si 2012 appartient vraiment à Claire Boucher. Pour ma part, je ne lâche pas mon Ekstasis… |

Julia Holter - Ekstasis
« This plane is taking off », murmure Julia Holter au cœur des huit minutes de Boy in the Moon. Comme un écho au Music for Airports de Brian Eno ? Probable, surtout que ce morceau s’envole lentement dans l'ambient, la voix s’effaçant peu à peu dans les douces nappes de synthétiseurs. Mais il est difficile de réduire Ekstasis à un genre particulier. Bien sûr, au fil des chansons on reconnait Broadcast ici (Für Felix), Julianna Barwick là, et beaucoup d’expérimentations issues des années 70. Cotonneuse et électrique, la musique de Julia Holter adore l’école buissonnière. Tout est possible, comme le prouve par exemple Four Garden, déconstruit de partout et pourtant suspendu à une petite mélodie entêtante. Vocodeur, free jazz ou pop qui claudique, Ekstasis surprend et déconcerte. Le disque est de la trempe des œuvres tellement riches qu’il faut lui donner le temps de faire sa place. Atmosphère, atmosphère, oui, il a une gueule d’atmosphère. Sa sophistication et sa complexité en déconcerteront plus d’un, l’écouter d’une oreille distraite ne fera qu’effleurer la surface. Derrière le miroir, c’est toute une cité de cristal qui bruisse, tout un univers miniature qui s’étend. |

Lana Del Rey - Born to Die
Elizabeth Grant avait presque tout d’une grande. Son premier album sympathique et prometteur fut refusé par les producteurs qui réclamaient plus de glamour. Et elle allait leur en offrir, jusqu’à l’overdose. Elizabeth a donc changé de nom. Et de tête. Plastic Woman est née. Et dans une histoire comme les affectionne notre époque, elle a surgi sur internet. Le funèbre Video Games a scandé les journées déprimées de 2011. De sa voix lasse, Lana Del Rey a chanté l’oraison d’Amy Winehouse. Et le triomphe du plastique. Sur cet album que reste-t-il après la vitrification ? Le sublime Video Games, bien sûr, et ses petites copies (la chanson Born To Die, en particulier). Puis le remplissage, avec des tubes taillés pour NRJ et qui sonnent comme Rihanna sous Lexomil (les affreux Diet Mnt Dew et National Anthem, l'immonde Off to the Races). Déjà essoufflée, ou à moitié endormie, Lana Del Rey remplit son contrat avec le service minimum. Le genre de disques construit autour d’un single, décliné, digéré, puis expurgé. Ce que la beauté abîmée de Lana Del Rey et de sa musique disent sur notre époque ne va sans doute guère loin. En reflet, il en ressort une infinie tristesse où s’ébat une poupée maladroite, mal à l’aise dans son rêve devenu réalité. C’est déjà le chant du cygne de Lana Del Rey, du mannequin de cire brisé pourrait renaître Lizzy Grant, la gamine qui fantasmait Hollywood et son désenchantement dans la pénombre de sa chambre. |

Sleigh Bells - Reign of Terror
Dans la pop comme en toute chose, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Les années 2010 se bâtissent sur les souvenirs des pires heures des années 80. James Blake fait du Lionel Richie désincarné, Lady Gaga fait du Meat Loaf sous amphétamines, Chairlift fait du Ah-Ha, Destroyer se prend pour Roxy Music. Des synthés légers, des guitares de métal chevelu, des saxophones partout (M83 et Bon Iver, même combat). On en est là. Il y a 15 ans, toutes ces influences étaient l’ennemi à abattre. On écoutait Nirvana et les Pixies, on vomissait Human League et Guns & Roses. Mais un instrument n’est qu’un instrument, et, bien utilisés, un accordéon, un saxophone et une guitare grasse ne sont pas les enfants du Diable. Tout cela pour dire que, sur le papier, on peut tout craindre d’un groupe comme Sleigh Bells. Des déclarations adolescentes façon Spinal Tap où le duo se présente comme « le groupe qui joue le plus fort », jusqu’à ce mélange entre bruit saturé et voix sucrée.
Le premier album, Treats, explosait telle une bombe. Heavy métal bubble pop, hard rock R’n’B, pendant une demi-heure les déflagrations succédaient aux gimmicks. Sentiment merveilleux d’écouter quelque chose de vraiment nouveau. Pourtant, les éléments, pris séparément, nous sont très familiers. Reposant sur l’énergie pure et le choc, la musique de Sleigh Bells risquait de montrer fort vite ses limites. Le second album s’avère toujours terrible à concevoir. Malgré l’amour qu’on pouvait porter à leur premier opus, on ne donnait pas vraiment cher de leur peau. Après tout, il y a quelque chose de très immature à hurler sur des empilements de guitares et des boîtes à rythme excitées. Contre la plupart des attentes, Sleigh Bells a fait le bon choix.

Et ce n’est pas celui de la surenchère. Plutôt que de chercher à enfoncer le clou en poussant les amplis à 12, le duo se concentre sur l’essentiel : les chansons. Quitte à lever fréquemment le pied et à revenir vers des territoires plus connus, celui de la noise pop et du shoegazing. Des morceaux comme Road To Hell et You Lost Me ne sont pas si éloignés de My Bloody Valentine et de Slowdive. Certes, il y a toujours cet esprit frondeur et cet amour pour le bon vieux métal qui n’appartiennent qu’à Sleigh Bells. Les titres des chansons semblent sortis d’un album solo d’Ozzy Osbourne (Born to Lose, Crush, Demons, Never Say Die, D.O.A.). La plus grande surprise étant de voir l’album glisser doucement mais sûrement vers un univers plus nuancé, plus, osons le terme, sérieux. Peut-être même plus sentimental. Mais du sentimental ténébreux, moins décérébré et festif.
On parlera ainsi beaucoup de l’évolution annoncée par les deux derniers morceaux de Reign of Terror, qui tendent à faire pencher le groupe vers une sorte d’industriel R’n’B, voire de black métal bubble pop. C’est probablement ce qui amuse le plus lorsqu’on parle de Sleigh Bells : jouer à inventer de nouvelles étiquettes, de nouveaux genres, pour mieux balayer les classifications. Oui, chacun y entendra des choses très différentes, les fantômes d’Atari Teenage Riot ou ceux de Michael Jackson. Cette musique pourrait réconcilier aussi bien les gamines de 14 ans que les vieux hardos de 40. On s’y perd, on ne sait plus, c’est si bon.

Mais trêve de pédagogie, après tout ce qui compte c’est la musique. Ecoutez donc le morceau d’introduction, True Shred Guitar, qui vous donne l’impression d’être au milieu d’un concert de Def Leppard en 1988. Et Crush, hein ? Une sorte de tube improbable, pour teenagers, ou fans de M83. Rassurons les amoureux de Treats, le single Comeback Kid est ce qui ressemble le plus à ce premier album. Mais là où Sleigh Bells risque de ravir un nouveau public c’est avec Demons et Never Say Die. Du bruit qui fait peur. Avec la voix d’Alexis Krauss. Du bruit qui fait peur et qui pourrait passer sans problème sur NRJ12. Ce n’est pas le son du futur, ce n’est pas James Blake, c’est le son d’aujourd’hui, de maintenant, de tout de suite. La cavalcade d’une urgence juvénile qui s’effondre peu à peu dans la mélancolie angoissée. On le prenait sur le ton de la blague, mais le règne de la terreur vient de commencer. |

Chairlift - Something
Faut-il avoir peur de la pop en 2012 ? Bien sûr, si on allume les chaînes « musicales », on peut répondre par l'affirmative. Il suffit de regarder Lady Gaga brûler des voitures, se rouler nue dans la boue et crier comme une damnée sur du "Hair Metal" pour voir ressurgir les pires heures des années 80. De Katy Perry à Rihanna, on navigue entre Mötley Crüe et Culture Beat, avec des hurlements féminins en prime. Pourtant cette nostalgie pour les années 80 et le début des années 90 ne crée pas que des monstres, ou alors de jolis monstres, comme The Knife ou Austra. Chez Chairlift, on a choisi une voie plus simple. On veut faire plaisir, en sonnant comme en 1984, mais avec les moyens d’aujourd’hui. Dans le son et les intentions, c’est propre, net et attendrissant ; il faut probablement avoir des faiblesses pour Eurythmics ou Buggles pour comprendre.
L’electro-pop est capable du meilleur comme du pire, le tout c’est d’avoir la bonne chanson. Au moins une, un tube, genre Take On Me de A-Ha, par exemple. C’est déjà ça. Quand on a de nombreuses bonnes chansons, là, on devient dangereux, on a du potentiel, on est là pour rester. Avec ce second album, négligemment nommé Something, Chairlift s’impose, c’est du sérieux. Un morceau d’ouverture conquérant, Sidewalk Safari, avec les petits riffs de synthétiseurs qui claquent, presque du Bangles, rien qu’à la voix de Caroline Polachek. Mais on entre dans le vif du sujet avec Wrong Opinion. Une petite intro toute en douceur et une grosse explosion de guitares bien kitsch sur le refrain. Il faut avoir été jeune devant MTV pour savoir…

A partir de cet instant, on est conquis. On se dit qu’avec des chansons comme ça, Drive aurait été bien meilleur. L’album est sur orbite, le point pivot étant l’autre tube absolu, Amanaemonesia (à vos souhaits). Entre temps, le groupe nous aura servi le plus bel hommage à Take On Me (I Belong in Your Arms), un fantastique exercice de réhabilitation de l’été 1985 (Take It Out On Me et son refrain cinq étoiles), une ballade nocturne pour aller claquer des doigts sous les néons roses fluo (Ghost Tonight), un slow rêveur pour émouvoir la midinette (Cool As a Fire).
Attention, la fin de Something réserve encore des perles : le pétaradant Met Before et l’aérien Turning en particulier. Le tendu Guilty As Charged clôt l’album sur une interrogation : ce groupe n’était pas aussi innocent qu’il en a l’air ? En tout cas Chairlift a de l’ambition et leur travail, aussi évident qu’il semble être, est celui d’orfèvres pop. Le potentiel dévoilé ici est immense et ce disque va nous accompagner tout l’hiver et sans doute bien au-delà des premiers jours du printemps. A ne pas manquer, à ne pas snober, du moment qu’on a une certaine tendresse pour les chansons qui donnent envie de fredonner maladroitement sur leur refrain… |

James Blake - Love What Happened Here
Entamons 2012 comme nous avions débuté 2011, sous les bons augures de James Blake. Le petit bonhomme trouvant que, bon, allez, ça suffit comme ça avec son album qu’il juge trop accessible, il a décidé de remettre tout à plat avec un petit Ep de trois titres joueurs et expérimentaux, où l'on entend par moments les échos des grandes heures du label Warp. Coup de maître, en particulier grâce au morceau Love What Happened Here. Tour à tour ludique, farfouilleur, cool et bien barré, cet exercice d’un peu plus de cinq minutes étend les possibilités déjà impressionnantes de Blake. Un instrumental avec quelques fragments vocaux traités comme des samples, cela pourrait sembler austère après les débauches lyriques de l’album, il n’en est rien. James Blake, chantre de la déstructuration et de la disparition, nous file encore entre les oreilles. C’est lui, sûr et certain, mais il est déjà ailleurs. Combien de temps pourra-t-il fournir une telle créativité ? Impossible à dire, aucun signe d’épuisement à l’horizon. Au lieu de profiter du succès critique et public, l’artiste repart à la recherche de nouveaux sons, de nouvelles constructions, de nouveaux chemins. Ce que James Blake crée, les Lady Gaga et Rihanna de l’an 2020 le feront probablement aussi. Mais vous pouvez déjà être dans ce futur avant les autres. Demain, en mieux. Ecoutez James Blake. |
|
|