|

88 minutes
de Jon Avnet
Après des années d’une course-poursuite des plus paradoxales, Al Pacino vient de rejoindre son comparse Robert De Niro au même niveau de médiocrité artistique. Certes, ce n’est pas l’interprétation de l’acteur qui est en cause, le cabotinage à l’œuvre dans ce 88 minutes étant encore loin d’égaler celui du gros Bob. Mais avec ce polar du troisième âge, Pacino hésite entre le changement de créneau (en imaginant que ses fans ont aussi dépassé la soixantaine) et le foutage de gueule explicite. Incohérent, improbable et souvent grotesque le film de Jon Avnet ne réserve même pas le minimum syndical en termes d’explosions, de suspens et autres fusillades. Al galope pendant 30 secondes dans un parking souterrain, mais c’est pour mieux se poser 10 minutes dans d’interminables dialogues qui ne mènent nulle part. En cela, 88 minutes s’avère assez voisin du 16 blocs de Richard Donner, qui utilisait aussi un temps réel totalement mensonger pour mieux traîner péniblement Bruce Willis d’une ruelle à l’autre. Le grand avantage de 88 minutes par rapport à cet autre nanar c’est que Mos Def est remplacé ici par une ribambelle de bimbos (dont la toujours ravissante (mais nulle) Leelee Sobieski). Ce grand coquin de Al s’est visiblement fait plaisir, jouant les vieux beaux pour les jolis yeux de ses partenaires énamourées. Pour boucler la boucle, on notera que Pacino et De Niro se retrouveront bientôt côte à côte, pour une rencontre une nouvelle fois historique et devant la caméra de… Jon Avnet… |

Amer béton
de Michael Arias
Adaptation du manga culte de Taiyo Mastumoto, Amer béton est une demie réussite où se confrontent deux points de vue pas forcément conciliables. D’un côté le professionnalisme du réalisateur Michael Arias, formé aux effets spéciaux à Hollywood, et qui crée ici son premier long-métrage. De l’autre, le studio 4°C, vivier créatif impressionnant, responsable de l’un des films d’animation les plus originaux de ces dernières années : Mind game. Si l’on reconnaît immédiatement le design du studio, ainsi que les pointes de surréalisme qui forment le meilleur de Amer béton, on ne peut que regretter le manque de rythme d’une œuvre aussi longue (près de 2 heures) qui adopte parfois le découpage d’une série télévisée (cliffhangers et personnages secondaires à l’appui). En ce sens, le film de Michael Arias rappelle parfois l’univers urbain chaotique et violent du Paranoïa agent de Satoshi Kon. Par ailleurs la symbolique assez évidente de l’histoire (Blanc/Noir et leurs rêves/cauchemars) ne parvient pas toujours à coïncider avec les idées les plus délirantes (comme les surhommes destructeurs aux origines improbables). Mais lorsque 4°C prend le dessus, en particulier lors d’un dernier quart d’heure d’une grande puissance, Amer béton intrigue et séduit. Soutenue par une excellente musique électronique du groupe mythique Plaid, l’œuvre est le point de départ idéal pour découvrir le travail unique du studio et offre une transcription visuelle adéquate du manga. |

Belle toujours
de Manoel de Oliveira
En signant une coda au Belle de jour de Luis Buñuel, Manoel de Oliveira (98 ans au moment du tournage) réalise un pur fantasme de cinéma qui parvient à éviter tous les pièges d’une démarche aussi prétentieuse. En un tout petit plus d’une heure, le metteur en scène portugais cisèle un post-scriptum doucement cynique et d’une cruauté enjouée. Les deux héros du film de Buñuel ont tant vieilli que leurs archétypes se sont effondrés sur eux-mêmes. Il ne reste plus que le radotage alcoolisé de Michel Piccoli (formidable) et la vindicte coupable de Bulle Ogier (qui remplace Deneuve). Les excès sadomasochistes de Belle de jour ne sont que des ombres, des gimmicks (la boîte qui bourdonne, un coq de la période mexicaine…) et surtout des dialogues un peu creux, un peu faux, récités dans un bar improbable ou dans un restaurant au luxe comique. Belle toujours tutoie le sublime dans ses moments de silence ou lorsque les images supplantent la parole.
Durant la majeure partie du film, Piccoli erre dans Paris, un souvenir le hante, s’accroche à son existence devenue fantomatique. Le plaisir de faire une nouvelle fois souffrir la femme qui l’obsédait, c’est un dernier acte de perversion raffinée. La scène du dîner est comme accélérée au-delà du réalisme, pour mieux s’effacer dans la pénombre des bougies qui meurent. Ce crépuscule des êtres, quand la fiction atteint son point limite et que le « chef-d’œuvre » ne peut plus être complété, flirte avec le génie. Oliveira, humblement, avec humour, préfère disparaître à son tour et renonce à se proclamer l’égal de Buñuel. Cette modestie dans l’apothéose est la plus grande réussite de Belle toujours, qui s’affirme comme une rêverie sur pellicule, du genre qu’affectionnait tant le réalisateur de Viridiana. |
|

Black snake moan
de Craig Brewer
Sexe, blues et obsession, la note d’intention de Black Snake Moan avait de quoi allécher l’amateur de cinéma d’exploitation. La promotion du film insistant largement sur le côté « pulp » (Samuel L. Jackson à l’appui) et sulfureux (Christina Ricci en « white trash » esclavagisée), promettait une œuvre décadente et excitante. Les espoirs sont malheureusement très vite déçus par une longue mise en place de près d’une heure, à peine sauvée par un numéro outrancier de la miss Ricci qui se donne toute entière à son rôle de nymphomane. Les fans seront aux anges, tant leur égérie déploie un charisme érotique aussi malsain que fascinant. Mais cette présentation s’étale un peu trop longuement, insistant sur l’aspect hautement cliché des personnages. Nous sommes dans le domaine des archétypes et il était sans doute inutile de s’étendre aussi longuement sur des figures aussi connues.
Enfin, Christina est attachée, Samuel va lui donner une bonne leçon de vie. La misogynie latente de Black snake moan éclate alors dans toute sa splendeur. Pour calmer les ardeurs des gourgandines, rien ne vaut une bonne mise au pas à l’ancienne. Cette trop courte partie de bondage au sadisme moite constitue le meilleur du film. Malheureusement au bout d’une grosse demi-heure, comme choqué de ses propres audaces, le réalisateur Craig Brewer redonne sa liberté à la donzelle et entame une lente plongée dans la guimauve. Le pire est évité de justesse, le blues débarquant enfin en force dans le métrage en proposant à Samuel Jackson des séquences taillées à sa mesure. La scène de la chanson « black snake moan », le sommet du film, vaut à elle seule le déplacement. Intensément électrique, transcendée par l’interprétation d’un Jackson habité, elle trouve enfin l’âme du blues et de ce Sud des Etats-Unis fantasmé. Le concert qui la suit, bien qu’un peu trop filmé comme un clip de r’n’b pour MTV, réserve encore quelques frissons, mais ne parvient pas à retrouver cette magie noire éphémère.

De manière encore plus inattendue, la conclusion du métrage hésite entre un happy end de comédie romantique et une dernière percée de psychiatrie douteuse. Le propos de Craig Brewer risque de faire hurler les féministes, cela fait bien longtemps que l’on ne nous avait pas affirmé que la sexualité des dames est en fait une maladie que l’on ne peut soigner qu’en serrant littéralement les liens du mariage. Déséquilibré et n’assumant pas totalement les aspects les plus scandaleux de son sujet, Black snake moan séduit néanmoins par la classe de sa mise en scène, sa bande originale très « roots » et par l’excellence de ses interprètes. Mais le choix de privilégier l’aspect moral de l’œuvre au détriment de la simple jouissance sensorielle risque de laisser plus d’un spectateur sur sa faim. |

Le Candidat
de Niels Arestrup
Sortant quelques jours avant le premier tour des élections présidentielles, Le Candidat se rêve sans doute polémique, tel un petit pavé dans la mare médiatique d’une campagne de plus en plus américanisée. Dans l’espoir de faire revivre les grandes heures du cinéma politique à la Costa Gavras, Niels Arestrup situe son histoire dans une France plus proche des années 70 (débat télévisé façon FR3 Picardie à l’appui) que de notre époque. Vague intemporalité qui contribue à désamorcer la crédibilité d’une histoire d’un manichéisme grossier sur l’air douteux du « Tous pourris, tous complices, tous coupables ». Le candidat campé par Yvan Attal semble être le dernier brave gars encore en activité dans le monde politique et si on l’a soutenu jusqu’au second tour c’est pour mener le gentil agneau en sacrifice, sans risque pour les autres. « On » c’est Arestrup lui-même, vague magnat fumant de gros cigares, roulant en grosse voiture et n’hésitant pas à éliminer les gêneurs. Il incarne tous les fantasmes des lobbys, sociétés secrètes ou autres rois de la finance qui, c’est bien connu, dirigent le monde à nos dépends. Ami du directeur de la principale chaîne de télé (« Mayote », notez la finesse de l’allusion), Arestrup copine, truque, fait assassiner mais finit par se faire rouler par le candidat « qui dit la vérité ». Le face à face qui occupe le dernier quart d’heure est plutôt bien écrit et mené et pourrait occuper une place de choix dans un épisode de série façon A la Maison Blanche. Mais cela ne suffit pas à donner du corps à un film dont la mise en scène artificiellement sophistiquée ajoute à l’ennui généralisé. Empilement de clichés, le Candidat n’atteint jamais ses objectifs de pamphlet virulent et s’arrête de surcroît au moment où il devrait commencer. |

Election
de Johnnie To
Débuter l’année 2007 avec une œuvre titrée Election semble devoir engendrer d’inévitables comparaisons avec l’actualité politique française. Mais mis à part son nom, le film de Johnnie To s’avère pour le moins très éloigné de la description d’un processus démocratique visant à désigner un dirigeant dans les cadres de la loi. En effet, en contant le difficile passage de pouvoir au sein d’une triade, lorsque deux parrains jouent du cash et des menaces pour obtenir des voix, le réalisateur s’inscrit évidemment dans la chronique mafieuse et non dans le pamphlet politique. Néanmoins, on pourra toujours trouver moyen de dresser des parallèles, plus ou moins justes et audacieux, mais on admettra que l’on imagine assez mal nos candidats présidentiels régler leurs comptes de manière aussi musclée.
La mise en scène de Johnnie To, ainsi que son style narratif, sont devenus immédiatement reconnaissables. Mouvements de caméra généreux, photographie contrastée peu avare en superbes clairs obscurs, et un rythme reposant sur un habile mélange de suspens nerveux et d’amplitude descriptive. On cause beaucoup au sein de Election, moins en promesses qu’en intimidations. Une guerre au sein de la triade se prépare, elle est imminente, tellement prévisible que le scénario ne cesse de l’esquiver, enferme les principaux protagonistes dans des cellules de prison pendant les deux tiers de l’histoire, digresse vers la poursuite d’un petit bâton sculpté, symbole dérisoire de l’autorité.
La première, et unique, scène d’action intervient au bout d’une heure, brutale et belle, à la machette, où peinture et sang viennent dessiner les masques d’une tribalité originelle. Rare, pas un seul coup de feu ne sera tiré, la violence d’Election culmine dans sa dernière séquence, où le conflit, repoussé, calmé, mais finalement nécessaire, explose dans un minimalisme intense. Les coups font mal, d’autant plus que la virtuosité de la caméra de To aura détourné notre attention. On admirait un ballet de travellings brillants et de dialogues ciselés, la conclusion nous ramène vers l’âpreté des polars les plus réalistes. Ces élections trouvent leur source dans les rites barbares, la société moderne peut essayer d’intervenir avec sa technologie, sa police, ses lois, les codes sont ancestraux, le pouvoir doit être absolu et les pactes s’envolent aussi vite que les paroles. |

Election 2
de Johnnie To
Encore plus réussi que le déjà remarquable Election 1 sorti la semaine dernière en France, cette suite directe se situe deux ans après l’élection du parrain Lok au moment où une nouvelle lutte de pouvoir s’engage. Plus sombre et plus virtuose, Election 2 conserve les qualités du premier opus, en particulier la mise en scène ample et d’excellents acteurs. Par ailleurs, les quelques scories sont balayées, Johnnie To proposant une œuvre plus tendue, moins bavarde, qui évite de s’attarder sur des sous intrigues un peu superflues. En suivant la rapide montée en puissance de Johnny, jeune homme d’affaires de la triade Wo Sing, le réalisateur signe un opéra de violence crépusculaire sous la haute influence de Coppola et de Scorsese. Une scène de tortures, physiques et psychologiques, particulièrement cruelle, mais nimbée dans la mélancolie de violons angoissés, confirme ces filiations. Une nouvelle fois, les armes à feu se taisent et font place aux machettes, voire aux marteaux, préservant toute la barbarie des combats et des meurtres. Moins théâtral que Election 1, ce second et dernier chapitre enchaîne les scènes de suspens où l’on sait que tout peut arriver, et que n’importe quel protagoniste peut périr. Johnnie To possède aussi un sens appréciable du détail qui fait basculer les scènes les plus éprouvantes vers l’humour noir ou vers les rives du surréalisme. L’une des forces de Election 2 est de créer des plans marquants, parfois proches d’une certaine poésie, avec des images déjà mille fois vues ailleurs. Sans révolutionner la chronique mafieuse, To offre ici un brillant récit sur l’inéluctabilité du Mal, dont la tristesse et la douleur semblent imprégner chaque minute. |

Eragon
de Stefen Fangmeier
Dès les premiers instants d’Eragon, toutes les ambitions du film sont posées : l’inimitable voix de Jeremy Irons nous présente un très classique univers d’heroic fantasy, sur fond de nuages. Surgit alors une vague bataille entre dragons, dont on ne retiendra qu’une tête de créature aux relents d’animatronique douteuse. Si les effets spéciaux, par Weta Digital (les partenaires habituels de Peter Jackson) seront définitivement le point fort du film, dès la seconde scène, où apparaissent un John Malkovitch (ici nommé Galbatorix, ce qui ne s’invente pas) et un Robert Carlyle en plein concours de cabotinage, les dés sont jetés : Eragon sera un grand moment de rigolade.
On pourrait facilement étudier le film de Stefen Fangmeier sous l’angle de la parodie, involontaire, mais globalement assez réussie du Seigneur des anneaux, ce serait sans doute oublier que malgré un marketing trompeur, Eragon s’adresse directement aux enfants, et joue en définitive sur le même terrain que le Narnia de Disney. L’excuse de l’œuvre familiale suffit-elle à pardonner la médiocrité cinématographique exceptionnelle de la nouvelle franchise de la Fox (deux suites semblent inévitables) ? Certes non, même les plus petits seront tentés de rire devant la pauvreté de l’œuvre. La mise en scène, en particulier, accumule les tares à peine dignes d’une série B bas de gamme, et, de la vision infrarouge du dragon à des travellings menant littéralement droit dans les murs en passant par des séquences d’action incompréhensibles voire hideuses, l’effarement ne cesse de gagner le spectateur.

Ajoutons à cela un script dénué d’enjeux qui impose dès le début un « élu » parfait, sans ambiguïté, ni charisme, et qui ne cesse de sauter d’un point à l’autre de l’histoire sans véritable cohérence (« l’assaut » de la forteresse du sorcier étant particulièrement pathétique). Ainsi que des idées grotesques qui ne cessent d’émailler le récit, que ce soit la « pêche » au pseudo Nazgül, en passant par le rot sonore du bébé dragon (venant carrément conclure une scène). Sans doute conscient que le mieux à faire est encore de plagier sans complexe les films de Jackson, Fangmeier refait son Gouffre de Helm en miniature, avec une mise en place de 2 minutes, une dizaine de figurants débauchés de Xenia et un manque total de sens dramatique. Nous ne devrions sans doute pas évoquer les nombreuses chevauchées vues d’hélicoptère, avec leurs décors « National Geographic Presents » qui provoquent immanquablement le sourire. Quand le réalisateur ne va pas jusqu’à recopier le fameux plan de coucher de soleils de Star Wars, il s’égare sur le regard vague de ses protagonistes.
Embarqués dans ce splendide naufrage, les acteurs font de leur mieux, en particulier Jeremy Irons, plutôt bon mais infligé de dialogues d’un ridicule mémorable (nous vous en laissons la surprise, car nous savons bien que vous avez à présent très envie de découvrir Eragon). On reconnaîtra derrière la voix de la dragonne Sephira la fraîchement oscarisée Rachel Weisz, pas du tout à sa place ici tant elle donne à la bête féroce des airs de ménagère au foyer. Si Robert Carlyle en Saroumane de carnaval vole facilement la vedette, on remarquera la mignonne Sienna Guillory, dont la présence totalement superflue assure le quota de féminité guerrière (elle brandit une épée trois minutes avant la fin).
Mais Eragon est finalement un spectacle assez indescriptible auquel il ne manque que des nains et des elfes (promis pour la suite), ainsi qu’un combat entre dragons (ce qui sera aussi pour la prochaine fois) pour s’assurer une place confortable au sein du panthéon des plus réjouissants fiascos à grande échelle, faisant paradoxalement concurrence aux inénarrables Donjons et Dragons. |

Exilé
de Johnnie To
Loin de la froideur expérimentale des Election et de P.T.U., Johnnie To signe avec Exilé un grand polar chaleureux conçu comme un hommage aux plus belles heures du western crépusculaire. Dès la première séquence du film, où des tueurs attendent longuement l’homme qu’ils doivent éliminer, le réalisateur fait révérence à Leone. Les citations sont nombreuses au fil du métrage, mais elles n’empiètent jamais sur l’ambiance et permettent au contraire à Exilé de gagner en personnalité. L’œuvre est ainsi immédiatement attachante grâce à son casting qui met en valeur quelques uns des plus grands seconds couteaux du cinéma HK. Anthony Wong, Francis Ng, Nick Cheung ou bien encore Simon Yam sont tous formidables, voire touchants, ce qui était largement inattendu de la part d’acteurs généralement cantonnés à des rôles de méchants irrécupérables. Cette ode aux « hommes de l’ombre » n’est pas la moindre des qualités d’Exilé et elle se trouve renforcée par la mise en scène toujours aussi virtuose de To. Le sens de l’espace est toujours aussi puissant, de même que le montage, jamais gratuitement tape-à-l’œil. Surtout, To met de côté ses désirs d’épure et se fend de nombreux gunfights magnifiques, délivrant ainsi son film le plus immédiatement jouissif depuis The Mission. Ménageant théorie et pratique, Exilé semble alors l’œuvre la plus maîtrisée de son auteur, libérée des contraintes de plus en plus exigeantes qu’il ne cessait de se fixer. L’histoire contée gagne en impact, redorant les grandes heures lyriques des meilleurs films HK des années 80. Amitié, honneur, sacrifice, avec des pointes d’humour et beaucoup de sincérité, les ingrédients sont connus mais idéalement dosés. On réalise alors très vite que Exilé est peut-être la plus belle des variations autour de la Horde sauvage, le film se révélant le dernier baroud d’un genre. Johnnie To trouve avec Exilé ce qui est peut-être le sommet de sa carrière mais parvient avant tout à exalter le spectateur, ravi d’assister à un requiem aussi élégiaque qu’attachant. |

La Femme des sables
de Teshigahara
Chef-d’œuvre du cinéma expérimental japonais des années 1960, La Femme des sables est une expérience cinématographique rare. Entre allégorie et réalisme cru, le film décrit une situation kafkaïenne où un homme se retrouve prisonnier aux côtés d’une inconnue, au cœur d’une véritable « mine de sable ». De l’absurdité de la situation, Teshigahara fait naître une ambiance oppressante de claustrophobie à ciel ouvert. Les images des murs de sables s’effondrant lentement ou par blocs entiers sont sublimes, la terreur qu’elles inspirent étant soutenue par une musique atonale effrayante.
Le duo d’acteurs est filmé avec autant de cruauté que de sensualité, même si la réputation érotique de l’œuvre pourra paraître un peu surfaite. L’essentiel se situe dans le cheminement psychologique du héros, réduit au même état que les insectes qu’il se plaît à capturer. La métaphore s’avère bien plus complexe et il ne faut pas vraiment s’attarder sur un parallèle entre le couple et cet ensablement quotidien. Si la Femme des sables peut tourmenter l’esprit, c’est avant tout une œuvre sensorielle qui fascine par la puissance de ses plans et l’âpreté de son atmosphère. Peu à peu, le film se dévoile telle une partition de musique contemporaine, avec sa répétitivité, ses ruptures violentes, ses silences et la liberté donnée au spectateur pour se construire son propre sens. Il s’agit d’un cauchemar cinématographique exigeant mais indispensable. |
|

Fur
de Steven Shainberg
Pour comprendre et apprécier toute la saveur très particulière, mais intense, de Fur : un portrait imaginaire de Diane Arbus, il faut sans doute avoir déjà succombé aux charmes vénéneux et adorables de La Secrétaire, le premier film de Steven Shainberg. Si le récit de séduction domination entre James Spader et Maggie Gyllenhaal laissait apercevoir un réalisateur à la personnalité et aux thèmes très affirmés et pour le moins originaux, cette vraie-fausse biographie de la photographe Diane Arbus confirme en grande partie nos espérances. Si en apparence, Shainberg respecte les codes du biopic hollywoodien, en emballant des pointes de mélodrame sous une mise en scène impeccable, voire trop propre, c’est au niveau de ce qu’il filme que l’auteur pirate joyeusement les figures imposées. Sa Diane Arbus est un pur fantasme, entretenant peu de rapport avec le personnage historique, et les fans de l’œuvre et de la personnalité risquent d’être très déçus s’ils viennent chercher ici un éclairage respectueux sur le parcours de leur idole. De l’œuvre de Arbus, Shainberg ne retient que l’idée de transgression, qui venait bousculer les belles images niaises des années 1950 en photographiant tous les parias et autres originaux des Etats-Unis.
Mais même cela n’est que secondaire par rapport à l’essence de Fur : un fétichisme hautement cinématographique pour la pilosité poussée à l’extrême. En dissimulant durant la quasi-totalité du métrage Robert Downey Jr. (par ailleurs excellent avec seul usage de sa voix) sous une épaisse fourrure, le réalisateur expose à nouveau son talent pour sublimer le glauque, voire le malsain (on se demande rapidement si la fascination de Arbus pour son voisin ne tient pas d’une étrange zoophilie). Les lombrics de la Secrétaire sont remplacés par des poils amoureusement caressés aussi bien par l’héroïne que par la caméra. D’une sensualité omniprésente, les scènes les plus esthétisantes de Fur ne ressemblent à aucune autre aperçues de mémoire récente dans une œuvre hollywoodienne. Les déboires familiaux de la photographe, ainsi que le final lorgnant un peu trop vers Elephant Man (la référence majeure du film), semblent ainsi un peu artificiels, ajoutés pour ménager à l’histoire un minimum de sympathie auprès du grand public.
Mais la « vitrine » de Fur est aussi son plus important défaut, il s’agit bien sûr de Nicole Kidman, qui refait ici son éternel numéro de femme frustrée, engoncée dans les traditions mais prêtes à laisser libre court à ses folies dès que l’occasion se présente. Abusant de son regard et de sa plastique à nouveau largement dévoilée, l’actrice tire parfois Fur vers un énième « Kidman Show » bien connu et facilement énervant. Paradoxalement, le travail de Shainberg n’en est que plus remarquable, parvenant à pervertir à la fois un sujet taillé pour les Oscars et une actrice cabotine. Il serait alors tentant d’affirmer que Fur est un film au poil, mais il mérite mieux qu’un calembour douteux, car il témoigne de la classe d’un réalisateur décidément à suivre. |

The Good German
de Steven Soderbergh
Certes Steven Soderbergh n’a jamais été étouffé par la modestie et que l’on reconnaisse ou non le talent (fluctuant) du cinéaste, on ne peut pas nier son ambition. Du film « d’auteur » tortueux et torturé à la pochade hollywoodienne dérisoire, en passant par le film à Oscars, Soderbergh fait de tout, sans forcément le faire bien. On pensait que le bonhomme ne pourrait jamais faire plus inutile que son improbable remake de Solaris, on se trompait. Voici que nous arrive The Good German, dont le sous-titre pourrait être : le cinéma américain des années 40 pour les nuls.
Cette fois, le réalisateur se prend pour la progéniture post-moderne de Curtiz, Welles et Tourneur réunis et accouche d’une œuvre conceptuelle, vague projet esthétique sans véritable but, à part de prouver qu’on peut encore faire de vieux films avec des moyens récents. Sans pour autant pousser le mimétisme jusqu’au Psycho de Gus Van Sant, Soderbergh s’embarque dans une photocopie précieuse et ridicule des tics artistiques de quelques grands chefs-d’œuvre du 7e art.
Le scénario est à la fois simpliste (on connaît la chanson) et parfois incompréhensible (dans son accumulation de personnages jamais caractérisés), mais avant tout un prétexte à dérouler du cliché avec une constance rapidement assommante. On peut donc jouer à reconnaître les films cités ou piquer un petit roupillon discret sans jamais avoir l’impression de perdre quoi que ce soit de l’essence de l’œuvre.
Véritables accessoires au milieu du décorum, les acteurs sont tels des figures de cire, lisses et désincarnés, incapables de transmettre la moindre émotion et surtout de faire revivre l’aura des stars évoquées. George Clooney souffre particulièrement dans le par-dessus trop grand de Bogart, révélant une fadeur inattendue et embarrassante. Quant à Cate Blanchett, insipide sosie d’une Bergman ou d’une Bacall, elle ne propose guère qu’un accent allemand convaincant. Tobey McGuire, quant à lui, ne fait que passer.

Comme pour essayer de donner un peu de vie à son installation glacée, Soderbergh se permet des audaces incongrues, sans doute pour rappeler que nous sommes au XXIe siècle. Sexualité explicite et dialogues crus sont au rendez-vous et surprennent par leur caractère totalement vain et déplacé. Oui, le sexe avait plus de force lorsque les réalisateurs devaient contourner le code Hays.
Thomas Newman a beau sortir la grosse artillerie orchestrale pour singer Max Steiner, il reste dans le domaine du pastiche. Lorsque Soderbergh pousse son audace jusqu’à se confronter explicitement avec le final de Casablanca, on sourit devant tant de naïveté satisfaite. The Good German entre dans le domaine de la parodie, mais sans l’humour (il faut voir comment tout ce petit monde se prend très au sérieux). Et le film n’est même pas une réussite esthétique, le noir et blanc totalement surexposé étant d’une rare indigence, le Good night and good luck de Clooney se révélant nettement plus convaincant à ce niveau.
The Good German voudrait par ailleurs véhiculer un nébuleux message sur l’immédiate après-guerre et la collaboration, se risquant alors à de très défavorables comparaisons avec le récent Black book. Mais il serait trop facile, et sans doute trop méchant, de jeter Soderbergh en pâture à Verhoven. Nous nous contenterons donc d’évoquer les Cadavres ne portent pas de costard de Carl Reiner, une œuvre finalement plus voisine de The Good German, et bien supérieure, ne serait-ce que par la présence, certes post-mortem mais définitivement classe, du vrai Boggy. |

The Holiday
de Nancy Meyers
A l’instar de la dinde et du pudding, la comédie romantique chorale est devenue un incontournable des mets copieux de la période des fêtes. Avec ses 131 minutes, son casting consistant, son petit best of des chansons de Noël et son scénario cousu de fil blanc dès que l’on aperçoit l’affiche, The Holiday semble tout droit sorti du même moule que Love Actually ou que A nous quatre (l’un des précédents films de Nancy Meyers). Au lieu d’accumuler les personnages et les destinées, The Holiday se concentre sur deux chassés-croisés amoureux, dont un seul correspond véritablement à ce que l’on pourrait attendre d’une telle œuvre. En effet, il n’y a que la partie britannique, où Cameron Diaz et Jude Law jouent au « Je t’aime moi non plus » jusqu’à plus soif, qui offrira son lot conséquent de romantisme hollywoodien. La partie américaine, au soleil de Californie, est la plus intéressante, justement parce qu’elle s’éloigne quelque peu des clichés. Certes, on pourra admettre que la relation filiale entre Eli Wallach et Kate Winslet verse tout à fait dans la guimauve obligatoire, mais elle a du charme et une pointe de sensibilité.
Mais tout cela correspond à un cahier des charges strictement suivi, scène après scène (il y a des enfants adorables, des petits vieux rigolos, des larmes, du rire, des quiproquos, etc…). L’une des rares idées plaisantes de The Holiday consiste en la lecture des événements de la vie de Cameron Diaz en suivant les codes des bandes-annonces , mais le concept est totalement sous-exploité (ce n'est pas la réussite d’un Harold Crick, par exemple).
Très familial et délivrant à peu près tout ce que l’on était en droit d’attendre (mais pas plus), The Holiday plaira certainement à beaucoup d’entre vous. En effet, si vous aimez Cameron Diaz (elle se prend des portes et fait des grimaces), Kate Winslet (absolument craquante), Jude Law (Monsieur parfait) et Jack Black (attendez Tenacious D, il fait de la quasi figuration ici), vous serez conquis. Et si vous adorez les grands films d’amour, allez plutôt voir The Fountain qui sort le même jour. |

Interview
de Steve Buscemi
On pourrait croire de prime abord que c’est le goût de la polémique qui a poussé Steve Buscemi à mettre en scène un remake d’une œuvre de Théo Van Gogh, le cinéaste néerlandais assassiné en 2004. Mais aucune attaque contre l’Islam n’est à déceler dans cette Interview et les spectateurs avides de sensationnel peuvent passer leur chemin. Non, c’est le dispositif exigeant, en quasi huis clos et en face à face, qui a certainement séduit Buscemi. Les attaques à l’encontre du « théâtre filmé » seront immédiatement recevables, le cinéaste ayant beau gérer au mieux son décor et son montage, il n’évite pas l’impression d’entendre les planches de la scène craquer à certains changements de plans.
Mais l’intérêt d’Interview est bien sûr ailleurs. D’une part, dans la performance des deux acteurs, en couple de duettistes déclinant toute la gamme du « Je t’aime, moi non plus ». Si Buscemi brille dans son rôle traditionnel du sale type attachant, Sienna Miller est légèrement en dessous. Parfois trop théâtrale, forçant un peu son jeu, elle se rattrape par un charme débordant. Les deux virtuoses des faux-semblants, tour à tour bourreau et victime, virevoltent sur un texte intéressant bien qu’un peu prévisible.
Paradoxalement, le film gagne en puissance par sa courte durée mais ne peut empêcher un sentiment de frustration dans sa conclusion. L’œuvre abandonne ses personnages sur des rebondissements gentiment malins mais légèrement décevants au vu des enjeux exposés. Si le combat sans règle ni pitié entre l’homme et la femme est savoureux, il s’accomplit dans une certaine futilité, comme un jeu sans grande conséquence, débouchant sur une leçon de morale dérisoire. Tout cela n’était qu’une blague acerbe et l’interview n’aura fait qu’effleurer la réalité des âmes. Il en ressort une belle récréation pour Steve Buscemi, qui s’offre ici une vitrine toute aussi légère et convaincante que le Delirious de son pote DiCillo. |

Lucky girl
de Donald Petrie
Très vaine tentative de prouver qu’un film peut se vendre sur le seul nom de Lindsay Lohan, en dehors du giron de Disney, Lucky girl prouve par l’absurde que la jeune actrice est encore loin de posséder l’aura d’une star. Bide conséquent au box-office US (17 millions de dollars de recette pour un investissement de 25 millions), écharpé par la critique, Lucky girl échappe au direct-to-video en France sans doute grâce à l’omniprésence de la demoiselle dans les pages people. Jouant une nouvelle fois sur son image, Lindsay Lohan essaie de nous faire croire qu’elle est avant tout une fille sympa, simple, cool avec ses copines, craquante avec les garçon et qui adore les enfants (la conclusion du film étant en cela quasi insoutenable de guimauve). Les seconds rôles ne s’en sortent pas mieux, tant ils sont stéréotypés et juste là pour servir la soupe à la Lohan. Cette histoire de « roue de la fortune » qui s’emballe est prometteuse pendant une vingtaine de minutes, avant de sombrer dans la routine du genre (on évite l’animal rigolo, mais on n’échappe pas aux gags scatos). Le public visé ne dépasse pas les 14 ans d’âge et même les amateurs des courbes de l’actrice pourront sciemment éviter de s’endormir devant Lucky girl, tant leur égérie s’y retrouve quasi dépourvue de charme et n’est jamais mise en valeur par la mise en scène télévisuelle de Donald Petrie. Un coup dans l’eau désolant qui ne joue certainement pas en faveur de la crédibilité cinématographique de Lindsay Lohan. |

Massacre à la tronçonneuse : le commencement
de Jonathan Liebesman
La déception fut grande en découvrant le soi-disant remake du chef-d’œuvre de Tobe Hooper mis en scène par Marcus Nispel en 2003. Ni très fidèle à l’original, ni suffisamment démarqué, le film hésitait entre esthétisme trop poli et petites outrances sporadiques. Trois ans plus tard, le seul souvenir vraiment marquant demeure Jessica Biel et ses vêtements moulants, c'est-à-dire le strict minimum pour un film d’horreur, mais bien peu lorsque l’on se rêvait digne des exactions de Leatherface. C’est donc avec un a priori pas forcément très positif que l’on découvre cette préquelle, réalisé par Jonathan Liebesman dont le premier effort, Nuits de terreur, brillait par sa médiocrité malgré une excellente scène d’ouverture.
Dès les premières minutes de ce Commencement, on se surprend à reprendre espoir : Liebesman filme bien, avec beaucoup d’effets mais sans trop verser dans le clip à la Saw & co. Il installe une ambiance extrêmement gore, où la barbaque est partout et où le sang semble suinter de chaque mur. En ce sens, ce Massacre à la tronçonneuse montre ce que l’original n’avait jamais fait : la chair dans ses aspects les plus glauques. Il suffit de voir la naissance sordide du futur « Gueule de cuir » pour comprendre que le réalisateur ne fera que peu de concession et n’hésitera pas à tout nous montrer.
On pourra regretter que le générique verse dans la facilité du montage d’images à la Seven pour résumer la jeunesse de Leatherface, mais il en dit beaucoup avec juste quelques plans très évocateurs. Iconisé avec amour, notre dépeceur favori retrouve ici tout son panache et surtout il retrouve tout son pouvoir d’imprévisibilité et de menace. Son premier meurtre, très fondateur, avec un marteau d’abattoir, rappelle non seulement sa première apparition dans le film de Hooper, mais frappe (littéralement) par son impact brutal et réaliste.

Réalisme, c’est le maître mot de ce qui se révèle au fur et à mesure de l’histoire comme le véritable remake que les fans (et les autres) pouvaient désirer. Même lorsque la tronçonneuse sera enfin de sortie, Liebesman refuse la surenchère, ne verse pas dans un concours d’originalité avec Hostel ou Saw 3. Crédible, extrêmement douloureuse, la violence de Massacre à la tronçonneuse le commencement n’en gagne que plus de puissance à l’écran et s’affirme ainsi comme la digne héritière de celle du film de Hooper. Comme s’il gagnait en confiance au fil du métrage, le réalisateur ose même se confronter brièvement avec les moments clefs du repas et de la poursuite dans la forêt. Pas à la hauteur, mais humble et jamais ridicule, ces relectures gardent de leur beauté très malsaine, entre humour noir et folie furieuse.
Pour ce qui est de la démence, Leatherface est grandement éclipsé par le « père », toujours incarné par R. Lee Ermey, dont le cabotinage frénétique se trouve enfin parfaitement exploité. Omniprésent, véritable héros du film, Ermey déploie un sadisme qui le décrit comme le seul véritable psychopathe de l’histoire. Sa cruauté hésite entre un aspect assez jouissif (il faut voir comment il « soigne » son frère) et une terreur continuelle (on ne sait jamais ce dont il est capable). Si Gueule de cuir ne vole la vedette que dans la dernière partie de l’œuvre, c’est pour mieux s’imposer en tant que mythe cinématographique. Il faut voir en cela la première création du « masque » en chair humaine, ainsi que sa pose magnifiée par un plan jubilatoire écho de la naissance de Dark Vador dans l’épisode III.

Malheureusement, The Beginning n’est pas exempt de défauts, en particulier lorsque l’on évoque les braves post-ados utopistes qui vont servir de chair à saucisses. Si leur présentation est agréablement brève et leur calvaire d’autant plus long, ils n’ont absolument aucune envergure et plusieurs scènes semblent vraiment un décalque sans brillance particulière des innombrables « survivals » que nous connaissons par cœur. De plus, l’héroïne, incarnée par la mignonne Jordana Brewster, reste en marge pendant les trois quarts du récit, avant de se retrouver dans les mêmes positions que la Jessica Biel du film de Nispel (et dans les mêmes accoutrements très moulants, pour le plus grand bonheur des amateurs).
Mais peu importe les futurs quartiers de viande, ce qui compte ce sont les méchants, dont on aurait finalement aimé creuser encore davantage les origines. Massacre à la tronçonneuse le commencement s’avère une très bonne surprise, prenant son sujet au sérieux, se confrontant très directement aux aspects les plus atroces de cet univers. La mise en scène solide de Liebesman et sa volonté de séduire les fans tout en offrant un vrai film d’horreur à l’ancienne confèrent à l’œuvre une personnalité indéniable. Et l’image de Leatherface traînant le poids de sa tronçonneuse comme celui d’un fardeau inéluctable demeure étrangement évocatrice. |
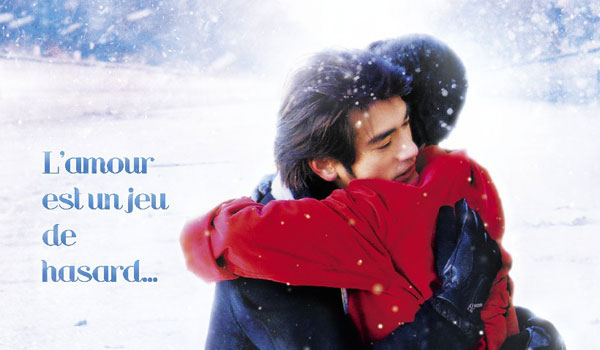
Perhaps love
de Peter Ho-sun Chan
Grand gagnant des HK Film Awards 2006 avec 6 récompenses, Perhaps love se présente sous la forme d’un très classique drame romantique emballé dans une esthétique luxueuse. A la mise en scène Peter Ho-sun Chan (principalement connu en nos contrées comme producteur de la saga The Eye et de Nouvelle Cuisine) essaie d’insuffler un semblant de style, pendant que le directeur de la photographie Peter Pau (Tigre et dragon, le Festin chinois, Jiang Hu…) cisèle des plans d’une beauté relativement inattaquable. Malheureusement, la préciosité technique ne peut dissimuler le vide émotionnel de Perhaps love. En une mise en abyme mille fois vue ailleurs, des acteurs de cinéma revivent leur histoire d’amour tragique au travers du film qu’ils sont en train de tourner. Celui-ci étant une comédie musicale, on aurait aimé profiter davantage des talents du chorégraphe de la Famille indienne, totalement sous-exploités au sein d’une demi-douzaine d’intermèdes musicaux fort brefs et imitant lourdement Moulin rouge.
Si Takeshi Kaneshiro et Jackie Cheung font de leur mieux, en surjouant les répliques désolantes de naïveté qu’on leur a confiées, la jolie Zhou Xun ne parvient jamais à transcender un rôle terriblement dénué de grâce et de glamour (son personnage grince des dents en dormant et arbore des sous-vêtements à faire frémir votre grand-mère). Mais le plus gros défaut de Perhaps love réside dans son absolu manque de rythme, résultat de la prévisibilité et de la surcharge de guimauve de l’histoire. Répétitif et laborieux, le film s’épanche de surcroît en un final à rallonges, qui hésite entre le gentiment ridicule et l’interminable. Seuls les fans du superbe organe (vocal) de Jackie Cheung trouveront peut-être là de quoi se précipiter dans les salles… |

Planète terreur
de Robert Rodriguez
Proposons le même sujet d’activité artistique à deux élèves que tout oppose ou presque : Quentin Tarantino, le premier de la classe chahuteur, dont on pardonne l’indiscipline au regard de ses résultats dignes des félicitations du jury, et Robert Rodriguez, le gentil cancre rigolard, qui allie bonne volonté et naturel de branleur indécrottable. Pour la première fois, les consignes sont rigoureusement identiques : rendre hommage au cinéma de genre des années 70. On nous répondra que c’est un peu ce que Tarantino et Rodriguez n’ont jamais cessé de faire depuis leurs débuts. Ajustons les prémisses et restreignons le champ de travail sur le thriller bis américain voué aux doubles programmes, ghetto de l’exploitation la plus triviale. Peu de cinéphiles auraient douté de l’issu du duel : le réalisateur de Pulp fiction vainqueur par K.O. sur celui de Spy kids. Erreur sur toute la ligne, cette fois le branleur triomphe, gagnant par chaos.
Avec Planète terror, Robert Rodriguez prouve qu’à trop vouloir jouer le hors-sujet et le métalangage, on ne touche pas toujours au génie, et que le bon devoir appliqué est parfois supérieur aux errances verbeuses du fort en thème. Oui, la bombe gore, fun et décérébrée du brave Robert défonce sévèrement la mâchoire du serial killer chochotte de Boulevard de la mort. Non seulement on retrouve ici tout ce que l’on aime dans Death proof (bombasses en petites tenues, mise en scène stylée, dialogues délicieux mais en quantité raisonnable, interprétation outrancière), mais Rodriguez force la dose d’alcool fort. Son Planète terror dégouline de bonnes mauvaises intentions.

Sexe, sang et sales blagues s’étalent sur 1h45, en ne ménageant que quelques temps morts qui font finalement partie de l’hommage (qui ne s’est jamais ennuyé une seule seconde devant un film de morts-vivants ?). Bimbo prête au carnage (quelle joie de voir l’insupportable Fergie privée littéralement de son cerveau), canardeur tatoué et indestructible (Freddy Rodriguez dans un excellent contre-emploi), vieux barroudeurs à tous les étages (Michael Biehn, Josh Brolin, Tom Savini, Bruce Willis en inévitable guest star), le cahier des charges est respecté à la lettre. Si dans son déroulement Planète terror ne surprend pas, c’est dans sa radicalité et sa générosité qu’il séduit totalement. Rodriguez ne se prive de rien, exagère tout et réjouit à chaque plan.
Film instantanément culte, d’abord par son mimétisme bordélique et ensuite par son charme visqueux inattendu, Planète terror s’affirme aisément comme le sommet de son réalisateur. Il faut bien sûr ajouter la performance ébouriffante de l’irrésistible Rose McGowan, avec mention spéciale à Marley Shelton qui ne manque jamais de voler la vedette. On obtient un grand délire festif qui allie clichés et innovations pour ne garder que le meilleur, à l’image de la bande-annonce de ce Machete qu’on vous laisse découvrir en avant programme. |
|

Red Road
de Andrea Arnold
Prix du Jury du festival de Cannes 2006, Red Road est un formidable thriller hors normes, dont l’esthétique impressionnante dissimule une profondeur saisissante. Durant sa première moitié, le film d’Andrea Arnold se présente sous la forme d’un suspens voyeuriste et obsessionnel, précis et étouffant. Jackie, incarnée par Kate Dickie (qui n’aurait pas volé un prix d’interprétation féminine) est employée par une agence de télésurveillance, ce qui lui permet de scruter et d’enregistrer tous les événements minuscules ou criminels de nombreux quartiers de Glasgow, dont celui de Red Road, où des HLM solitaires et menaçants sont réservés aux anciens détenus en phase de réinsertion. Ce désert urbain d’une Ecosse proche de la misère, permet à la réalisatrice de créer une atmosphère très oppressante, en adoptant en permanence le point de vue de son héroïne.
Après avoir reconnu sur l’un de ses écrans un homme, dont le lien avec son passé marqué par une tragédie demeure longtemps assez mystérieux, Jackie débute une longue filature. Ces séquences sont sans doute les meilleures du film, elles sont imprégnées d’une tension étrange, renforcée par une bande son peuplée de bruits industriels lointains et de stridences angoissantes. A mi-chemin entre le Dogme de Lars Von Trier (auquel le collectif Advance Party, à la base de Red Road, se réfère) et le polar hollywoodien, Andrea Arnold agence une union apparemment contre nature entre réalisme social, véracité psychologique et pur film de genre.

Après la révélation sur l’évènement traumatique, la seconde partie de l’œuvre tient moins du thriller que du drame cruel, parfois glauque et ce n’est plus la peur qui vient saisir le spectateur mais un effroi plus humain et insidieux. Culminant sur une interminable (car quasi insoutenable d’intensité) scène de sexe très explicite, cette montée de Red Road vers un propos plus ambitieux entraîne aussi le film sur des terrains plus balisés et déjà fréquentés par d’autres œuvres (dont il nous faut taire le nom sous peine de révéler les clefs du récit). Ce crescendo éprouvant, se dote d’une conclusion un peu prévisible mais qui offre une respiration indispensable pour ne pas transformer le film d’Andrea Arnold en un véritable calvaire. Red Road aurait-il gagné à forcer le jusqu’auboutisme, à franchir le point de non retour vers le désespoir le plus absolu ? Certains spectateurs le penseront sans doute, mais ils passeront aussi à côté de la beauté déplaisante et tétanisante d’une œuvre aussi inclassable que géniale. |

Requiem
de Hans-Christian Schmid
Requiem n’est pas une œuvre plaisante, bien au contraire. De son sujet, tiré d’une tragique histoire vraie, à sa mise en scène, sobre et étouffante, le film de Hans-Christian Schmid ne laisse aucune place pour le divertissement ou le moindre trait d’humour. Quasi entièrement porté par la formidable performance de Sandra Hüller et par une volonté de poser les faits avec le plus d’objectivité possible, Requiem est une tragédie aux teintes brunâtres et délavées de l’Allemagne des années 70. Récit d’une schizophrénie latente se transférant peu à peu en un désir de martyre mystique, le calvaire de la jeune Michaela est décrit avec une belle justesse psychologique et un minimum d’effets attendus, jusqu’à une conclusion qui refuse toute concession au spectaculaire.
Ceux qui viendront chercher ici un film Fantastique, voire d’Horreur, en seront très largement pour leurs frais. Le drame est austère, âpre, parfois terrible lorsque l’on partage l’impuissance des proches de Michaela face à la folie qui la gagne. En ce sens, Requiem revient aux sources de l’Exorciste en racontant avant tout l’effroi que représente un proche sombrant dans la démence. Une seule véritable scène d’hystérie nous est ainsi montrée, à la toute fin du métrage ; un peu déplacée, elle n’en est pas moins impressionnante. Mais la véritable force de l’œuvre demeure son actrice principale : d’une fragilité qui confine à l’étrangeté, attachante et parfois énervante, Sandra Hüller est une superbe révélation. |

La Traversée du temps
de Mamoru Hosoda
D’après une histoire de Yasutaka Tsutsui, l’auteur de Paprika, et bénéficiant du travail graphique du studio Mad House, la Traversée du temps est une œuvre cinématographique de très belle facture. En décrivant des voyages temporels à échelle humaine, le film ne vient pas jouer sur le terrain du scientifique mesquin façon Primer, ni de la comédie existentielle façon Un jour sans fin. Le scénario préfère s’attarder sur une chronique adolescente, qui, si elle n’est pas très originale, est composée avec beaucoup justesse.
Après une première partie très drôle et rythmée, la Traversée du temps s’épanche doucement dans le mélodrame, avec quelques excellentes idées. On admire le travail visuel et sonore, qui évite à l’œuvre de ressembler à une série télévisée, et lui offre même une poignée de superbes séquences. Malheureusement, la conclusion réserve un nouveau record en matière de rallonges. Plus d’une fois le spectateur est persuadé d’avoir atteint le final, mais le film ne sait plus où s’arrêter. On regrettera en particulier qu’une magnifique scène de course, digne du Satoshi Kon de Millennium actress, ne soit pas la dernière image que l’on retienne de la Traversée du temps. Mais il ne faut surtout pas bouder cette excellente sortie d’animation japonaise, qui mériterait de séduire le grand public. |

Waiter!
de Alex van Warmerdam
Dans la même veine froide et cynique que le récent Norway of life, Waiter est une petite perle glacée qui rafraîchit autant qu’elle trouble. En une version très méchante et ludique de l’Incroyable destin d’Harold Crick, l’histoire déroulée par Alex van Warmerdam est prétexte à tourmenter tout autant la créature que son créateur. Bien sûr, les instants les plus savoureux voient les personnages de fiction débarquer dans l’appartement de l’auteur, plein de revendications plus ou moins triviales. Mais les multiples errances, modifications et accidents du texte, immédiatement retranscrits en images sont aussi fréquemment jubilatoires (une touche coincée sur un clavier et l’on obtient l’une des scènes les plus drôles de cet été cinématographique).
Fort d’une belle galerie de caractères intrigants et d’un rythme correct, Waiter se feuillette avec plaisir. Parfois désarçonnant par sa cruauté, flirtant étrangement avec le décalage d’un Kitano (yakuza à l’appui), le film faiblit dans sa dernière partie, le réalisateur démiurge semblant avoir autant de mal que l’écrivain à achever son œuvre. Mais la fin, aussi violente que tétanisante affirme la personnalité de ce Waiter. Sans concession, assumant pleinement la folie mais aussi l’inéluctabilité de son sujet, cette conclusion donne sens au projet entier. Le film dépasse alors le cadre de la comédie de situations pour mieux toucher à l’existentiel, avec ce qu’il faut d’humour et de désespoir. |
|
|
|