9
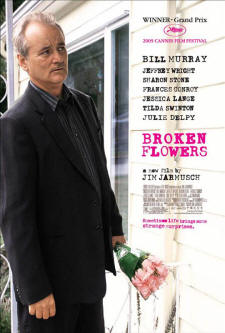
Broken Flowers
Le rythme de la vie, le rythme du temps qui passe, la véritable durée des "aventures du quotidien", voilà ce que propose l'errance de Jim Jarmush. Broken Flowers est un fragment extraordinaire traité sous la forme du trop peu, de l'absence, du vide et du manque. L'existence du Don Juan apathique Bill Murray n'est qu'une interminable attente, une longue traversée de l'existence sans véritable but, à part peut-être pouvoir écouter de l'opéra sur sa chaîne Hi-Fi. Évidemment cela ne suffit pas à rendre notre Bill heureux, surtout lorsque sa dernière conquête le quitte et que sa passivité ne lui laisse plus d'autres choix que d'attendre, encore et encore. Quand le passé le rattrape et que le présent semble lui donner une nouvelle chance, c'est à reculons, en se pressant avec lenteur, que notre homme se met en route. Mais le passé n'est plus très beau à voir et la nouvelle chance est aussi floue que la vie en elle-même. Broken Flowers est un film éthéré, où les apparences sont trompeuses, où rien ni personne ne semble être au bon endroit au bon moment. Et pour conclure le road movie minuscule, il ne peut y avoir que des pointillés et un final aussi juste que frustrant, aussi évident que déstabilisant et qui fonde en grande partie la réussite de l'oeuvre. |
8
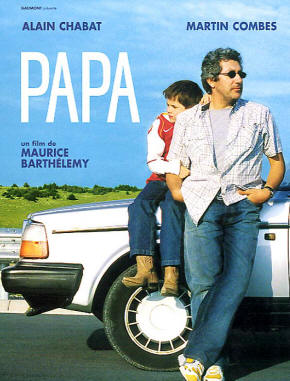
Papa
De tous les films que j'ai pu voir en 2005, Papa est peut-être celui qui m'a le plus surpris, car il était difficile d'attendre une oeuvre aussi juste de la part d'un réalisateur avant tout connu pour ses performances au sein des Robins des Bois. On y va donc avec une part de curiosité et une bonne dose d'appréhension, tout en se rassurant grâce à la présence d'Alain Chabat qui a déjà prouvé par le passé qu'il pouvait être un excellent acteur mélodramatique. Dès les premières minutes du film, on est conquis par la mise en scène en DV très maîtrisée et par la sobriété forcément craquante des relations entre le père et le fils. Le fin mot de l'histoire peut ainsi être fort prévisible sans que cela nous choque et certaines idées surprenantes (notamment les cauchemars du père ou sa tentative de rendre le sourire au fiston par une chorégraphie délirante) ajoutent une vraie personnalité à l'oeuvre. Le réalisateur ne tombe jamais dans le piège des larmes faciles et retient l'émotion jusqu'à la toute fin du métrage. La courte durée, la performance de Chabat, la forme audacieuse, la justesse des dialogues sont autant de points qui font de Papa une réussite singulière au sein du cinéma français de l'année écoulée. |
7

Seven Swords
De chaque nouveau film de Tsui Hark on réclame qu'il vienne révolutionner le cinéma, qu'il secoue nos habitudes en bouleversant les règles et en proposant du jamais vu, du jamais ressenti. Alors, bien sûr, lorsque l'on s'aperçoit que Seven Swords est une oeuvre qui capitalise avant tout sur les acquis du génial metteur en scène, on se sent quelque peu déçu. Difficile, certes, de ne pas s'extasier devant la maestria visuelle habituelle, jamais prise en défaut, ici nettement plus accessible que dans le totalement expérimental Legend of Zu. Abusant moins des ralentis que par le passé et mettant la pédale douce sur le montage brutal, Tsui Hark fait de Seven Swords son oeuvre la plus grand public depuis presque une décennie. Nous sommes alors en présence d'un film de sabres des plus classiques, avec ses gentils tourmentés mais si admirables et ses méchants toujours plus sadiques et pervers. On ne le cachera pas, Seven Swords, comme son titre l'indique, est une nouvelle version des Sept Samouraïs, avec quelques variantes bienvenues ; et clairement la possibilité d'une saga plus vaste, ce film ressemblant à une introduction tant il ne fait que survoler les origines et motivations des différents héros. De surcroît, Seven Swords était censé durer au moins 3h30 et c'est donc avec une version amputée d'une heure, si ce n'est davantage, que nous devons reconstituer certains mystères pour le moins abscons. Mais Tsui Hark nous a habitués à aller à l'essentiel et c'est ce qu'il fait en majeure partie, même si l'on sera très étonné de le voir s'éterniser sur quelques scènes largement superflues (comme la libération larmoyante d'un cheval dont on se moque éperdument).
Si ni le scénario (classique mais si efficace), ni la mise en scène ne sont décevants, il n'en est pas de même pour la musique, pourtant signée par le très doué Kenji Kawaï, qui est une affreuse et redondante mélasse épique qui surligne le moindre événement, la moindre image, jusqu'à provoquer l'exaspération voire le fou rire. On regrettera sans doute aussi quelques dialogues naïfs et une conclusion pas vraiment à la hauteur des ambitions de l'oeuvre. Car si les combats sont parmi les plus incroyables que l'on ait pu admirer sur un écran, les enjeux ne sont pas toujours très passionnants, ni très logiques et le film fonctionne plus en un enchaînement de séquences plus ou moins intenses qu'en un tout homogène. Heureusement, les moments grandioses sont légions et sont parfois tétanisants, que ce soient les chorégraphies des combats ou la construction de certains plans, on est fréquemment sous le charme de l'aventure et des personnages. Et l'année 2005 fut à ce point avare de moments de pur cinéma que ce Tsui Hark un peu mineur obtient sans peine sa place dans le top 10. |
6

Le Château Ambulant
Au sein de la décevante année cinématographique 2005, le syndrome le plus frappant aura été lié à la déconvenue causée par les films les plus attendus. Plus ou moins, chacun à leur mesure, des oeuvres telles que La Guerre des Monde, Sin City, Last Days, Batman Begins, Les Noces Funèbres et de nombreux autres n'auront pas tenu toutes leurs promesses, loin de là. Dans ce "top 10" de fin d'année, nous retrouvons donc des films mineurs mais moins que les autres, pour vous dire à quel point établir un classement fut difficile. En effet, prenons comme exemple la dernière oeuvre de Miyazaki, chouchou de ce site et d'aussi à peu près tout le monde. Le Château Ambulant est un superbe dessin animé, avec ce qu'il faut d'émerveillement, d'étrangetés, de péripéties, d'humour, la recette Miyazaki est ici quasi idéalement composée et servie au public conquis d'avance.
C'est beau, touchant, intelligent, mais c'est finalement toujours la même chose et le Château Ambulant est peut-être le premier Miyazaki que l'on pourrait qualifier de "routinier". C'est certes une sorte de best of de son oeuvre, mais c'était déjà en partie le cas avec le Voyage de Chihiro qui atteignait, lui, sans problème le statut de film somme. Le Château Ambulant est plus prévisible malgré certaines fulgurances qui resteront parmi les scènes les plus marquantes de 2005 (tout ce qui a un rapport avec les transformations de Howl en monstre ailé en particulier). On s'attendait à être plus transporté par l'histoire, et la fin relativement décevante de la part de Miyazaki ne permet pas au film d'égaler les plus inoubliables perles du maître. Il n'empêche, le léger désenchantement ne peut masquer la réussite globale du spectacle. Même un peu bringuebalant, Miyazaki demeure le plus grand des créateurs de dessins animés. |
5

King Kong
- Monsieur Wood, nous savons que vous attendiez avec impatience le King Kong de Peter Jackson, on vous sait fan aussi bien du film original de 1933 que du merveilleux réalisateur de Heavenly Creatures, alors M. Wood, trêve de suspens, qu'avez-vous pensé de King Kong ???
[voix ébétée entre Dominique Farrugia jouant les imbéciles et Beavis]
- Huh, huh, huh, c'était trop bien.
- Certes, M. Wood, mais encore ?
- Huh, huh, huh, à un moment, les dinosaures, et bien ils courent, et ils sont trop stupides, et ils tombent les uns sur les autres, et ça fait beaucoup de bruit, et beaucoup de tintouin, huh huh huhu et une grosse bouillie grise à l'écran, huh huh huh, c'est la scène la plus drôle, la plus crétinement jouissive de l'année 2005, hé hé hé huh huh.
- Donc le film tient ses promesses au niveau du spectacle ?
- Totalement, on y va pour s'en prendre plein la gueule et il faut reconnaître qu'on en a pour son argent. On s'en prend littéralement plein la tronche. Tout le passage sur Skull Island est une débauche de scènes d'action toujours plus spectaculaires, frénétiques, délirantes, voire choquantes.
- Allons, allons, M. Wood, dans votre top 10 il y a aussi The Descent et vous allez me dire que vous avez été choqué par King Kong ??
- Oui, totalement. Le film est d'une rare violence, très surprenante au sein d'un divertissement qui se veut grand public. L'apparition des indigènes ne ferait pas pâle figure dans une histoire de cannibales des années 70. Et c'est bien sûr le gouffre aux insectes qui est le clou immonde du métrage. C'est terrifiant, cruel et vraiment très beurk.
- Mais très bien fait, non ?
- Les effets spéciaux sont hallucinants, bien sûr. Kong est d'un réalisme sans défaut et la caméra de Jackson est clairement amoureuse de cette créature.
- Et les acteurs réels sont donc écrasés par les bestioles virtuelles ?
- Littéralement, mais finalement, contrairement à la majorité des blockbusters, les personnages sont plutôt bien traités et le casting s'avère très judicieux, les rôles masculins étant interprétés par des acteurs fort charismatiques qui parviennent à faire exister leurs protagonistes en quelques scènes. Quant à Naomi Watts, elle ne fait pas grand chose, mais la caméra fait le reste.
- Et le scénario ?
- C'est exactement celui de l'original, juste en plus détaillé. Jackson en profite pour faire son remake-parodie de Titanic, il met enfin en image la scène des "araignées" et bidouille quelques séquences larmoyantes pour le final, sinon c'est tout pareil qu'en 33. Donc légèrement prévisible aux yeux du public actuel, en particulier parce que King Kong est à présent un mythe connu de tous, même de ceux qui n'ont jamais vu le film d'origine.
- On s'ennuie, donc ?
- Pas une seule seconde. Quand on commence à être lassé par la première partie qui présente les héros humains, l'aventure commence et ne baisse plus de régime pendant plus d'une heure. Et quand on se lasse de cette hystérie épique, hop, on revient à New York pour le crescendo final. Le film est parfaitement équilibré et rythmé, c'est un modèle de divertissement soigné.
- Mais l'essentiel réside dans le spectacle et il n'y a finalement pas vraiment de fond.
- C'est assez vrai, la romance est touchante de naïveté mais elle ne dépasse pas le cadre des jolies images, même si Jackson se sort plutôt très bien des passages obligés et ne tombe que peu dans la guimauve ou le ridicule. Sur 3h10, c'est un quasi miracle, surtout quand on pense à Titanic, par exemple, là, au hasard.
- Oui mais dans Titanic il y avait Kate Winslet, M. Wood !
- Certes mais finalement dans Titanic il n'y avait QUE Kate Winslet...
- Alors que King Kong est une oeuvre superlative qui ne vise finalement que la surenchère à tous les niveaux ?
- Indéniablement. Il y a plus de tout, tout le temps. Plus vite, plus haut, plus fort. Et avec cette volonté qui habite Peter Jackson depuis le début de sa carrière de toujours délivrer THE film ultime. Le Seigneur des Anneaux affichait clairement sa volonté de devenir le plus grand spectacle de l'histoire du cinéma, pour King Kong c'est la même symphonie. C'est très prétentieux et bien sûr au final ce n'est pas totalement réussi, mais une telle ambition, une telle mégalomanie entièrement dédiées à l'amour du cinéma, à l'amour de son sujet et sans doute à l'amour des spectateurs, franchement ça ne supporte pas vraiment la tiédeur. King Kong enthousiasme, bouscule, touche, effraie, fatigue, émerveille, tout en même temps, c'est le divertissement total.
- Alors, film de l'année ?
- Grand spectacle de l'année, indéniablement, quasiment le seul film à avoir tenu ses promesses en 2005. On ressort lessivé, mais ravi comme un môme. D'ailleurs à force d'en parler, je crois que ça me reprend, huh, huh, huh, et même qu'à un moment, le gros singe il met des mega baffes aux T-Rex et que c'est trop bonnard, huh, huh, huh.
- Merci M. Wood pour cette critique si pertinente du King Kong de Peter Jackson, encore visible dans toutes les bonnes salles de cinéma près de chez vous.
- Et les sangsues elles sont beurk, huh, huh, huh !
- Merci M. Wood. |
4

The Descent
Adorer The Descent pour des raisons quasi métaphysiques, c'est sans doute clamer une certaine tendance au masochisme. Car si l'on peut prendre plaisir devant ce film en évoquant un "fun" lié aux jeux de massacre, le vrai délice tient à l'implacable sauvagerie toute primitive qui habite le métrage. The Descent est effroyable, tout n'y est qu'horreur et souffrance, le divertissement de trouille atteint des dimensions traumatisantes tant Neil Marshall surenchérit dans le calvaire sadique (en comparaison, le gentillet Calvaire aussi sorti cette année au cinéma paraît vraiment très fade). De surcroît, The Descent évite un piège tout en nous prenant dans ses filets : on pourrait en effet penser de prime abord que le film va s'avérer gentiment sexy vu qu'il ne propose que des héroïnes en tenues moulantes, et finalement pas du tout. Au contraire, le périple n'est jamais érotique, ni même ambigu, la violence fait vraiment mal et ne titille jamais notre libido déviante.
A force de détails glauques, de claustrophobie et de bains de sang, The Descent fascine, étouffe et picote notre inconscient jusqu'à nous hanter longtemps après sa vision. Il y a dans cette oeuvre des images et des idées qui éveillent nos peurs les plus ancestrales, qui excitent nos instincts les plus archaïques, en une catharsis voisine de chefs-d'oeuvre barbares tels que Maniac ou Massacre à la Tronçonneuse. L'expérience se rapproche sans doute de la pornographie et s'avère même encore plus perverse, tant l'agrément procuré par cet étalage d'atrocités se justifie encore plus difficilement que les charmes du X. Et pourtant on ne regarde pas The Descent avec honte, on s'en réjouit et on meurt d'envie de le revoir, même si l'on se doute que ce ne sera jamais aussi fort que la première fois, quand la suffocation nous a saisi dans la salle de cinéma, sensation épouvantable et merveilleuse... |
3
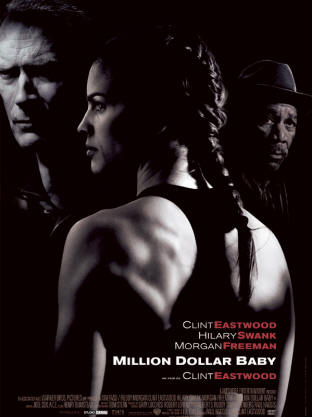
Million Dollar Baby
Clint Eastwood est beau dans sa vieillesse, Clint Eastwood est grand dans sa sagesse, son Million Dollar Baby, au même titre que le Match Point de Woody Allen, nous montre un homme au crépuscule de sa vie en train de se questionner sur le sens de celle-ci. A quoi auront servi la dignité et l'honneur ? A quoi aura servi la gloire ? L'homme, engoncé dans sa virilité et ses principes, aura-t-il eu raison de croire en son combat ? La boxe n'est qu'une métaphore et c'est sans doute ce qui rapproche le dernier Eastwood de Raging Bull, le chef-d'oeuvre de Martin Scorsese. La boxe symbolise cette lutte de l'humanité qui, au quotidien creuse sa place à force de volonté, à la puissance de ses espoirs. Mais lorsque l'injustice frappe, comment rester debout ? Quand tout vous abandonne, êtes-vous prêt à jeter l'éponge ?
Le colosse vacille, le colosse chancelle. Comme dans son chef-d'oeuvre, Impitoyable, le héros se fissure et derrière les rides, c'est une faiblesse inattendue qui transparaît. Le cow-boy sans foi ni loi met genou à terre, atteint dans sa fierté, désarçonné dans ses convictions, il ne lui reste qu'à faire face une ultime fois à l'existence et d'accomplir sa volonté en ce monde. Sa volonté d'homme libre qui ne veut croire qu'en lui-même et en ses choix, quitte à disparaître après avoir accompli ce qu'il considère comme l'irréparable. Découvrir Clint Eastwood en image paternelle, contraint au plus grand des sacrifices, est un choc déchirant, certes. En apparences, Million Dollar Baby est un mélodrame lacrymal de plus, mais entre les mains du metteur en scène, un scénario relativement banal devient un grand film funèbre débordant de justesse. |
2

Match Point
"Et si en plus il n'y a personne ?", chantait en 2005 un Alain Souchon en pleine crise de doute mystique, le Match Point de Woody Allen va plus loin que la simple interrogation. Il suffit d'un peu plus de deux heures au new-yorkais pour à la fois transposer son univers dans les cadres de l'Angleterre bourgeoise et surtout pour tuer une énième fois Dieu. Mais Allen accomplit son déicide avec une telle conviction, une telle originalité que sa démonstration n'en est que plus troublante, que plus passionnante. Si sa Balle de Match est une variation autour de Crime et Châtiment de Dostoïevski, c'est pour parvenir à une conclusion radicalement opposée à celle de l'auteur russe. Ici pas de rédemption par la Foi, pas de salut par la culpabilité, mais au contraire une injustice absolue et une absence de morale des plus naturelles.
Le film dissimule donc son sens pendant la majeure partie de son intrigue, en nous concentrant sur l'ascension d'un arriviste prêt à tout pour réussir, une histoire fort classique mais traitée avec une sobriété et une précision qui surprennent tant que Woody Allen a parfois tendance à se laisser aller à des effets comiques ou poétiques trop appuyés. Ici, même les digressions participent à l'accomplissement du conte immoral, les confessions ne sont que mensonges, la beauté n'est vraiment qu'apparence et la victoire finale ne se jouera que sur la chance. Match Point est une oeuvre d'un pessimisme angoissant tant la philosophie qui s'en dégage ne laisse aucun échappatoire : l'homme est libre et terriblement solitaire, aussi seul au milieu des autres que seul au sein de l'univers. En tant qu'accomplissement (provisoire) de la filmographie et de la réflexion d'un être aussi sensé que M. Allen, une telle conclusion ne peut que troubler et émouvoir. |
1

Wallace & Gromit - La Malédiction du Lapin-Garou
C'est l'histoire d'un homme et de son chien, d'un inventeur et de son fidèle compagnon, d'un maladroit invétéré et de son ange gardien. Bref, l'histoire de deux inséparables amis et d'une horde de lapins qui voudraient bien quelques carottes de plus. Cela débute comme un thriller, avant de s'évader vers la comédie absurde, et soudainement cela vire au film d'horreur, façon Hammer, quand Dracula hantait les cimetières gothiques et les jardins victoriens. De jardin il est beaucoup question dans le premier long-métrage de Wallace & Gromit, car Nick Park et ses camarades viennent de donner ses lettres de noblesse à un genre méconnu : le gore potager. Avant eux, nous connaissions déjà les tomates tueuses et la forêt vindicative de Evil Dead, mais jamais nous n'avions eu autant la frousse entre deux choux et une rangée de salade. L'histoire du cinéma avait déjà connu un terrible lapin tueur, chez les Monty Python, dont les petites dents aigues font encore frémir les plus sensibles d'entre nous, mais jamais l'on avait poussé la parodie aussi loin.
Et qui dit parodie réussie dit dévotion et respect des genres parodiés, ce qui est évidemment totalement le cas dans La Malédiction du Lapin-Garou, oeuvre très référentielle mais totalement accessible aux non cinéphiles (un peu comme le Kill Bill de M. Tarantino par exemple). Les créateurs des studios Aardman ont pris les images connues de tous et les ont savamment détournées pour en faire un rêve de cinéma en pâte à modeler. Le long-métrage peut ainsi afficher ses ambitions, à grands coups de courses-poursuites dantesques et d'audaces de mise en scène, sans jamais perdre son aspect bricolé, un peu à la bonne franquette, avec les empreintes digitales bien visibles sur le museau du chien savant. Humilité, travail parfait et histoire prenante ? Il manque juste l'humour, bien sûr omniprésent qui visite tout le spectre du comique, aussi bien burlesque que hautement littéraire avec quelques calembours luxueux. On ajoute à cela environ une idée réjouissante par plan (pas par séquence, par plan !) et l'on obtient le meilleur divertissement de l'année. |
|
|