10

Moloko - Statues
Le printemps 2003 fut, musicalement, bien tristounet. C'est donc tel un rayon de soleil un dimanche de pluie qu'est apparu le nouveau Moloko. Même si le duo nous a offert avec Statues son album le plus sombre, il y avait suffisamment de plaisir, de mélodies et de lumière pour nous arracher au quotidien. L'hiver prenait fin et déjà l'été frappait aux portes. Principalement grâce au gracieux single Familiar Feeling, heureux remake du sublime The Time Is Now. On était porté par le souffle de cette chanson qui ne peut que donner des ailes, qui oblige à danser et qui ne laisserait justement pas une statue de marbre.
Mais le disque ne s'arrêtait pas avec cette ouverture brillante et proposait d'autres trésors. Telle l'émouvante chanson titre, où Roisin trouvait des accents à la Siouxsie Sioux. Ou bien encore l'épique Forever More et ses empilages de rythmes. Ainsi que la conclusion de Over and Over, pour le moins déchirante mais définitivement étincelante. Un album pour retrouver le sourire quand il fait gris. Et puis, bien sûr, évidemment, tout le monde le sait à présent, Roisin Murphy est la classe incarnée.
9

Britney Spears - In The Zone
Évidemment, cela va encore faire hurler derrière les écrans. Bien sûr, je vais encore une fois perdre toute crédibilité, et peu importe les noms qui suivent dans le classement de l'année, on ne retiendra que cette "faute" impardonnable. Que vient donc faire Britney Spears dans le top de fin d'année d'un fan de Love et des Buzzcocks ? A-t-il succombé aux charmes discutables de la demoiselle ? Certes, non, je vous le confirme, Britney est, pour moi, loin d'incarner la classe et c'est sa musique qui m'impressionne, car sa personnalité programmée me laisserait plutôt de marbre. Britney je m'en fous un peu, voire beaucoup. Mais In The Zone est un attentat pop particulièrement jouissif. Donc c'est bien la musique qui me séduit chez Bit-Bit. Ce qui est pire, me direz-vous ! Et encore plus impardonnable ! Et pourtant...
En 2003, j'ai aussi cru très fort aux accents punks des T.a.t.u., superbement produites par ce bourrin de Trevor Horn. Malheureusement, après trois singles formidables, les petites ont apparemment explosé en vol. Survivront-elles à la saison prochaine ? Rien n'est moins sûr. Par contre, Britney est toujours là. Quatre disques après Baby One More Time, son style a nettement évolué. In The Zone étant essentiellement un recueil d'étrangetés r'n'b pop aux forts accents érotiques, voire pornographiques. On ne parle ici que de gimmicks et de séduction facile, le tout emballé dans un travail de producteurs franchement monstrueux. Certes, comme toujours, l'album annuel de Britney est avant tout symbolique. Il incarne l'état de la variété internationale mieux que tous les autres réunis.
Si Christina Aguilera fascine par sa tendance à l'auto-destruction et au masochisme, elle effraie aussi quelque peu. Quant à Beyoncé Knowles, si tout le monde s'accorde à considérer son Crazy In Love comme l'hymne de l'année 2003, son album s'est révélé être un flan particulièrement gluant. Et Madonna ? Madonna s'est ramassée, comme rarement dans sa carrière, avec un American Life proche de la nullité. Et finalement, son seul moment de gloire de l'année fut aux côtés de Britney (et Christina) lors d'une performance qui aura sans doute bien fait rire les T.a.t.u. Alors, Madonna est là, dans la Zone, sur ce single effroyable qu'est Me Against The Music. Un truc barbare que n'aurait pas renié Laibach ou Trevor Horn, justement. Elle est aussi présente, en fantôme bienfaiteur, sur de nombreuses autres chansons de l'album. Comme sur Brave New Girl et ses airs de Materiel Girl du 21e siècle. Le passage de flambeau semble avoir été assuré, une nouvelle ère débute.
In The Zone est une véritable réussite dans son genre. Même si à la fin de l'année, Kelis a débarqué avec un Milkshake qui explosait toutes les limites de l'indécence, Britney a réussi à imposer ses chansons classées X sur les ondes et dans les foyers les plus respectables. Je ne garantis aucunement la durée de vie de In The Zone, dès l'été prochain il sera obsolète. Mais il nous aura au moins fait passer une partie de l'hiver le sourire aux lèvres, à la seule force d'un Toxic grandiosement pop ou d'un Showdown irrésistible. Aller, encore un effort Bit-Bit, le prochain album pourrait être grandiose.
8
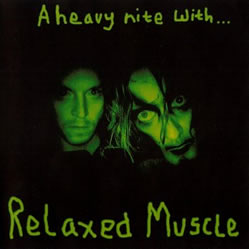
Relaxed Muscle - A Heavy Nite With
Sur le premier titre de l'album du duo Relaxed Muscle, on ne peut être que surpris. Bien sûr, on savait plus ou moins à quoi s'attendre. Mais pourtant, cette "electroclash" brutale, saturée, électrique jusqu'à la surtension, nous rappelle quelque chose d'extrêmement familier, on connaît cela par cœur. Il ne faut qu'une minute pour réaliser que cela ressemble incroyablement aux premiers Nine Inch Nails qui ont bercé notre adolescence. Alors, voilà, l'electro-pop de l'an 2003 sonne comme de l'industriel du début des années 90. Somme toute, c'est logique, le revival des années 80 ne pouvait que nous amener en 1991. Car en 2003, tout le monde se réfère de Jesus & Mary Chain, et surtout de My Bloody Valentine. Mais il faut dire que cela fait plus de dix ans que l'oeuvre de Kevin Shields est copieusement citée en références, copiée, vampirisée, etc...
Mais si le son général de Relaxed Muscle n'est pas d'une affolante originalité (le reste de l'album est souvent moins industriel que Heavy, et plus proche d'une electro désormais fort familière, à l'image du "single" My Name Is Billy Jack), son charme réside ailleurs. Car ce chanteur peinturluré, là, arborant une tenue plus ou moins en hommage à Spinal Tap (le fameux t-shirt X-Ray). Ce Darren Spooner agressif, charismatique, libidineux et auteur des paroles hilarantes, triviales et jouissives de l'album, hum... oui... ce Darren Spooner nous est encore plus familier que la musique qui l'accompagne. Forcément. D'ailleurs si on nous a offert le premier album de Relaxed Muscle, c'est pour lui et juste pour lui. Mais pourquoi donc ? Darren Spooner est-il la résurrection de John Lennon ? La soeur de Faye Wong ? Le chat de Frank Black ? Non, non, rien de tout cela. Disons qu'il semblerait, avec même une certaine certitude, que Darren Spooner fut, dans une autre vie, le leader d'un très obscur groupe anglais, que les lecteurs assidus de ce site doivent vaguement connaître, et qui portait le patronyme amusant de Pulp.
Jarvis Cocker, donc, le nom est lancé. Le monsieur a beau essayé de trafiquer sa voix, elle est immédiatement reconnaissable. Et puis qui pourrait chanter des choses telles que Rod of Iron ou Sexualized ? Jarvis Cocker, qui s'amuse, joue les méchants pour rire, notamment lors de deux clips hilarants offerts en bonus sur le disque. Heavy Nite With n'est donc pas du tout une œuvre sérieuse comme le furent les ultimes albums de Pulp. C'est un vaste divertissement, comme pour exorciser le fantôme du groupe qui a accompagné l'existence de Jarvis pendant plus de 20 ans. Un album brutalement dansant, parfois laborieux, mais essentiellement jouissif. Car au niveau du charisme érotico-mégalo, Jarvis n'a aucune leçon à recevoir de la part d'un Trent Reznor pré-retraité, bien au contraire.
Au final, l'album de Relaxed Muscle est une excellente petite sucrerie, à la fois électronique, pop et un peu métal sur les bords, grâce aux compositions d'un échappé d'Add N To X. Idéal pour incarner un certain son de notre époque. Et Heavy Nite With est évidemment vital à tous les fans de Jarvis Cocker. Il contient de surcroît, en conclusion, Mary, une merveilleuse chanson grandiloquente et cynique, qui aurait très bien pu trouver sa place sur un album de Pulp.
7

Blondie - The Curse of Blondie
Écouter Blondie en 2003 demandait sans doute la mise en œuvre d'une nostalgie sans failles. Et une affection inaltérable pour Deborah Harry et ses petits camarades. J'ai toujours tellement aimé Blondie que l'on ne peut raisonnablement pas me demander de faire preuve d'une quelconque objectivité face à The Curse of Blondie. Au contraire, après la demie-déception du dernier Creatures (expérimental mais peinant à décoller), je ne peux que laisser parler mon cœur pour vous affirmer que le dernier Blondie est vraiment excellent. En tout cas très supérieur à No Exit. Les chansons sont ici majoritairement réussies, d'une qualité pop impressionnante et largement plus charmantes et charmeuses que ce qui se commet habituellement dans le domaine de la variété internationale.
Certes, ce n'est pas aussi bien que les grands chefs-d'oeuvre des débuts du groupe, mais nous ne sommes plus en 1978 et malgré tout, ici et là, il reste des perles flamboyantes. Tel cet Undone motivant ("la la la la la"), ce Golden Rod costaud (idéal pour survivre aux transports en commun), ce Background Melody adorable, ce End To The End parfait (le Maria de l'album), ce Hello Joe émouvant ou ce Desire Brings Me Back surprenant. Une bonne moitié du disque est immédiatement accrocheuse et enthousiasmante. Certes, certains arrangements sont discutables, mais les mélodies abondent et la voix de Debbie Harry est toujours sublime. Loin d'être une déception, voilà l'un des grands moments musicaux de l'année.
6

The White Stripes - Elephant
En 2003, on nous aura encore fait le coup du "meilleur groupe de rock du monde", la litanie préférée des critiques blasées qui aimeraient ne pas se sentir si larguée par leur époque. Si personnellement j'y suis allé de mon petit couplet sur Grandaddy, pour la majorité des gens qui aiment le rock et qui en causent plus ou moins bien, le nom des White Stripes aura fusé de toutes parts. Le meilleur groupe de rock du monde, ce sont eux, Jack et Meg White, frère et sœur, duo improbable et totalement idéal, moulinant des hymnes rocks comme si on était encore en 1965. Bien sûr, certains auront proposé des alternatives à cette hégémonie. Mais bon, après maintes écoutes, je ne pourrais qualifier des énervés comme The Kills que de laborieux et les pingouins de The Rapture que d'immondes (ou peu s'en faut, et croyez-moi je me suis enfilé leur Echoes plus d'une fois, cherchant en vain ce qu'on pouvait bien leur trouver de si palpitant (The Cure version Casio ?)). Et avec des groupes aussi pittoresques que Kings of Leon, on sent déjà poindre le revival Black Crowes (voire Pearl Jam), bref, ça craint un petit peu quand même.
Alors il y a les White Stripes, et leur Elephant, qui s'est vendu par camions entiers un peu partout dans le monde. Avant même d'être de la musique, les White Stripes sont tout un concept. Le duo est terriblement charismatique, clame son indépendance et son intégrité sur tous les tons. On retrouve même un flagrant hommage (involontaire ?) à Queen dans les notes de pochette. "Aucun ordinateur n'a été utilisé lors de la création de cet album", un peu comme le "No synthetisers" qui était la fierté du groupe de Freddie Mercury dans les années 70. Bref, avant même d'avoir inséré le disque dans le lecteur, on soupçonne que les White Stripes ne sont pas sérieux.
Et Dieu que l'on a raison ! Elephant est un disque de rock crétin, profondément basique, comique et légèrement débile, qui dégage une sympathie et une efficacité évidentes et radieuses. C'est con, mais c'est bon. Et vraiment bon. C'est du spectacle et rien que du spectacle (Queen, encore !). Jack White est beau et sexy, il fait craquer les filles (et les garçons aussi). Meg White est belle et sexy, elle fait craquer les garçons (et les filles aussi). Leur musique est carrée, directe, mille fois entendue partout, mais elle s'écoute avec une facilité et un plaisir indéniable. A part le Britney Spears, je n'ai pas entendu d'équivalent en 2003.
Elephant s'ouvre sur le terrible single Seven Nation Army, porté par l'un des riffs les plus simplistes de l'histoire du rock, mais forcément diaboliquement efficace (cf. Paranoid, Smoke on the Water, Like a Hurricane ou Smells Like Teen Spirit). Et tout l'album est dans cette veine, à la fois d'une sincérité absolue et proche de la parodie (la reprise hilarante du I Just Don't Know What To Do With Myself de Burt Bacharach). Le son de guitare est énorme, gras, saturé, quelque part entre les Rolling Stones de la grande époque et Led Zeppelin, le tout dans un format punk. Même si Jack White se permet un petit plaisir onaniste en milieu d'album avec un Ball and Biscuit interminable, qui m'a étrangement rappelé le I Want You de Lennon paumé dans le gracieux Abbey Road.
Mais pour une petite lourdeur, le groupe fait souvent mouche, même sur les petites ballades délicieuses façon In The Cold, Cold Night ou You've Got Her In Your Pocket. Certes, il n'y a pas la moindre once du début de l'ombre d'une touche d'originalité dans la musique des White Stripes. Chaque note, chaque gimmick, chaque parole, chaque intonation, est prévisible et évoque quelque chose que l'on a déjà entendu auparavant. Mais l'emballage ne laisse pas le temps de bougonner. Il n'y a pas de demie-mesure, on accroche à ce vaste Lego (justement), fait de pièces rapportés de partout, ou alors on déteste en bloc.
Les excellents rocks costauds sont légions, au hasard Black Math, The Hardest Button To Button, Little Acorns, Hypnotize, The Air Near My Fingers (avec le riff de Smells Like Teen Spirit, tiens donc)... Et même une rigolote blague finale avec Well It's True That We Love One Another. Qui vient bien confirmer l'immense capacité des White Stripes à clouer leurs refrains et autres petits trucs bien profondément dans notre cerveau (mais pitié, libérez-moi du riff de Seven Nation Army !).
Bref, c'est vrai, Elephant est le disque de rock pour tous de l'année 2003. On peut le passer en famille, pour Noël et le Réveillon, on peut le faire écouter à sa petite sœur qui regarde Star Academy, comme à son grand frère qui écoute Lou Reed et Radiohead, à son papa qui aime bien les Stones et à sa maman qui aime bien Abba. Bref, tout le monde aime les White Stripes. Parce que c'est drôle et bien foutu, sexy et clinquant, qu'il y a bien là une bonne part de l'âme du rock'n'roll et que de toute façon, à la fin, l'amour que l'on reçoit est égal à l'amour que l'on fait.
5

Plaid - Spokes
Aux premières écoutes, on note qu'avec Spokes, le duo de Plaid marque un réel désir de relancer ses recherches et de ne plus essayer de flirter avec un vague format "pop" qui rendait la visite de Not For Threes, Rest Proof Clockwork et Double Figure si facile et si plaisante. Sur ce nouvel album, seule une très lointaine contribution vocale en ouverture du premier morceau offrira à l'auditeur inexpérimenté un guide vers les méandres électroniques. Bien souvent, Spokes ira même flirter sur les terres d'un Aphex Twin très remonté ou d'un Autechre un peu moins abscons qu'à l'habitude. Si certains morceaux, tel le quatrième, portent avec évidence la patte de Plaid, d'autres sont plus étranges, et certainement plus difficiles à apprivoiser que sur les albums précédents.
Mais cette première impression se révèle relativement fausse au fil des écoutes. Et l'on en vient bientôt à penser que le principal défaut de Spokes est d'être, encore une fois, à peu près la même chose que les précédents disques de Plaid. Les innovations, bien réelles, ne parvenant pas forcément à masquer le classicisme de certains compositions. Puis, on écoute encore. On laisse passer du temps. Plaid, plus que n'importe quel autre groupe de musiques électroniques, réclame de la patience, de l'attention, de l'investissement. Un don de soi que l'on n'est pas toujours susceptible d'offrir. On pourra ainsi très facilement passer à côté des trésors de Spokes. Dans la précipitation, on laissera échapper l'essentiel. La beauté inestimable de certains morceaux nous effleurera sans qu'on lui laisse le temps de nous atteindre. L'ambiance, très sophistiquée, qui demande calme et bienveillance, n'aura pas le temps de nous imprégner. Nous ne serons touché que par quelques gouttelettes éparses. Mais cela sera suffisant. Cela a été suffisant.
Car, je suis revenu, régulièrement, vers Spokes. M'approchant toujours un peu plus de son cœur palpitant. J'ai eu du mal à aller plus loin que cette impression tenace de déjà entendu. Et c'est dans le lointain, dans les limbes d'une production qui n'a jamais été aussi complexe, que j'ai découvert ce qui fait le prix de cet album : son atmosphère rêveuse très éthérée et étrangement émouvante. Certes, ce n'est pas avec ce disque que les réfractaires au style de Plaid vont succomber, mais on leur conseillera encore et toujours l'écoute. Pour les autres, l'acquisition est évidemment indispensable. Chacun reconnaîtra sans problème le "son" de Plaid, avant de se faire happer par les nouveautés et les qualités innombrables de Spokes. Et une nouvelle fois, l'ultime morceau de l'album flirte avec le sublime, on n'en demandait pas moins.
4

Frank Black & The Catholics - Show Me Your Tears
Si c'est avec le concert parisien de fin novembre que les chansons de Show Me Your Tears me sont apparues sous un jour nouveau, ce n'est qu'à la toute fin de l'année que je suis véritablement tombé sous leur charme. Dans les premiers temps, il m'a déçu par la banalité de sa forme et par son impact global, bien inférieur au terrible Black Letter Days de l'année précédente. Frank Black était toujours triste, mais il ne retrouvait pas la grâce de End of Miles, Southbound Bevy ou I Will Run After You. Mais c'est finalement plusieurs mois après, au détour d'un couloir de métro, ou de d'un train, que l'émotion de Show Me Your Tears m'a frappé. Et la qualité toujours admirable des chansons m'a semblé d'autant plus évidente.
Certes ce n'est pas original, certes cela manque parfois d'énergie, de flamme, de surprises, mais on est touché malgré tout. Et le plaisir est intense, omniprésent. Dès l'ouverture brutale de Nadine jusqu'à l'hymne Manitoba, Show Me Your Tears regorge de perles. En particulier l'incroyable Horrible Day, chanson de l'année, aux côtés du thématiquement proche Now It's On de Grandaddy. L'épique Massif Centrale, les émouvants My Favorite Kiss, When Will Happiness Find Me Again et Coastline. Et les surprenants This Old Heartache et The Snake. Bref, un nouveau grand disque à l'actif du sieur Charles Thompson.
3
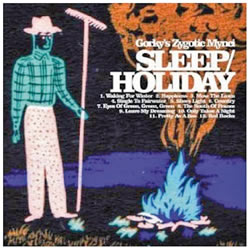
Gorky's Zygotic Mynci : Sleep/Holiday
Comme je le disais au moment de la sortie de Sleep/Holiday, la discrétion des Gorky's Zygotic Mynci devient proverbiale. Plus leur musique devient apaisée, intime et fragile, plus le groupe semble disparaître à notre vision, s'évanouir dans le brouillard du petit matin. Car, non, ce n'est pas demain que les Gorky's recevront les faveurs des médias et du grand public. Plus le temps passe, plus une carrière à la White Stripes ou même à la Grandaddy s'éloigne de leurs ambitions. Ils se sont installés à la campagne et regardent filer l'existence avec nostalgie et humour. Avec sagesse.
Le seul véritable défaut de Sleep/Holiday est d'être finalement trop similaire, dans son ambiance et dans son propos, du magnifique How I Long To Feel That Summer In My Heart qui l'avait précédé. Il apparaît comme une coda luxueuse au chef-d'oeuvre du groupe, mais sans surprises et avec une qualité de composition globalement moins mémorable. Et même un vilain faux-pas dès la seconde chanson de l'album. Heureusement, cette faiblesse est unique. Car Sleep/Holiday, considéré en lui-même, est un disque d'une grâce infinie, peuplée de mélodies cristallines, de textes acerbes ou mélancoliques, d'arrangements somptueux et d'une âme tremblante.
On a envie de prendre soin de cet album, de ce groupe, tant, même sous leurs aspects les plus folks et les plus exaltés, ils semblent fragiles et un peu errants. La bande son des journées d'introspections un peu grises et un peu ensoleillées, en mars, en septembre, ou n'importe quand, ou tout le temps. Et après deux longues fresques silencieuses, Sleep/Holiday se conclut sur une composition parfaite, bouleversante dans sa délicatesse onirique, saisissante parce qu'elle semble s'adresser directement à nous, sans l'intermédiaire d'un quelconque support, ni d'une quelconque technologie. Il n'y a plus que la voix d'Euro Childs et nous. Et l'on reste sous son charme, longtemps, très longtemps après la fin du disque.
2

The Unicorns - Who Will Cut Our Hair When We're Gone ?
Ce n'est qu'en toute fin d'année que je suis tombé sur le disque pop idéal pour 2003. Léger, comique, mais superbement emballé dans un faste louable de mélodies, d'arrangements et de chœurs aériens, l'album des Unicorns ne cesse d'impressionner au fil des écoutes. 13 morceaux en 40 minutes, moins de 3 minutes pour la plupart, certains se permettant même moitié moins. Le format parfait pour de la pop qui coule de source. Riche de promesses pour la suite. La musique des Unicorns est à la fois très classique, ne révolutionnant rien de l'héritage des Beatles ou des Beach Boys, voire de Blondie (ça en fait des groupes en B...). Avec parfois des guitares en avant, comme chez les Kinks. Il y a bien sûr un peu de cet air du temps qui, des Strokes au White Stripes, veut nous faire croire que le rock'n'roll, my, my, hey, hey, is here to stay.
Mais on leur pardonne, parce qu'ils n'ont décidément pas la patte lourde et que leur écriture sait rester humble, bondissante et pour tout avouer assez ravissante dans l'ensemble. Et puis il y a cette déprime gaie que j'adore, ces paroles morbides qui filent à toute allure sur des mélodies du bonheur. Car depuis les Beatles nous avons quand même eu les Talking Heads et les Pixies (Unicorns ? Pixies ? Encore une histoire de fées, ça), et il est toujours bon de s'en souvenir. Et même lorsque le son des Unicorns se durcit et que la chanson s'offre cinq minutes, elle sait retrouver au final des accents rêveurs qui charment à coup sûr. Et les quelques influences électroniques sont ici parfaitement amenées et nous sommes à des années lumières des calamiteux The Rapture.
Ici, on chante "I Hate You", mais en riant, avec un petit bazar de sons idiots et de chœurs de dessins animés. Pas très loin de ce que pourrait faire un Jason Lytle de Grandaddy si sa dépression chronique le laissait en paix pendant plus de 26 secondes. On reste admiratif devant la puissance mélodique de ces petits fragments pop, car c'est loin d'être donné à tout le monde d'écrire un "I Was Born a Unicorn". Soudain, on se dit qu'il y a du Supergrass dans ce groupe (et pas seulement au niveau de la voix). Ce côté déconneur de génie, ce fourre-tout qui s'amuse des références tout en les respectant discrètement. Il y a à la fois l'énergie adolescente de I Should Coco et les expérimentations cinglées de In It For The Money, donc la synthèse drôle et inépuisable des deux meilleurs albums de Supergrass.
L'aspect "une idée à la seconde", pourra décontenancer certains ; pour les autres, tous les autres, ce sera le bonheur de se dire que l'esprit d'un Brian Wilson (avant la folie narcotique) ou d'un duo de choc Lennon/McCartney (avant l'explosion en vol) est toujours diablement vivace. Alors ? Alors, ce joyeusement funèbre Who Will Cut Our Hair When We're Gone est LA découverte de l'année ! Et les Unicorns le meilleur groupe de pop de 2003. Trois fois rien, donc.
1 ex-aequo
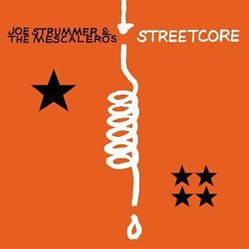
Joe Strummer & The Mescaleros - Streetcore
On a beaucoup parlé du retour du "rock" cette année. On a loué les White Stripes pour leur fidélité aux règles les plus basiques de l'essence du rock'n'roll. Une guitare, une batterie, et puis une basse s'il en tombe une par ici, mais bon, pas obligé non plus. Et pas d'ordinateurs. Et vas-y donc qu'on mouline du Rolling Stones de 1965. Louable, oui, si les chansons tiennent la route. Mais il manque un petit peu d'âme, un petit peu de cœur, qui donnerait une vraie dimension à tous ces nouveaux groupes de pur "rock".
Et pourtant, en 2003, le disque idéal de Rock, avec une majuscule, je vous prie, était bien là, à porter de la main. Et attention, pas un disque de vieux con, pas (seulement) un disque de nostalgique, pas un disque embué par une complaisance pour un artiste que l'on a adoré avec passion. Non, non, objectivement, oui monsieur, oui madame, oui mademoiselle, oui petits et grands, objectivement ! Le meilleur des disques de rock possibles. Avec tout ce que l'on peut attendre d'une telle œuvre.
Beaucoup de guitares, beaucoup d'énergie, un peu de maladresse, pas mal de révolte, un respect pour le passé et de bons coups d'oeil vers le futur, une sincérité qui déborde de partout, de la "rock attitude" en veux-tu en voilà, de l'électricité, de l'acoustique, des chœurs, des textes qui touchent aux tripes, au cœur, à l'âme, et une putain d'émotion qui explose sur dix chansons comme on n'en a pas entendu des tonnes cette année.
Tout cela, je vous le garantis, est présent sur l'album de Joe Strummer & The Mescaleros, Streetcore. L'album posthume de Joe Strummer, l'ex-leader de The Clash (pour ceux qui ne suivent vraiment rien), décédé il y a tout juste un an. Et son ombre de géant aura plané jusqu'à la conclusion de 2003, grâce à un ultime disque, sans doute le plus accomplit de sa très discrète carrière solo. A vrai dire, en écoutant pour la première fois Streetcore, on s'attendait surtout à laisser jouer la nostalgie, on ne demandait rien de plus à cet album que de raviver le souvenir de monsieur Strummer et cela aurait largement suffit.
La claque est d'autant plus effroyable. Car ce disque n'a rien d'une oraison funèbre, d'un testament ou d'un caveau poussiéreux. C'est une collection de 10 chansons parfaites, qui de la première à la dernière minute nous mettent le cul par terre. Bref, malgré toute notre admiration, on avait fini par croire que Joe Strummer ne pouvait plus nous surprendre, ne pouvait plus tenir vraiment tête à tous ces plus ou moins jeunes qui lui ont succédé depuis Combat Rock (quoi Cut The Crap ?). Et là, vlan ! Écoutez All In A Day et balancez les Kills et les White Stripes par la fenêtre. Du rock, hénaurme, aucunement obsolète mais au contraire parfaitement à sa place au sein de l'année 2003. Du rock qui aurait fort justement voyagé dans le temps depuis 1979 et qui aurait atterrit juste au bon moment, aujourd'hui, maintenant. Avec juste ce qu'il faut de nostalgie et largement de quoi regarder vers l'avenir avec espoir.
Dès la première chanson, Coma Girl, on se pince, on croit rêver. Merde alors ! Une chute de London Calling ? Non, non, un vrai nouveau morceau, qui n'aurait pas fait tâche au sein du "plus grand disque de rock du 20e siècle". Ca donne le ton, ça met tout de suite d'accord. Bien sûr, on est déjà submergé par l'émotion. C'est trop de souvenirs, trop de regrets et en même temps trop de vie, trop de plaisir de la part d'un foutredieu d'album posthume. Si sur Get Down Moses, Joe Strummer se laisse un peu aller dans sa veine "world", c'est sans doute la seule chanson un peu plus "faible" du disque. Tout le reste est incroyable.
Sur Long Shadow, Joe Strummer tutoie la country et la folk avec une légèreté surprenante. Zut alors, on ne savait pas le Joe capable de faire danser le fantôme de Hank Williams avec autant de facilité et de sincérité. Il faut dire qu'il avait la voix pour cela. Juste cassée comme il le fallait. Magnifique. Arms Aloft est un rock carré d'une étonnante modernité dans son classicisme même. Et d'une efficacité qui charme. Ramshackle Day Parade est une ballade pop qui a nouveau surprend (décidément). Ici Joe flirte avec un format FM prêt à faire pleurer dans les chaumières. Mais on y croit dur comme fer. Parce que c'est Joe Strummer, sa voix, ses textes, son talent pour les mélodies brisées.
Puis, tout en acoustique, la voix en avant, il reprend Bob Marley et son Redemption Song, comme s'il s'agissait d'un standard du "protest song". Un hymne aussi bien pour résister au monde entier dans son salon, qu'au sein d'une manif, ou autour d'un feu, dans un métro bondé, dans une rue déserte, dans le matin gris ou le soir solitaire. Déchirant et bourré de promesses. All In A Day, comme je l'ai dit plus haut, renvoie chez leur maman la majorité des "nouveaux" prodiges rock. Alors, certes, il y a des petits jeunes qui font cela fort bien. Mais chez Joe, il y a cette fameuse "âme" en bonus. Sur Burnin' Streets, Strummer enterre une bonne fois pour toute le cadavre encombrant du Clash, et même si la chanson est une ballade pop-rock, elle se vêt d'arrangements superbes et d'une force mélodique imparable. Sur Midnight Jam, Joe Strummer erre, refusant de baisser les armes, refusant de mourir, laissant son œuvre en suspend, à jamais inachevée, offerte à tous ceux qui voudront bien reprendre le flambeau après lui.
Et au final, on est ému jusqu'aux larmes sur la reprise de Silver and Gold, qui réconcilie soudainement le punk le plus anglais avec le rock américain, en évoquant le souvenir d'un autre récent grand mythe disparu, le Man In Black, Johnny Cash. Immense, bouleversant, génial, tout est là. Joe Strummer ne jouait pas du rock, il était lui-même l'essence du rock. Cet ultime album, disque de l'année ex-æquo de votre serviteur, est là pour le prouver, si jamais il en était encore besoin.
1

Grandaddy - Sumday
Le plus grand groupe de rock, ce sont eux. Et si je suis le seul à le dire, peu importe. Cette année aura été portée et emportée par la voix de Jason Lytle. Héros malgré lui de tous mes idéaux musicaux. Délicatesse, mélodie, déprime pleine d'humour, mélancolie galopante, poésie à tous les étages, la musique de Grandaddy est composée de tout cela. Bande son parfaite de tous les instants de l'existence.
Quand on souhaitait ressusciter au monde et repartir vers des lendemains gorgés de lumière, Now It's On était l'hymne. Quand on boudait l'altérité étouffante, on chantonnait I'm On Standby et The Go and the Go For It. Quand on aspirait à un peu de calme, on glissait dans le torrent de Lost On Yer Merry Ways. Quand on voulait verser une larme sur les possibles passés, présents ou futurs, on se noyait dans les sublimes Yeah Is What We Had et The Warming Sun. Quand on acceptait la déprime avec un sourire aux lèvres et un peu de vague à l'âme, on libérait les flots de OK With My Decay. Enfin, on méditait, un peu perdu, un peu rêveur, sur l'avenir qui s'ouvrait à chacun de nos pas en laissant résonner les échos de The Final Push To The Sum.
On demandait à Grandaddy un monument, une cathédrale de cristal à l'image de l'insurpassable Sophtware Slump. Ils nous ont offert un recueil d'une dizaine de chansons indépendantes, qui finissent pourtant par être indissociables, sous les reflets bleutés de la merveilleuse pochette et au fil du rythme de l'année. Plus immense encore après un concert parisien traumatisant, Jason Lytle est devenu l'artiste incontournable vers lequel toute notre affection s'envole sans limites.
Le temps n'est définitivement plus à l'étonnement devant ces bons ados attardés, terriblement américains et fans de skate et de bière. Ils ont dératisé les clichés les plus mesquins et offerts la musique la plus pure, la plus évidente, la plus touchante, la plus triste et rêveuse de l'année. Sumday a l'âme des œuvres qui peuvent nous accompagner très longtemps, peut-être pour toujours...