Je n'ai pas cessé de le répéter, mais l'année cinématographique 2003 fut en tout point exceptionnelle. Jamais le top 10, futile et indispensable, n'a été aussi difficile à établir. Il n'aura d'ailleurs jamais connu une telle ampleur sur ce site.
Difficile, oui, ce classement vain et jouissif, tellement difficile que je me suis trouvé dans l'obligation de faire ce qu'il ne faut jamais faire, c'est à dire accorder une première place ex-æquo. Une première place scindée, donc, mais offertes à deux œuvres si dissemblables qu'elles y trouvent chacune un écrin tout particulier. Mais bon sang, quelle année !
Au fil de ce suspens trivial que je vous propose ci-dessous, vous pourrez découvrir des chroniques entièrement neuves, notamment dédiées à des films non évoqués ailleurs dans The Web's Worst Page.
Je précise juste que l'absence de Kill Bill Volume 1 est parfaitement intentionnelle. L'oeuvre formant un tout indissociable et ayant été fractionnée assez artificiellement. Nous retrouverons donc le dernier Tarantino, sans doute en bonne place, dans le top 2004 (je sais, c'est loin...).
Et maintenant, place au spectacle, qui vont donc être les successeurs de Jin-Roh, Yi Yi, Avalon et du Voyage de Chihiro ?
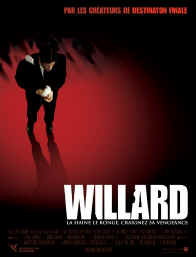
10
Willard
Il serait facile de ne retenir de Willard que Crispin Glover. Après tout, il est la principale qualité de cette estimable série B aussi classique que plaisante. Un film qui aurait pu n'être qu'une goutte d'eau dans l'océan des sorties de 2003, s'il n'avait pas bénéficié de quelques attraits propres à éveiller l'attention. Tout d'abord, une forme très soignée. Une chouette musique elfmanienne, une mise en scène impeccable et surtout une photographie de toute beauté. Bref, chez Willard on sait nous recevoir.
L'histoire est excellente, même si assez banale au premier abord, la description des névroses de son anti-héros fait preuve d'une finesse louable. Et puis tous ces rats sont crédibles, voire touchants. Enfin, bien sûr, il y a Crispin Glover, que l'on savait déjà idéal dans les rôles gravement psychotiques, mais qu'on ne connaissait pas aussi nuancé et émouvant. Willard est sans doute une œuvre portée par son interprète principal. Mais la performance de Crispin Glover permet au film d'être l'un des plus mémorables de l'année.

9
Hero
Un début de polémique aura entouré la sortie française de Hero. Le film semblant, au final, prôner le sacrifice de l'individu, même le plus extraordinaire, sur l'autel de la raison d'Etat et du bien commun (rien de très original depuis le théâtre grec, donc). On y a vu un semblant de propagande communiste. Certes le film de Zhang Yimou peut prêter à une telle lecture, mais ce serait oublier la première heure de métrage et les valeurs et autres chemins de traverse qui nous y sont proposés. Car le metteur en scène conte avant tout une légende, très vaguement historique, qui lui permet de déployer des fastes visuels tétanisants et d'enchaîner les scènes taillées dans le cœur même du mythe.
Visuellement, Hero est d'une beauté stupéfiante, quasi irréelle. Par instant on est totalement écrasé par l'emphase et la force de ces plans parfaits. Si le film bouleverse, c'est plus par sa forme que par ce qui est dit. Mais peu importe, car au final, Hero touche en plein cœur. Pendant 1h40, l'oeuvre n'aura avancé que par l'intensité de l'instant, de l'image, du geste, de la réplique. Et si à ce niveau, les deux œuvres de Kitano lui sont infiniment supérieurs, le film de Zhang Yimou mérite bien des louanges. Ne serait-ce que pour ses acteurs, tous dotés d'un charisme tétanisant. Ainsi que pour ses scènes de combats, follement chorégraphiées. Et même si Hero est une "réponse" à Tigre et Dragon, les deux œuvres sont très dissemblables. Et sans doute complémentaires.

8
X² - X-Men United
Le monde du blockbuster hollywoodien fut égal à lui-même en 2003, capable du meilleur (l'enthousiasmant Terminator 3, le jouissivement débile Charlie's Angels 2, l'hilarant Destination Finale 2...), comme du pire (Bad Boys 2, Solaris, Daredevil, Matrix, LXG...) en passant par le passable (Les Pirates des Caraïbes). Il aura surtout enfanté deux œuvres hors du commun. Dans un premier temps un grand "film malade", le Hulk de Ang Lee, détesté par presque tout le monde et qui a pourtant proposé une vision originale de la désormais incontournable adaptation de Comics. La mise en scène carrément expérimentale de Ang Lee suffit à faire de Hulk l'un des films les plus originaux et intéressants de l'année.
Mais c'est d'ailleurs qu'est venu LA très bonne surprise de l'année. Après un premier X-Men décevant, Bryan Singer a revu presque entièrement sa copie et a finalement trouvé le ton juste. A la bouillie pas très palpitante et parfois ridicule du premier film, Singer préfère une vraie construction dramatique, avec des personnages plus développés, un rythme plus apaisé et des enjeux vraiment prenants. Chaque mutant, ou peu s'en faut, voit son histoire enrichie et s'offre plusieurs morceaux de bravoure. Le film acquiert l'esprit des Comics, leur violence outrancière, leur démesure, leur emphase dramatique, mais aussi leur poésie, leur émotion. Des supers-héros comme s'il en pleuvait, oui, mais des super-héros humains, ambigus, avec leur super-pouvoirs mais aussi leurs faiblesses, leur part d'ombre, leurs doutes, leurs maladresses.
Mais sans forcer le trait, sans tomber dans la caricature et le grotesque. Pour preuve, le magnifique Diablo/Nightcrawler, dont tout le monde a chanté les louanges, ainsi qu'un Wolverine enfin passionnant. Mais ils ne sont pas les seuls et, grâce à un excellent casting, les X-Men parviennent à exister sur grand écran. Et les scènes marquantes abondent, telles l'ouverture sur l'attaque de Nightcrawler, la prise d'assaut de l'académie du professeur Xavier, l'évasion de Magneto, le combat Wolverine/Lady Deathstrike, la rupture du barrage... Le film de Bryan Singer, dans sa richesse, dans ses audaces, dans son final emphatique, vient rappeler de manière troublante l'inégalable Batman Returns de Tim Burton. Et oui, c'est aussi bien que cela !

7
Lost In La Mancha
La réalité, toujours elle, décidément au coeur des préoccupations de nombreux grands cinéastes en 2003. La réalité dans sa complexité, son injustice flagrante, ses souffrances quotidiennes, mais aussi ses éclairs de bonheur. Dans le documentaire Lost In La Mancha, les "moulins de la réalité contre-attaquent" et triomphent du Don Quichotte de Terry Gilliam. Projet cinématographique ambitieux et chérit depuis une décennie par le génial ex-Monty Python. Un projet risqué, qui dès le début enchaîne les catastrophes, s'élabore dans le chaos et accumule une malchance incroyable. Ce serait de la fiction que l'on trouverait cela trop gros pour être vrai. Seule la réalité peut aller aussi loin dans la cruauté et l'humour noir.
Devant nos yeux, un possible chef-d'oeuvre vogue vers la haute mer, puis prend l'eau de partout, avant de sombrer corps et biens. Et c'est plus impressionnant que Titanic, croyez-moi ! Pourtant Gilliam a des idées et de l'enthousiasme à revendre, Jean Rochefort est impérial, Johnny Depp égal à lui-même et toute l'équipe est composée de gens intelligents et brillants. Tout est là. Tout est réuni pour une réussite exceptionnelle. Mais la réalité aura la peau de Don Quichotte. Ce "making-of" (making-off ?) est alors tour à tour magique, hilarant, déprimant, angoissant, terrible. Et s'achève sur un vague espoir et une tristesse insondable. Une œuvre vivante, en somme.

6
Arrête-Moi Si Tu Peux
Pour le moins, Steven Spielberg est un créateur ultra productif du 7e art. Ce monsieur a le don d'ubiquité, ce n'est pas possible autrement. Réalisateur d'au moins un long-métrage par an, producteur, homme d'affaires, père de famille nombreuse, personnalité médiatique, Spielberg est partout, tout le temps, et le plus souvent avec brio. Présenté ainsi, son Arrête-Moi Si Tu Peux, prend des allures de vraie-fausse autobiographie, soigneusement désamorcée sous le prétexte de l'adaptation de faits réels. Il n'y a pas de Spielberg dans ce film, voyons ! Vu que l'on parle ici de la rocambolesque existence de Frank Abagnale Jr., faussaire précoce génial. La matière idéale pour créer une comédie classe, pleine de charme et d'une bonne part de la magie des années 50 et 60. En ce sens, Catch Me If You Can est le plus pur film hollywoodien de l'année (stars, glamour, clinquant, belle histoire exemplaire...).
Mais c'est aussi l'une des œuvres les plus personnelles de Steven Spielberg, peut-être la plus intime depuis la Liste de Schindler (A.I. mis à part). La légèreté de son ton, la fluidité de sa mise en scène, ont laissé penser à beaucoup que nous étions là face à une œuvre "mineure". Car la comédie, même teintée de drame, sera toujours considérée, sur l'instant, comme moins "importante" que les créations au sérieux imperturbable. Pourtant, cette grâce à la fois classique et très contemporaine, qui habite Catch Me If You Can, réserve de jolis moments d'émotions, de très bons gags, de superbes images et quelques performances d'acteurs admirables (le génial Christopher Walken en tête). Avec discrétion, Steven Spielberg a signé en 2003 l'un de ses meilleurs films. Nul doute que le temps lui offrira la place qu'il mérite. Et que nous ne sommes pas près de nous en lasser. Merveilleux.
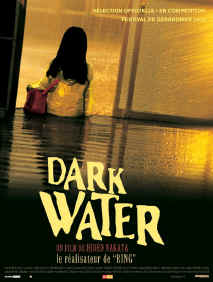
5
Dark Water
Parvenir à mettre en scène un film d'épouvante qui soit à la fois terrifiant et émouvant n'est pas seulement un tour de force. C'est un fait exceptionnel et de nombreux metteurs en scène de génie ont échoué devant la difficulté de la tâche. Hideo Nakata avait déjà prouvé avec Ring qu'il pouvait offrir un cinéma totalement effrayant, très sobre, maîtrisé, étrange et envoûtant. Avec Dark Water, il reprend certains éléments qui ont fait la force de Ring (la petite fille maudite, l'attente, la mère de famille traquée, le crescendo dans l'horreur qui vampirise peu à peu le quotidien...), et y ajoute une humanité touchante.
Une émotion qui surgit du rapport entre la mère et sa fille et qui culmine dans une coda bouleversante, inattendue, qui renforce le malaise tout en décuplant l'impact de l'oeuvre. L'épouvante nous envahit alors totalement, face à cette réalité qui bascule peu à peu et à ces scènes chocs terriblement efficaces. En arrière-plan, des angoisses qui n'ont rien de fantastiques surgissent. La peur de l'abandon, de l'absence, de la séparation, de l'effondrement de la sécurité de la famille, la disparition des habitudes, des repères, des certitudes. Le lent basculement de l'existence vers le chaos, la folie, la solitude, la mort. Dark Water évoque tous ces thèmes avec une finesse qui surprend. Derrière l'histoire de fantôme se cache le conte de nos peurs les plus familières, les plus banales et les plus douloureuses. Terrifiant.

4
Dogville
Comme un David Lynch, boudé pour son chef-d'oeuvre Fire Walk With Me, c'est au moment où Lars Von Trier signe son meilleur film que Cannes lui tourne le dos. La mode est passée. Mais cela importe peu, bien peu, face à la surprenante réussite qu'est Dogville. Pourtant, on pouvait craindre une énième manipulation de la part d'un metteur en scène roublard qui avait depuis longtemps chassé la sincérité de son œuvre, au profit de ce que le public attendait de lui. Après les sommets de guimauve et de cynisme horripilants, vaguement dissimulés sous des expérimentations très discutables, qu'étaient Breaking The Waves et Dancer In The Dark, on pouvait attendre le pire de ce Dogville. Un énième chemin de croix d'une jeune femme innocente, face à la cruauté humaine. Le tout emballé dans trois heures de mise en scène théâtrale et porté par la performance d'une actrice de renom. Cela sentait le piège ! On se méfiait. On y allait presque à reculons.
Mais dès le prologue, on est surpris. La mise en scène s'avère fascinante, immédiatement cette ville nous happe, on est émerveillé par le foisonnement des idées, par leur précision, leur efficacité, parfois par leur poésie. Peu à peu, on s'intéresse aux personnages, on se passionne pour ce suspens qui ne ressemble à aucun autre. Et on trouve Nicole Kidman géniale, ce qui n'est pas la moindre des révélations du film. Certes, on peut pester contre la complaisance de Von Trier dans sa description du calvaire de Grace. On est gagné par le dégoût, mais c'est le but recherché. On craint pourtant un autre final christique, mélodramatique, pour faire pleurer les midinettes. Et si l'on reste admiratif d'un bout à l'autre devant l'esthétique du film et la force de son récit, on est un peu sur la défensive face à sa probable conclusion.
Mais c'est dans son épilogue que Dogville touche au génial. Prenant à contre-pied la morale, mais répondant aux attentes plus ou moins inconscientes du spectateur, Von Trier nous balance un concentré de vérités humaines dans la gueule. Un acte aussi bien provocateur, politique et malin que finalement courageux et sincère. Comme si le metteur en scène en était arrivé à un degré supérieur de sa réflexion, de son étude des hommes et qu'il osait nous faire profiter de son point de vue tout neuf. Dans ses dernières minutes, Dogville saisit à la gorge, ravit par son ambiguïté et son refus manifeste de répondre aux questions qu'il pose. Une impressionnante réussite, aussi novatrice dans sa forme que dans son propos.
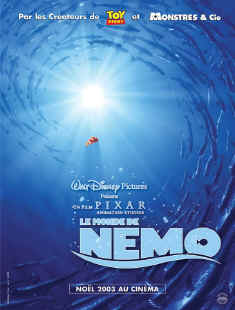
3
Le Monde de Nemo
Cela fait longtemps maintenant que l'on attend le faux-pas du studio Pixar, proclamé ici et là plus grand créateur mondial de divertissements cinématographiques pour tous, enfants, adultes, animaux de compagnie, lave-vaisselles et autres portes blindées. Oui, car il est bien connu que l'on ne peut pas rester éternellement au sommet. Ce sommet artistique et commercial que Pixar a effleuré avec Toy Story et 1001 Pattes, avant de l'atteindre et de s'y installer glorieusement avec Toy Story 2 et Monstres & Co. Ce dernier s'imposant par ailleurs comme un pur chef-d'oeuvre, à tous niveaux. Mais bon sang, ces gens pouvaient-ils encore faire mieux ? Écraser un peu plus la concurrence ? Et montrer une bonne fois pour toutes qu'ils sont les seuls à donner encore un alibi artistique aux studios Disney ? Avec le monde de Nemo, non seulement Pixar a de nouveau fait exploser ses propres records au box-office, mais il a conquis, comme toujours, à la fois la critique et le public. Tout en signant son meilleur film et donc un grand chef-d'oeuvre. Et rien ne semble donner l'impression d'un possible fléchissement créatif du studio.
Le Monde de Nemo, parvient ainsi à être plus drôle, plus riche, plus beau, plus rythmé, plus divertissant et aussi émouvant que Monstres & Co. On croit rêver. D'ailleurs les 1h45 du métrage filent comme un songe, tant les gags et les rebondissements s'enchaînent sans le moindre temps mort. On est toujours surpris, hilare, fasciné, ému. Visuellement c'est sublime, bien sûr. Mais jamais Pixar ne s'est reposé sur ses performances techniques. Ce qui compte avant tout pour eux ce sont une bonne histoire, de bons gags, de bonnes répliques et de fabuleux personnages. Et au niveau des protagonistes, Finding Nemo est de très loin le plus incroyable des tours de force de chez Pixar. Des dizaines de caractères superbement écrits se succèdent à l'écran. Certes, cela va très vite, mais ils parviennent tous à exister. Et la majorité d'entre eux est inoubliable (ce qui est d'autant plus savoureux si l'on se réfère aux hilarants soucis de mémoire du plus émouvant des héros du Monde de Nemo).
Le film est bien sûr bourré de références, comme toujours, cela va des Dents de la Mer en passant par Abyss ou Psychose, et énormément aux Monty Python (Finding Nemo - Find The Fish... hum... hum...). Ah, certes, on ne peut pas trouver mieux que les Python en matière de références pour ce qui est de la comédie ambitieuse. Certains passages du Monde de Nemo semblent tout droit issus d'un épisode du Flying Circus (le "langage-baleine", par exemple). C'est vous dire si tout cela est drôle, fin, intelligent, humain et emplit de percées philosophiques délicieuses. Le prochain Pixar, The Incredibles, serait un mélange de Tex Avery, de Monty Python et de... Alan Moore.... Mon Dieu, mais ces gens vont-ils vraiment réussir à faire toujours mieux ??!!? |

2
Zatoichi
Affirmer que 2003 fut l'année Kitano tient du choquant euphémisme. Alors que Dolls ne cesse de grandir dans les cœurs, la fin de l'année nous a offert un nouvel exploit du maître japonais. On annonçait son Zatoichi comme une œuvre "légère", une détente après le sommet artistique de Dolls. Un film de genre, populaire, une variation sur les aventures du samouraï aveugle Zatoichi, héros traditionnel du cinéma japonais. Bref, ce devait être un petit ajout dans la si impressionnante filmographie de Kitano.
Le séisme est d'autant plus intense lorsque l'on découvre le résultat sur grand écran. Depuis Dolls, Kitano semble avoir atteint un tel degré de maîtrise de son art que rien ne peut l'entamer. On en vient même à oublier ses "anciens" grands classiques tels que Sonatine ou Hana-Bi. Son Zatoichi tient du chef-d'oeuvre absolu de la première à la dernière image.
La mise en scène, où l'on pourrait aussi bien reconnaître Kurosawa que Jacques Tati, et d'une virtuosité discrète qui laisse sans voix. Mouvements de caméra tour à tour délicats ou nerveux, rythme soutenu et fluide, prises de risques... Avec pour exemple l'utilisation du sang numérique, choix artistique audacieux, qui permet de contrôler avec la plus parfaite précision le moindre détail de la chorégraphie des combats, ainsi que de ralentir les gerbes de sang au sein même d'un plan à vitesse normale. L'effet obtenu est stupéfiant, unique. De même que l'exceptionnel travail sur la bande son, œuvrant tout aussi bien pour le burlesque que pour la puissance tragique de certaines scènes. La musique originale étant par ailleurs, malgré l'utilisation intensive des synthétiseurs, la plus marquante de l'année.
Et que dire de ce qui nous est conté ? Cela pourrait sembler banal de prime abord. Un étranger arrive en ville et il rétablir la justice. Un "super-héros" invulnérable ce Zatoichi, qui ne recule devant aucun exploit surhumain lorsqu'il s'agit de manier le sabre. Un Zatoichi interprété de manière hallucinante par Kitano, parvenant à être à la fois fort et fragile, drôle et inquiétant, et surtout émouvant. A l'image de l'ensemble du film. Puissant, dans ces combats brefs, dont l'intensité ne cesse de fasciner ; avec comme sommet, le duel entre Zatoichi et le garde du corps, superbe et tragique. Fragile, comme la démarche du héros, dans ses pauses mélancoliques, dans ses plans apaisés qui font trembler le cœur. Drôle, et même parfois potache, le film l'est aussi. Les gags sont nombreux et font respirer une histoire par ailleurs très dure.
Car l'émotion est omniprésente. Que ce soit à travers le sacrifice du garde du corps, faisant le choix de la corruption et du mal pour essayer de sauver sa femme malade. Ou dans la quête de vengeance de deux personnages totalement bouleversants, qui ne peuvent que nous faire sortir nos mouchoirs. En particulier lors d'un final étonnant sur un long numéro de claquettes (!!), qui fait rire, pleurer, nous ravit et nous fait quitter la salle avec le cœur battant plus vite, le sourire aux lèvres et l'âme émerveillée. Doublé historique en 2003, pour le moins, pour Takeshi Kitano. Deux chefs-d'oeuvre, deux moments de grâce. |

1 ex-aequo
Le Seigneur des Anneaux - Le Retour du Roi
Les attentes face au Retour du Roi étaient légitimement gigantesques. Le film qui devait achever cette trilogie rêvée et surtout donner un sens à l'ensemble de la fresque. Le film qui devait aller plus loin, plus haut, plus fort que les deux premiers réunis. Plus de spectacle, plus de drames, plus d'émotion, plus de magie. Il fallait tout cela. Bref, il fallait du jamais vu, de l'inimaginable ou du moins une œuvre qui puisse rendre justice à nos visions, à nos espoirs.
En sortant des 3h30 du Retour du Roi, les larmes aux yeux et incapable de reprendre contact avec la réalité, on est certain d'une seule chose, Peter Jackson est allé au-delà de nos rêves. Dans sa version courte, le Retour du Roi est déjà, d'assez loin, le meilleur film de la trilogie. C'est le plus long, et pourtant c'est celui qui passe le plus vite. C'est aussi le plus beau, mélange idéal entre la féerie de la Communauté de l'Anneau et la verve épique des Deux Tours. C'est le plus spectaculaire, avec facilement plus de la moitié du métrage composée de scènes hallucinantes qui laissent parfois bouche bée. On a jamais vu ça avant. C'est certain. On le reverra sans doute souvent après, ailleurs, chez d'autres, mais voilà bien une œuvre fondatrice. Les effets spéciaux étant parfaits dans l'ensemble et touchés par instant par une véritable poésie.
Le Retour du Roi est aussi, forcément, très émouvant. Les vingt dernières minutes appellent les mouchoirs sans accorder la moindre pause. Le film respire une puissance, une force, incroyables. On se sent porté par les images, la musique, les performances d'acteurs. Et le suspens de conclusion, qui débute avec le film et qui ne s'achève qu'à une demie-heure de la véritable fin, ne se relâche jamais et atteint sur sa résolution une intensité jamais aperçue dans une œuvre "grand public". Et on finit par croire, devant de telles visions apocalyptiques, que nous sommes, nous aussi, "à la fin de toutes choses". Le Retour du Roi, et le Seigneur des Anneaux dans son ensemble, est l'oeuvre de divertissement qui fait table rase du passé, pour mieux ouvrir la voie d'un futur enthousiasmant.
Peter Jackson nous emporte donc loin de tout, de la première scène (filmée par sa compagne, Fran Walsh, à laquelle l'oeuvre de Jackson doit énormément) jusqu'à la délicate conclusion (qui fait exploser le cœur). Les séquences les plus attendues ne déçoivent pas une seule seconde. La bataille des champs de Pelennor est facilement ce que l'on a vu de plus impressionnant sur un écran de cinéma et renvoie aux oubliettes celle du Gouffre de Helm. Le siège de Minas Tirith n'est pas mal non plus dans le genre, ainsi que la vision de Minas Morgul, accompagnée par les cris assourdissants des Nazguls. Shelob est magnifique, c'est à dire parfaitement terrifiante et répugnante. Quant à la Montagne du Destin, c'est bien la plus grande scène de la trilogie.
Que dire sur les protagonistes ? Sam est toujours, et d'autant plus, le héros de l'histoire. Frodo souffre sans trêve, on finit par le ressentir. Gollum est sublime et l'on peut enfin découvrir son "interprète" Andy Serkis en chair et en os. Gandalf est très présent et follement charismatique (on a fini par s'habituer à sa tenue immaculée). Aragorn est paradoxalement en retrait, même s'il gagne en force à toute fin de l'histoire. Peter Jackson est toujours amoureux de Legolas, l'elfe persistant à faire des trucs de super-héros (essentiellement massacrer un oliphant à lui tout seul). Gimli n'est plus le bouffon de service, ce qui est très agréable. Merry et Pippin sont sans doute les personnages qui gagnent le plus de profondeur dans le Retour du Roi. Ils deviennent ainsi très touchants et volent fréquemment la vedette. Theoden est chevaleresque et superbement interprété par Bernard Hill. Eowyn est toujours aussi ravissante, voire radieuse, même si l'absence des Maisons de Guérison, dans la version courte, évince son personnage de la fin du film. Faramir parvient à exister en quelques scènes. De même que Denethor, même s'il est sans doute un peu trop caricatural. Eomer ne fait que passer. Ainsi que Galadriel, qui apparaît une nouvelle fois totalement gratuitement au milieu du métrage (gag récurrent ?). Par contre Elrond et Arwen s'offrent encore quelques plans d'une beauté irréelle. Voyons, est-ce que j'oublie quelqu'un d'important ? Sauron et son formidable "I see you !" ? Effroyable ! Le Roi des Nazguls ? Enorme ! Shelob ? Déjà évoquée, elle est géniale ! L'armée des morts ? Impeccable !
Alors, des défauts dans le Retour du Roi ? Aucun, ou si peu. Ils sont tellement noyés dans la splendeur de l'ensemble que tout semble couler de source. Et on ose à peine imaginer ce que va donner la trilogie intégrale en version longue. La musique ? Une synthèse majestueuse de tous les thèmes. La mise en scène ? Virtuose, survoltée, parfois lorgnant vers un Tim Burton, parfois vraiment novatrice. Bien sûr, je comprends tout à fait que l'on puisse rester insensible au Seigneur des Anneaux, voire complètement hermétique. C'est du cinéma passionné qui ne peut parler qu'au cœur, droit au cœur. Alors on s'extasie ou l'on s'endort, on rêve éveillé ou l'on se moque. On ne peut pas se forcer à aimer ou à détester le Retour du Roi, le film est tellement "trop" qu'il n'y a plus de place pour la demie-mesure.
Pour ma part, j'ai assisté à l'apothéose du cinéma spectaculaire tel que je le chéris. Je sais qu'un jour on fera mieux, mais j'ai eu l'impression de vivre un moment historique. Il faut être aujourd'hui, maintenant, dans les salles de cinéma pour découvrir le Retour du Roi. Par pitié n'attendez pas le DVD ou pire la diffusion TV (dans une VF ignominieuse). Remisez votre putain de cynisme au fond d'un placard. L'histoire s'achève maintenant, sur grand écran, dans l'incarnation de nos plus fabuleux rêves d'enfants. Un moment unique, qui vous accompagnera, sans doute, très longtemps.
A tel point que je ne peux pas me résoudre à classer ce film à une seconde place, même si un top, aussi personnel soit-il, ne veut jamais dire grand chose. Un top est là pour symboliser maladroitement l'affection que l'on porte à des œuvres. D'une manière très triviale, mais aussi compréhensible par tous. Alors, voilà, deux films extrêmement différents à tous les niveaux, ont fait chavirer mon cœur en 2003, au-delà de tout ce que je peux exprimer. Le film le plus intime qui soit et le film le plus emphatique possible. Dolls et le Retour du Roi, deux facettes du 7e art, deux chefs-d'oeuvre pour vivre mille vies, pour exister plus fort, pour rêver plus loin que les rêves. |
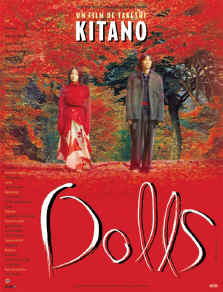
1 ex-aequo
Dolls
C'est un cliché d'une extrême banalité que de prétendre que l'amour est le plus complexe des sentiments. Mais parfois les clichés ont raison. On doit vivre l'amour, l'expérimenter. Mais on ne pourra jamais l'exprimer. La complexité du sentiment amoureux, la richesse d'une relation appartiennent à l'indicible. Incompréhensible, inaccessible à la raison, l'amour est présent en nous à chaque instant, tout en nous échappant continuellement. Mais si la science, la philosophie, le langage humain ne peuvent le définir, l'art ne cesse d'essayer de dévoiler son essence. Mais voilà, le langage artistique sur l'amour se perd aussi dans ses nobles ambitions, il erre dans des méandres abscons ou dans d'éternels clichés. La guimauve le dispute au romantisme caricatural, la banalité se confond avec l'idéalisation du sentiment. Au cinéma, la comédie romantique voisine avec le drame hystérique, et tous les genres traînent avec eux les mêmes scènes, les mêmes répliques, les mêmes histoires, les mêmes images, les mêmes idées. L'amour, et ses incarnations infinies, ne sont plus que des stéréotypes. Figé sur la pellicule, ce sentiment ne retrouve que très rarement une parcelle de son intensité et de sa complexité.
Et parfois les miracles se produisent.
Un auteur plus sage, plus fou, plus talentueux, plus humain, trouve la justesse. Il s'approche, comme peu l'ont fait avant lui, de cette transcendance du sentiment amoureux. Au cinéma, il faut moins des mots que des silences, des images, des regards, des couleurs, du temps qui passe. Cette "durée" de l'amour, qui échappe tant au 7e art, est pourtant indispensable. Mais comment parvenir à dire autant sans paroles, sans ennui ? Comment atteindre l'universel en n'évoquant que le plus intime ? Une telle œuvre fait plus appel au cœur de l'artiste et sans doute à son inconscient, qu'à une puissante et froide réflexion. Il faut une sincérité absolue ; la moindre tricherie, la moindre concession, et tout s'effondre. Le film n'est plus qu'un film.

En 2003, un metteur en scène a trouvé les images pour nous montrer l'amour comme nous ne l'avions jamais vu sur un écran de cinéma.
Avec Dolls, Takeshi Kitano nous a offert une œuvre d'art unique. L'amour, dans sa beauté absolue, dans sa cruauté, dans sa durée. L'amour avec ses espoirs et sa désolation, dans ses injustices et ses sacrifices. L'amour comme contrainte, comme don, comme fatalité, comme sauveur. L'amour loin de tous les clichés, au plus près de la vérité du cœur. L'amour comme le cinéma ne l'avait jamais dévoilé. Avec les couleurs du rêve, les errances de l'existence, la légèreté et la magnificence de l'âme dans le moindre regard. L'amour dans son quotidien, trivial, étouffant, répétitif, et qui soudain atteint le plus haut degré de passion et d'humanité. Et en un plan final, peut-être l'un des plus beaux de l'histoire du cinéma, Dolls parvient à toucher notre âme avec la puissance même de l'amour.
Une œuvre bouleversante, sublime, d'une sagesse discrète. L'œuvre d'un artiste au sommet, qui parvient à exprimer l'inexprimable. Le complément "réaliste" de The Lovers de Tsui Hark, qui offrait pour sa part une vision idéalisée, exaltée, fantastique et inaccessible de l'amour. Humble et follement ambitieux, tout à la fois, Dolls tient donc du miracle. Et peut prétendre au titre de plus grand film sur l'amour de l'histoire du cinéma. C'est donc bien peu de choses que de venir vous affirmer que Dolls est le meilleur film qu'il m'ait été donné de voir cette année. |

Hors Classement
Le Château dans le Ciel
Comme en 1999, avec la sortie retardée pendant une décennie de Totoro, le film de l'année nous parviendrait tout droit surgit d'une faille temporelle. Miyazaki, toujours lui, l'homme qui ne sait créer que des chefs-d'oeuvre, avec Laputa - Le Château dans le Ciel, sorti au Japon en 1986... et en 2003 en France. Bien sûr, j'aurais pu le classer au milieu des autres films de l'année. Mais être à part, au-dessus de la mêlée, flottant dans les nuées, c'est bien là la juste place que l'on peut accorder à une œuvre de Miyazaki.
Que dire qui n'a pas déjà été dit ? Tout le monde s'est extasié devant le Château dans le Ciel. Et affirmer que cela était mérité est une évidence triviale. L'univers de Laputa est si magique, évocateur et touchant qu'il nous émerveille par son simple souvenir. L'aura du film, comme toujours avec Miyazaki, dépasse largement le cadre temporel du visionnage de l'oeuvre. Et des semaines, des mois plus tard, on se surprend à lever les yeux vers le ciel en quête d'une île au trésor surmontée d'un arbre géant.
Laputa est un songe en apesanteur, une exaltation de notre fascination pour l'aventure fantastique et un ticket enchanteur qui nous offre le droit inestimable de revenir vers notre enfance. Pas une "rechute" vers la niaiserie, pas une enfance idéalisée par des adultes qui ont tout oublié, non, une enfance telle qu'on l'a vécue, avec ses démons et ses merveilles, sa violence, sa tendresse, ses sortilèges et ses récits immenses qui faisaient exploser les murs de la chambre. Voilà ce que nous offre à chaque fois Miyazaki. Et son tout récent chef-d'oeuvre incontournable, le Voyage de Chihiro, mon film de l'année 2002, était la synthèse idéale de toutes ces promesses. La plus grande des aventures, hors du temps, de l'espace, des cultures, de la réalité, chaque œuvre de Miyazaki nous l'offre. Si un jour on ne doit garder que quelques souvenirs du 7e art, prions pour que les films de Miyazaki en fassent partie. Ils sont l'idéal du cinéma.
Mentions spéciales
Une année aussi impressionnante que 2003 ne pouvait raisonnablement pas tenir dans un top 10 (même si j'ai un peu triché...), je me vois donc dans l'obligation d'accorder de nombreuses mentions spéciales et autres coups de cœur à certaines œuvres qui m'ont plus ou moins marqué.
La première de ces mentions se doit de revenir à The Hours, parfait mélodrame hollywoodien. Une belle histoire (trois belles histoires !), des belles actrices (trois belles actrices !), une jolie mise en images, avec une jolie musique de Philip Glass (qui fait toujours la même chose, mais ne chipotons pas). Le film, qui, avant Dogville, a imposé Nicole Kidman comme l'actrice de l'année. Mais au détour d'une scène mémorable, face à une touchante Julianne Moore, Toni Collette nous rappelle sa présence, un jour c'est elle qui recevra l'Oscar...
Terminator 3, ensuite, que je persiste à considérer comme le meilleur de la série. Au grand désespoir de la majorité des fans de l'indestructible (ou presque) cyborg. Mais ce troisième volet est moins figé que le premier et moins niais que le second. Un second volet qui tenait essentiellement la route grâce à ces monstrueuses scènes spectaculaires. Scènes renvoyées aux oubliettes par la débauche de destructions de Terminator 3. Une œuvre qui n'affiche pas d'autres prétentions que de divertir avec du spectacle brutal et de la SF apocalyptique à l'ancienne. La réussite est quasi totale.
La Cité de Dieu, malgré quelques vilains tics de mise en scène, l'histoire (vraie) contée est suffisamment puissante et les acteurs (amateurs) si brillants que l'on peut tout pardonner.
Le McTiernan annuel, Basic, aussi virtuose que futile.
Le Royaume des Chats et Mari Iyagi, deux dessins animés sous la haute influence de Miyazaki. Malheureusement, ils sont tous les deux assez éloignés des ambitions du maître, et ils peinent à décoller. Malgré de belles qualités narratives et surtout esthétiques.
Quelques séries B sympathiques, quoique inégales, telles que le classique mais prenant Abîmes, le très intense Equilibrium, le tordant Destination Finale 2, l'inégal mais plein de bonnes intentions 28 Jours Plus Tard, l'immonde Haute Tension ou le définitivement barré House of the Dead (qui ne sort en France qu'en 2004, j'y reviendrais peut-être). Le grand-papa de tous ces "petits" films, Evil Dead, a même eu droit à un retour traumatisant sur grand écran. La reprise de l'année.
Il y a aussi les coups de génie épars. Dont le plus marquant serait la scène d'ouverture du par ailleurs assez décevant Gangs of New York de Martin Scorsese. Film bourré de qualités, essentiellement esthétiques, mais plombé par une histoire manquant cruellement d'impact. Autre film inégal mais sympathique, l'agréable Interstella 5555, mais encore faut-il supporter la musique de Daft Punk, ce qui n'est pas donné à tout le monde.
D'autres œuvres mériteraient bien des louanges, mais elles demeurent pour l'instant inédites en France, à l'image de l'étonnant Resurrection of the Little Match Girl ou du très beurk Ichi The Killer, pourtant mis en scène par le tâcheron Takeshi Miike.
L'année 2004 s'annonce sous un jour des plus séduisants. Bien sûr avec, dans un premier temps, le très, mais alors très très très attendu Big Fish de Tim Burton. Enfin, attendu par moi, du moins, mais je crois que je suis pas le seul. On guettera aussi, entre beaucoup d'autres, un Neverland avec Johnny Depp et Kate Winslet, le volume 2 de Kill Bill, The Incredibles du studio Pixar, l'extrêmement prometteur nouvel épisode de Harry Potter (superbe bande annonce), un nouveau Spielberg (qui ne cesse de se surpasser ces dernières années), le début du tournage du King Kong de Peter Jackson (il faudra bien cela car... mon Dieu, c'est terrible... il n'y aura pas de Seigneur des Anneaux à Noël prochain... on prend vite l'habitude des bonnes choses... mais si on commence déjà à évoquer très sérieusement The Hobbit), quelques péplums (Alexandre, Troie, et j'en passe), sans doute au moins un Tsui Hark (et la sortie de Legend of Zu en France ? Un jour... peut-être...), peut-être un Kitano...
2004 risque d'être avant tout d'être une année très "animée", car outre The Incredibles, nous aurons (peut-être) droit aux sorties françaises de Ghost In The Shell : Innocence, toujours mis en scène par Oshii, de Steamboy d'Otomo et du nouveau Miyazaki dont le nom m'échappe à cet instant (une histoire de château, à nouveau, je crois). En attendant, toujours, et encore, la distribution de Millenium Actress, le chef-d'oeuvre total de Satoshi Kon (et je pèse mes mots). Bref, pas de quoi s'inquiéter, l'avenir cinématographique est radieux.
|
|